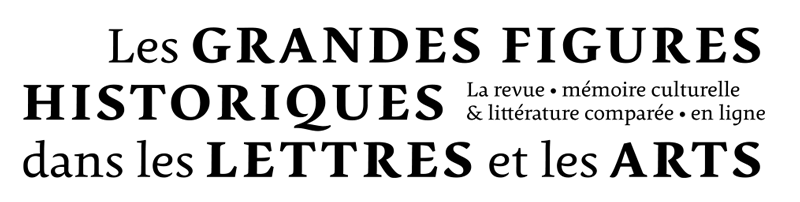Et si l’uchronie avait existé au XVIIe siècle ? Gomberville aurait-il publié en 1632 un roman inachevé intitulé Polexandre, en choisissant comme point de divergence « la journée de Tours » en 7321 ? Si l’« uchronie », comme dénomination et comme pratique littéraires, naît au xixe siècle et s’impose comme un genre reconnu et populaire au siècle suivant2, l’histoire contrefactuelle (« historical counterfactualism »3), qu’elle soit spéculative ou narrative, trouve des attestations dans l’Antiquité et des antécédents à l’époque moderne. La méditation sur les possibles non actualisés ou les futurs contingents infuse la philosophie de Pascal et soutient la Théodicée leibnizienne. L’abbé de Pure, bien avant Louis-Sébastien Mercier, produit en 1659 sous le titre d’Épigone une « histoire du siècle futur » qui relève aussi bien du récit d’anticipation que de l’uchronie avant la lettre4.
À l’âge classique, l’histoire, fondée sur l’exemplarité d’« hommes illustres », dont les choix et les actions déterminent les événements marquants des destinées collectives, paraît même entretenir une affinité particulière avec l’analyse contrefactuelle5. Si les débats contemporains suscités par la mise en œuvre de nouvelles méthodes historiographiques (« new historicism ») ont pu conduire à une prudente séparation entre histoire contrefactuelle et fiction uchronique, l’époque moderne semble au contraire propice à une confrontation, voire à une confusion des discours, puisque des polygraphes comme Gomberville conjuguent avec profit invention romanesque et réflexion historiographique. Non seulement l’invention contrefactuelle résout fructueusement l’aporie aristotélicienne qui condamne l’histoire et la fiction narrative à des fonctions et des usages irréductiblement différents, mais elle répond à certaines hantises qui préoccupent la pensée moderne6. Supposons donc, au titre d’une « fiction de méthode » ou d’une hypothèse de travail sans doute elle-même contrefactuelle7, que l’uchronie existe bel et bien au XVIIe siècle, et que Marin Le Roy de Gomberville en soit l’un des premiers promoteurs.
La série romanesque des Polexandre (1619-1641), inaugurée en 1619 avec L’Exil de Polexandre et d’Ériclée, constitue un laboratoire romanesque inédit en son temps8. La filiation et le provignement de ces différentes versions alternatives se mesurent à la lecture des incipits successifs des quatre éditions parues en 1619, 1629, 1632 et 1637. Un air de famille les apparente, puisque chaque réécriture sollicite une même situation initiale : des personnages, lectores in fabula, aperçoivent « un homme qui du plus haut d’un rocher se precipitoit dans la mer »9. L’invention romanesque ne procède pas de façon linéaire ou incrémentale, elle évolue par variations, de façon « excentrique et excentrée »10, elle entrelace les fils narratifs, et embrasse des possibilités imaginaires qu’elle avait semblé un moment délaisser. En 1619 en effet, ce « spectacle meslé d’horreur et de pitié » prend place au large de la Sicile, sous le règne d’Henri II. La même scénographie est reprise en 1632, mais ce sont Childebrand, le frère cadet de Charles Martel, et Bajazet, un chrétien dissimulé sous l’habit d’un corsaire maure, qui regardent l’inconnu se précipiter d’un écueil. En 1629, la Sicile avait été remplacée par la Grèce, puisque le roman s’ouvrait sur la bataille de Lépante (1571), qui oppose les Ottomans aux armées de Charles Quint. À partir de 1637, Gomberville fixe les aventures de ses héros au XVe siècle, et c’est Iphidamante, le frère fictif de Polexandre, grimé en « jeune Turc », qui accoste dans une rade des Canaries et introduit le lecteur dans l’univers de la fiction. La création de Gomberville sollicite un lecteur capable de reconnaître et d’apprécier les ressemblances et les divergences narratives ou structurelles, car elle se plaît aux réflexions spéculaires et aux variations anamorphotiques autour d’une trame fixe11 : une scène pathétique et surprenante (un homme se précipite dans la mer) ; un contexte guerrier (un combat naval mettant aux prises des belligérants aux convictions religieuses différentes) ; un trio de personnages (Bajazet, Zelmatide, et selon les cas, Polexandre ou son frère).
Les aventures maritimes de Polexandre, longtemps suspendues, marquent ainsi autant de jalons d’une réflexion complexe et constante sur les relations entre histoire et fiction. Dans le premier volume de la « franchise » Polexandre, le héros survient tardivement dans l’intrigue, au détour d’une histoire enchâssée qui raconte en abyme ses tribulations. En 1629, Polexandre participe aux conflits civils du règne de Charles IX. Sans doute Gomberville recycle-t-il ici le matériau d’un ancien projet longtemps caressé, puis finalement abandonné, une chronique des derniers Valois. Polexandre raconte ainsi sa jeunesse à Bajazet et à Zelmatide, il introduit ses auditeurs à la cour de François II et de Charles IX, leur décrit les fêtes fastueuses de Fontainebleau, les batailles de Jarnac et de Moncontour, la paix de Saint-Germain, l’élection du duc d’Anjou à la couronne de Pologne. Le récit s’arrête au seuil du massacre de la Saint-Barthélemy12. « Polexandre » est le pseudonyme choisi par un noble de haut parage dont l’engagement politique et militaire auprès des « Malcontents » aurait précipité la disgrâce13. Charles IX et Catherine de Médicis le soupçonnent en effet de sympathies huguenotes, et contrarient ses projets amoureux, en songeant à unir Olimpe, sa maîtresse, à Phélismond, le favori et le successeur du roi de Danemark. Le roman prend la tournure de l’histoire secrète14, qui double d’épisodes fictifs et particuliers la trame générale de l’histoire collective. Certaines pages de L’Exil de Polexandre présentent les personnages du passé « dans leur déshabillé » (selon la formule de Mme de Villedieu dans ses Annales galantes) et annoncent la nouvelle historique et galante qui s’impose dans la seconde moitié du XVIIe siècle15. Le héros jouit d’une véritable autonomie fictionnelle ; Gomberville se garde de projeter sur lui ses nostalgies ou ses idéaux politiques16. En effet, si le volume est dédié à Nicole de Lorraine, parente de la maison de Guise, Polexandre, courtisan disgracié, campe un noble « malcontent », qui hérite de son père une situation délicate à l’égard du roi, au point qu’il se voit suspecté de soutenir les chefs du parti protestant, en particulier le prince de Condé. En 1632 paraissent deux tomes qui, sous le simple titre de Polexandre, relatent les aventures inachevées du héros éponyme devenu Charles Martel17. Son ultime métamorphose en 1637 le transforme en roi des Canaries, éperdument épris d’Alcidiane, princesse de l’île inaccessible. L’utopie insulaire l’emporte sur la vraisemblance historique18, et si Polexandre assiste fugitivement aux noces du roi Charles VIII et de la duchesse Anne de Bretagne, le récit n’est ancré dans aucun « chronotope » précis19. Le roman d’aventure, s’il conserve une ambition savante et encyclopédique20, s’éloigne de toute préoccupation historique21 pour emporter le lecteur au large de son actualité.
L’ébauche de 1632 occupe une place originale dans cette série romanesque. L’intrication du récit historique et de la fiction ne relève ni de l’histoire secrète, ni de l’application à clefs22, ni de la polygraphie, mais d’une exploration contrefactuelle qui trouve un écho dans un essai historiographique que Gomberville dédie au chancelier Du Vair quand il commence sa carrière de « professionnel des lettres » : Le Discours sur les vices et les vertus de l’histoire, ou la manière de la bien écrire (1620). La singulière audace de cette proposition romanesque aurait en effet, selon le témoignage de l’avis « aux honestes gens » qui suit l’épître dédicatoire adressée à Louis XIII, attiré à son auteur les critiques d’esprits un peu trop « délicats » :
J’oubliois de vous advertir qu’à la Cour il y a des oreilles si delicates qu’elles n’ont pu souffrir un nom que l’histoire veritable m’a forcé de mettre dans la fabuleuse. J’avouë que je pouvois violer cette loy sans me rendre criminel, mais je n’ay pas cru que ma complaisance me dût obliger à debaptiser un Prince qui est mort il y a plus de neuf cent ans […].23
Longtemps différée, l’apparition de Polexandre, nom de baptême de Charles Martel, fils adultérin de Pépin II et d’une concubine nommée Althéide [Alpaïde], intervient au cinquième livre du premier tome. Son frère Childebrand, que le lecteur suit depuis les premières pages du roman24, le retrouve alors sur le champ de bataille où il ferraille contre le prince de Bavière. Deux récits enchâssés permettent à Childebrand de raconter à Bajazet, puis, au début du second tome, à sa maîtresse Cintille, les aventures prodigieuses et les exploits effectués par Polexandre avant le début de l’ouvrage, dont l’action se déroule à la veille de la « journée de Tours », vers 729 : Bajazet est en effet envoyé par Abderame [Abd al-Rahmân al-Ghâfiqî] à la poursuite de Munizie [Munnuza], un chef berbère qui a trahi les Sarrasins en s’alliant au duc d’Aquitaine Eudon [Eude], l’ennemi de Polexandre. La fin du premier tome relate l’exécution de Munizie à Cerdagne, et le ralliement d’Eudon à Polexandre, qui, pensant avoir rétabli une « paix de longue durée », s’en retourne à Orléans, dans l’espérance de retrouver Olimpe.
L’uchronie fait fonds sur une vulgate historique (« a normalized narrative of the real past » selon la formule de K. Singles) qui permet au diligent lecteur d’apprécier immédiatement et sans érudition particulière les effets de divergence produits par le romancier25. Ainsi Gomberville confond-t-il au gré des situations les ennemis qu’affrontent Polexandre et les siens ; il utilise sans grande discrétion les termes d’« Arabes », de « Sarrazins », ou de « Maures ». Il nomme, selon l’usage courant, les chefs musulmans « Mirammolins », quand l’historien Scipion Dupleix enjoint son docte lecteur de préférer l’expression « émir momin »26. En inscrivant sa fiction dans les marges d’une histoire connue et récemment rappelée à la mémoire de ses contemporains27, Gomberville peut s’épargner une fastidieuse datation des événements auxquels il se contente de faire allusion en évoquant les noms fameux de leurs protagonistes légendaires : le mariage de Munizie et de Momerane, la fille d’Eudon, duc d’Aquitaine ; les amours adultères de Pépin et d’Althéide ; les combats victorieux de Polexandre, qui fédère sous son pouvoir l’Austrasie et la Neustrie, en Germanie, en Bavière et en Frise ; l’emprisonnement de Polexandre par sa belle-mère Plectrude.
Tendu entre analepse et prolepse, anticipation oraculaire et histoire enchâssée, le récit, ménageant suspense et curiosité, contourne savamment l’événement qui l’obsède. Fin d’une narration obstinément inachevée, la relation de la « bataille de Tours » est annoncée, constamment éludée. Quand, au début du second tome, Polexandre et Olimpe se retrouvent brièvement à Paris, la jeune femme prophétise la victoire finale de son amant :
pour se continuer le plaisir de voir Olimpe, il [Polexandre] luy conta toutes les revolutions qui estoient arrivées en Espagne depuis la mort de Munizie, & comme s’il eust connu l’advenir, l’asseura qu’Abderame se faisoit peu à peu un chemin à la conqueste de toute la Chrestienté. A ce mot Olimpe sousriant avec sa grace accoustumée, interrompit Polexandre, & prenant l’occasion de le loüer ; la Chrestienté luy dit elle, & la France en particulier, auroient sujet de craindre cette horrible infortune si vous les abandonniez au besoin ; mais elles attendent toutes deux de vostre courage la protection qu’elles y ont tousjours trouvée.28
Le récit épique de la bataille de Tours reste à l’horizon du texte, promesse non tenue d’un roman prématurément abandonné par son auteur29.
Un usage savant de la pseudonymie et de l’homonymie permet au romancier d’embrayer la fiction uchronique qu’il se plaît cependant à désamorcer aussitôt. Certains personnages emblématiques possèdent en effet un double nom, comme Polexandre30 ou son père, Pépin, également appelé « Anchise », tel le père d’Énée dans la geste troyenne. Les feintes onomastiques suturent fiction et histoire, et lèvent le ferment de l’imagination contrefactuelle. Le jeu avec l’histoire s’autorise également de discrets effets « caméo », clins d’œil à la curiosité et à la culture historiques du lecteur, peut-être étonné de rencontrer, parmi les personnages secondaires, un Tibère, un Héraclius, un Justinien ou un Clovis. Ce dernier personnage est le père d’Olimpe, comme Childebrand l’apprend à sa maîtresse Cintille :
Vous aurez agreable, Madame, avant que je passe outre, que je vous fasse particulièrement entendre une chose qui est tout le secret de cette histoire. Sçachez qu’un peu devant le dernier voyage qu’Anchise fit en l’Isle d’Amistrache, florissoit en France un Prince du sang du grand Clovis. Il se nommoit Clovis de mesme que son predecesseur & avoit espousé une Princesse Françoise nommée Algeside. La premiere année de ce mariage fut une feste continuelle parmy les François, mais comme si Dieu eust voulu confirmer par quelque fameux exemple, la fragilité des choses du monde, il permit qu’Algeside estant accouchée d’une fille, mourut contre l’attente & l’opinion de toute la cour.31
L’uchronie, à mesure qu’elle progresse dans le récit, efface ses traces, et l’histoire légendaire reprend ses droits. La jeune Olimpe est courtisée, puis enlevée par Eudon, le duc d’Aquitaine. Pour jouir à son aise de la compagnie de la jeune femme tout en déjouant les soupçons de Polexandre, il prétend qu’elle est morte et conduit sa pompe funèbre à la basilique de Saint-Denis. Polexandre et Polémandre, croisant le funeste convoi, apprennent d’une femme endeuillée que le corbillard transporte « la Princesse Olimpe que le Duc d’Aquitaine envoye à Sainct Denis en France, pour estre mise dans le tombeau des Roys ses predecesseurs ». Ils découvrent bientôt le subterfuge tramé par Eudon et la substitution d’une jeune femme défunte à Olimpe32. La dépouille du personnage sera aussitôt retirée du royal tombeau romanesque qu’elle avait, un bref moment, dans l’imagination du lecteur, occupé. Les repentirs narratifs, l’inachèvement du roman, s’ils permettent au lecteur de rêver à un univers parallèle, potentiellement divergent de l’histoire communément rapportée, autorisent autant qu’ils entravent le déploiement d’une authentique expérimentation contrefactuelle. Le geste de Gomberville peut sembler, au regard d’une économie de l’invention et de la vraisemblance romanesques, particulièrement coûteux. L’échec du Polexandre de 1632 permet de mieux comprendre les solutions narratives finalement retenues en 1637, en particulier le relatif désancrage historique ultérieur de la fiction.
Même à l’état d’ébauche, la tentative uchronique de 1632 rencontre les préoccupations des lecteurs contemporains. En l’instituant narrateur principal des aventures du héros, Gomberville donne une importance et une saillance particulière à Childebrand, personnage par ailleurs discret dans les chroniques alors disponibles, même si Scipion Dupleix le montre combattant les Sarrasins à Tours. Déléguer la narration au frère de Polexandre constitue un procédé efficace, qui suscite l’empathie et l’intérêt du lecteur à l’endroit d’un protagoniste dont l’apparition dans le roman est longuement, et peut-être maladroitement, différée. Une certaine autorité est conférée à Childebrand, dont se prévaut, à la même époque, la race capétienne pour revendiquer l’héritage carolingien contre l’Espagne33. Assimiler le « maire du Palais » Charles Martel à Polexandre, et Polexandre à Louis XIII, comme le fait Gomberville dans l’épitre dédicatoire du premier volume34, investit d’une légitimité nouvelle le fondateur de la « deuxième race » des rois de France, souvent traité comme un usurpateur à la réputation controversée, et, en retour, fonde en droit et en tradition un changement dynastique récent rendu nécessaire par les discordes civiles et la défaillance du monarque régnant. Charles Martel, comme Henri IV, a su fédérer par son action sinon la nation, du moins le peuple que, par un anachronisme contrôlé, Gomberville baptise indistinctement du nom de « gaulois », de « franc », ou de « français ». Le siècle de Gomberville, féru de Tacite, est prompt à dresser des parallèles entre des contextes historiques éloignés (similitudo temporum), afin de mieux comprendre le présent et agir avec prudence.
Lire le Polexandre de 1632 comme une uchronie ne revient toutefois pas seulement à apprécier ses miroitements intertextuels ou à déployer ses possibles applications politiques contemporaines. Les jeux de spécularité auxquels s’adonne Gomberville, à l’échelle de la série romanesque entière ou de l’une de ses versions seulement, impliquent une conception de la fiction comme hypothèse historiographique et juridique contrefactuelle35, soustraite à la polémique, mais capable d’instituer et de penser les formes contingentes de vie commune actuelles. Comme uchronie dynastique, le Polexandre de 1632 explore moins un possible point de divergence appliqué à la bataille de Poitiers que « a juncture that is widely recognized to have been both crucial and underdetermined »36. Il invite le lecteur à considérer la succession des rois comme une fiction juridique, une interprétation historique relative et falsifiable, et à comprendre l’avènement des Carolingiens à la mort de Charles Martel comme un événement contingent que ses conséquences historiques ont rendu nécessaire. L’uchronie repose sur un paradoxe confinant au paralogisme, qui la disqualifie peut-être du strict point de vue scientifique, mais lui donne une singulière puissance heuristique. La narration uchronique développe en effet, dans un monde possible, les conséquences nécessaires d’un événement historique posé comme contingent et susceptible de variation par rapport à la donnée historique avérée (le « point de divergence ») : « The point of divergence relies upon the principle of contingency, while the continuing variance from the normalized narrative of the real past – that is, the rest of the narrative – relies on the principle of necessity. »37 Elle explore une solution de continuité historique délicate, que l’épître dédicatoire du Discours des vertus et des vices de l’histoire, adressée à Guillaume Du Vair, pointait dès 1620 :
Ne m’avouërez-vous pas, Monseigneur, que vous n’avez jamais lu presque toutes les Histoires de France, que la confusion, que les impertinences, & que les ordures dont elles sont remplies, ne vous les ayent rendu contemptibles & fascheuses, & ne vous ayent forcé malgré vostre naturelle debonnaireté de vous courroucer contre ceux qui nous les ont laissées ? Les uns mettent indiscrettement les usurpateurs de ceste couronne au nombre glorieux de nos Rois, les autres emplissent leurs livres d’ignorances, d’impostures & d’invectives, & presque tous y apportent si peu de prudence, que je me suis permis de faire voir en ce discours leurs prodiges, & de monstrer ce que je sçay des vertus qui peuvent rendre les histoires immortelles. J’espère, Monseigneur, si vous avez ce discours agreable, que je vous en feray bientost voir un autre, dans lequel prouvant que le Roy qui regne glorieusement aujourd’huy n’est que LOUIS XII. du nom, j’apprendray à ceux qui ne le sçavent pas, la difference qu’il faut mettre entre nos legitimes Roys & entre ceux qui durant leur minorité ou qui durant la confusion du gouvernement ont usurpé leur Throsne & leur puissance. C’est pourquoy, Monseigneur, sçachant combien ces entreprises sont delicates, & combien il est dangereux en de semblables occasions de se plaire aux flatteries de sa propre opinion, je prens la hardiesse de soubmettre ce discours à la censure de vostre grand jugement […].38
Et si Louis XIII n’était que Louis XII ? Et si Charles Martel n’était pas le fondateur de la dynastie carolingienne, mais un usurpateur chanceux ?
Il convient en effet d’ouvrir la lecture du Polexandre de 1632 à son contexte de réception39. Charles Martel n’est pas une figure historique consensuelle, surtout auprès des historiographes que Gomberville prend à parti dans son Discours sur les vertus et les vices de l’histoire. Si Scipion Dupleix entonne son panégyrique, en comparant ce souverain absolu à César40, et en le disculpant des accusations de saint Eucher41, d’autres historiographes semblent plus embarrassés, comme Étienne Pasquier42, du Haillan43, ou Pierre Matthieu44, qui fustigent l’ambition manœuvrière d’un tyran, mais célèbrent la divine punition détrônant les rois fainéants. Claude Fauchet atténue l’usurpation de Charles Martel, qui a respecté les rois légitimes, et a agi sous l’égide de leur autorité, quand bien même leur personne était indigne de ces hautes fonctions. Charles Martel aurait été investi du titre de « prince » ou de « duc des Francs » avec l’aveu d’un Parlement (placitum)45, qui, selon Bernard de Girard du Haillan, serait l’ancêtre des États-Généraux. Les auteurs protestants, comme François Hotman46 ou Jean de Serres47, utilisent l’exemple de Charles Martel pour prouver qu’il existe des formes de succession monarchique légitimes quoique non héréditaires. Ils vantent un idéal de monarchie mixte ou tempérée, les « rois fainéants », « rois en masque », apparaissant comme des tyrans d’exercice voués à la déposition. Selon Jean de Serres, ce sont les qualités morales de Charles Martel, prouvées par ses exploits militaires et ses succès diplomatiques, ainsi que la volonté du Parlement des Francs, qui lui ont permis, sans usurpation, de détrôner de fait des princes devenus indignes de l’être et d’accéder à une forme d’autorité royale, pleinement endossée par ses successeurs48.
La figure duplice de Charles Martel-Polexandre trouve, dans la fiction même, un autre répondant : Phélismond, favori du roi de Danemark, et rival en amour du héros. Ses aventures sont contées dans le second tome de l’édition de 1632, offert au duc de Saint-Simon. Gomberville invite le favori de Louis XIII à se reconnaître dans ce personnage valeureux49, que le roman présente comme le successeur désigné du souverain danois Gadarique. En 1637, quand Saint-Simon aura été disgracié, le second des cinq tomes du roman sera dédié à Richelieu, nouveau Polexandre50. Par les reflets spéculaires qu’elle projette dans et hors de l’univers romanesque, l’uchronie s’émancipe des célébrations officielles de l’absolutisme naissant51, pour rendre compte des bifurcations possibles de l’histoire de France. Elle propose d’« éclairer le passé à la lumière du passé » et de « dé-fataliser » l’histoire commune52, en la présentant comme une fiction régulatrice et civilisatrice qui aurait pu être différente. Il ne s’agit donc ni de célébrer en Richelieu un homme d’État providentiel, ni de dénoncer en Saint-Simon, favori encensé puis destitué, un nouveau « maire du Palais », ni de promouvoir une monarchie élective sur le modèle polonais. L’uchronie, comme méditation critique sur des possibles inactualisés, ouvre un champ de réflexion politique et juridique, qui montre à la fois la contingence radicale et la fragile nécessité du moment « absolutiste », d’une constitution créée dans le temps par des hommes.