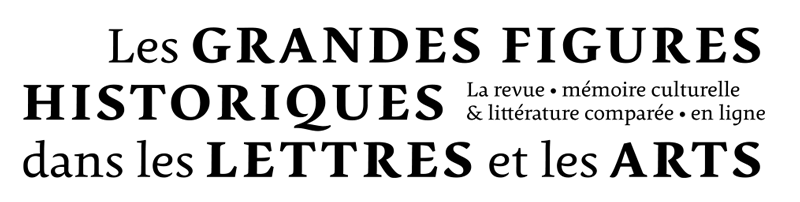L’Indien craint beaucoup le cheval et l’arquebuse,
mais il craint encore plus le chien […].
Bernardo de Vargas Machuca [1598]
Le jour où je n’aurai plus de soldats, je combattrai
avec une armée de chiens cimarrons.1
Général José Gervasio Artigas Arnal [1816]
Les récits de la conquête du Nouveau Monde ont longtemps mis l’accent sur la place occupée par le cheval lors des premiers contacts entre Européens et indigènes. Le noble animal conférait aux Espagnols une évidente supériorité, à la fois physique et symbolique : du haut de leurs fiers destriers, ceux-ci pouvaient toiser les populations autochtones effrayées par ces modernes centaures déversés sur leurs rivages par des vaisseaux inconnus. Bien que simpliste, eurocentrée et condescendante, cette version repose cependant sur une réalité initiale : arquebuses, navires, canons, cavalerie, armures et autres technologies guerrières européennes constituèrent sans conteste un réel choc pour les populations indigènes.
Il convient cependant de remarquer qu’en ce qui concerne le cheval, il s’agit là d’une vision à très court terme : les populations amérindiennes comprirent rapidement qu’hommes et bêtes formaient des entités distinctes et, le premier effroi passé, adaptèrent leurs techniques de combat en conséquence.
Moins caracolant et prestigieux que le rôle du cheval, celui du chien – et tout particulièrement celui du chien de combat – a pour sa part longtemps été minimisé et seule l’historiographie récente a daigné se pencher sur la question2. Les chroniques d’époque ne sont pourtant pas avares sur le sujet et les prouesses des chiens de la Conquista y sont narrées avec force détail, chaque auteur insistant avec plus ou moins de précision – selon le point de vue qu’il souhaite défendre – sur les hauts faits de ces molosses de guerre.
La présence des chiens espagnols est attestée dès les premiers temps de la Conquête. Lors de son passage en Jamaïque en 1495, Christophe Colomb mentionne déjà leur utilité et la panique qu’ils créent chez les indigènes : « Ici, un chien guerroie si bien que sa compagnie est aussi appréciée que celle de dix hommes ; nous avons grand besoin d’eux »3. Avec une tendance certaine à l’emphase, tous les récits ultérieurs reprendront le constat de l’Amiral de la mer Océane : « […] en compagnie d’un chien, les chrétiens considéraient qu’ils étaient deux fois plus nombreux […] »4 ; ou encore : « […] les Indiens craignaient plus dix Castillans avec un chien qu’une centaine en l’absence de celui-ci »5. Si l’hyperbole peut paraître quelque peu outrancière, elle n’en souligne pas moins l’effet produit par les chiens des Espagnols sur les populations indigènes. Deux raisons à cela : d’une part, les chiens de grande taille étaient inconnus de l’autre côté de l’océan ; d’autre part, leur dressage et leur utilisation comme arme de guerre et de répression augmentaient considérablement des aptitudes cynégétiques naturelles et une férocité déjà bien établie.
Concernant le rôle joué par les chiens durant les premiers temps de la Conquête, c’est sans conteste au missionnaire dominicain Bartolomé de las Casas que l’on doit les plus effroyables récits :
Et comme tous ceux qui pouvaient s’échapper se cachaient dans les forêts et dans les montagnes, fuyant ces hommes si inhumains, ces bêtes si impitoyables et si cruelles, ces ennemis déclarés du genre humain, les Espagnols dressèrent des limiers [lebreles], chiens si féroces que, lorsqu’ils voyaient un Indien, ils le mettaient en pièce en un instant, se jetant sur lui et le dévorant comme s’il s’agissait d’un sanglier [puerco]. Ces chiens causèrent moult ravages et carnages.6
D’emblée quelques précisions lexicales s’imposent car les traductions françaises des chroniques espagnoles recèlent de fréquentes erreurs. Tout d’abord, le terme de lebreles employé par les auteurs de l’époque pour désigner les chiens des conquistadors a souvent prêté à confusion : malgré une étymologie commune, le lebrel de l’Espagne classique n’est pas un lévrier, race canine que l’espagnol désigne habituellement sous le nom de galgo. Il s’agit plutôt ici de l’appellation générique désignant les limiers, ces chiens de chasse employés pour la traque au gros gibier7. Bien qu’un standard de race ne soit pas encore clairement défini, la morphologie des lebreles du XVIe siècle s’apparentait bien plus à celle du mâtin espagnol, du dogue cubain, du dogue des Canaries et autres molosses qu’à la silhouette élancée et véloce du lévrier moderne. De même, le puerco évoqué dans le texte de Las Casas est plus certainement le porc sauvage que le cochon domestique, animal symboliquement dégradé qui ne saurait faire référence aux indigènes sous la plume du dominicain8. On remarquera enfin que dans le texte de la Très brève relation de la destruction des Indes, le substantif perros est systématiquement suivi des qualificatifs bravos ou bravísimos qui, en l’espèce, renvoient bien moins au champ lexical de la bravoure qu’à celui de la férocité et de la sauvagerie.
C’est donc bien à un morbide simulacre de partie de chasse que s’adonnent ici les conquistadors, soucieux de faire un exemple de ces Indiens fugueurs. En l’espèce, les chiens ne sont pas armes de guerre mais instruments répressifs de la puissance colonisatrice.
Les exemples de ce type sont nombreux chez Las Casas. Tout entier voué à la dénonciation des crimes commis par les premiers conquistadors, le dominicain n’épargne nul détail à son lecteur :
En ce Royaume [le Yucatán] ou dans une province de la Nouvelle Espagne, un Espagnol allant un jour avec ses chiens à la chasse au gros gibier ou au lapin et ne trouvant que prendre, il lui sembla que ses chiens avaient faim ; il ôta un petit enfant à sa mère et le mit en pièce, lui coupant les bras et les jambes avec sa dague et donnant à chaque chien sa part puis, une fois ces pièces dévorées, il jeta à terre le reste du corps pour la meute.9
L’évêque du Chiapas sera également le premier à dénoncer le recours à la pratique de l’aperreamiento – la dévoration par les chiens – supplice employé par les conquistadors tant pour châtier à titre individuel les Indiens rétifs que pour terrifier collectivement les populations autochtones :
Comme ces cruels Espagnols allaient avec leurs chiens féroces cherchant les Indiens – femmes et hommes – pour les livrer à la dévoration des chiens, une Indienne malade, voyant qu’elle ne pouvait échapper à ceux-ci sans se faire déchiqueter comme ils le faisaient avec les autres, prit une corde et, ayant attaché à son pied son enfant de l’âge d’un an, se pendit à une poutre. Et elle ne fit pas assez vite car les chiens arrivèrent et dépecèrent l’enfant, même si un moine eut le temps de baptiser celui-ci avant sa mort.10
Bien que souvent accusé d’exagération par ses contemporains, les propos du dominicain n’en reposent pas moins sur des bases réelles que même ses plus fervents détracteurs n’osent nier. C’est ainsi le cas de Bernardo de Vargas Machuca qui, confirmant sans ambages l’emploi des chiens de guerre lors de la Conquête, propose toutefois une lecture bien différente de leur efficacité :
[…] le recours aux chiens que l’on a utilisés pour les guerres en ces lieux est bon car, grâce à cela, on a soumis rapidement de nombreuses provinces, plus vite qu’on ne l’aurait fait sans ces bêtes, et cela aurait coûté de nombreuses vies, tant chez nous que chez eux.11
Becerrillo et la conquête de Puerto Rico
[…] les bons écrivains nous enseignent qu’il est raisonnable et nécessaire que les bêtes – et non seulement les hommes – soient également célébrées et récompensées pour leurs vertus et leurs mérites, afin que l’on n’oublie pas ce que certaines d’entre elles ont fait ; car, en plus d’émerveiller par des actions admirables, inouïes et sans pareil, grande est la honte qui en résulte pour les hommes raisonnables – lorsqu’ils ne font pas ce qu’il faut – tandis que des bêtes s’illustrent et se distinguent par leurs vertus et leurs actes et parfois même surpassent les hommes en œuvres justes et en exploits. Y a-t-il plus grande ignominie pour un lâche que de voir, au milieu des hommes, une bête recevoir sa solde ? Ou un chien recevoir une part et demi de butin, comme un arbalétrier ? Tel fut pourtant le cas d’un chien nommé Becerrillo […].12
C’est également à Bartolomé de las Casas que l’on doit la propagation de la renommée de Becerrillo – ou Becerrico, comme on le trouve parfois mentionné –, chien de guerre qui accompagna les premiers conquistadors et dont les faits d’armes se retrouvent dans de nombreuses chroniques des Indes.
Il est difficile de retracer une biographie circonstanciée dudit animal. Les informations des chroniqueurs sont contradictoires et les différents récits qui le mettent en scène insistent davantage sur des exploits ponctuels que sur une trajectoire vitale. Il nous faut donc ici nous contenter d’hypothèses : Becerrillo dut arriver d’Espagne lors de l’un des deux derniers voyages de Christophe Colomb (1498-1502) ou, encore plus probablement, lors de la grande expédition colonisatrice de 1502 au cours de laquelle Nicolás de Ovando emmena avec lui 2500 Espagnols peupler les Indes occidentales.
Il eut pour maître le conquistador Juan Ponce de León, bien qu’il ait également combattu ponctuellement aux côtés du capitaine Diego de Salazar ou de Sancho de Aragón. La plupart des chroniqueurs semblent s’accorder en ce qui concerne le portrait de l’animal : malgré le signifié de son nom – « petit taureau », en castillan –, Becerrillo était un chien de taille moyenne pour sa race, de couleur fauve, aux traits molossoïdes et au museau noir. Mais il était surtout intrépide et supérieurement intelligent13, et c’est bien l’alliance de ces deux dernières qualités qui semble avoir fait sa réputation auprès des conquistadors :
Le premier à guerroyer et qui participa plus que les autres, fut un chien qu’on appelait Becerrillo, qui faisait chez les Indiens des dégâts inouïs et distinguait les Indiens guerriers de ceux qui ne l’étaient pas comme s’il était humain ; ceux qui soumirent cette île le considéraient comme un ange du Seigneur. Et l’on raconte qu’il faisait des choses si merveilleuses que dix Espagnols en sa compagnie terrorisaient bien plus les Indiens que s’ils avaient été cent en son absence.14
[…] parmi deux cent Indiens, il trouvait celui qui avait fui les chrétiens […] et s’il opposait une quelconque résistance et refusait de venir, il le mettait en pièces et il faisait encore d’autres choses dignes d’admiration. Et lorsqu’un prisonnier s’échappait, et même s’il avait déjà franchi une lieue, lorsqu’on lui disait « L’Indien a fui ! » ou « Cherche ! », il retrouvait sa trace, le débusquait et le ramenait. Et, comme les hommes, il faisait preuve de discernement avec les Indiens pacifiques et ne leur faisait pas de mal. Mais parmi une foule pacifique il reconnaissait un guerrier indien et il semblait bien posséder la sagesse et l’intelligence d’un homme (et encore, pas des plus stupides) […]15
Le trait caractéristique qui individualise Becerrillo parmi les autres chiens de la Conquête est bien cette capacité à séparer le bon grain de l’ivraie, à distinguer Indiens paisibles et guerriers belliqueux. L’admiration et l’étonnement manifestés par les Espagnols permet de tracer en creux le tableau de ce que devait être le comportement habituel du cheptel canin des conquistadors : une meute sanguinaire semant partout la terreur sur son passage ; une horde frappant de manière indiscriminée guerriers ennemis et populations innocentes.
À cet égard, un événement se rapportant à la conduite de Becerrillo a tout particulièrement marqué les esprits des chroniqueurs de l’époque, lesquels relatent tous l’anecdote de manière sensiblement identique… à quelques détails près :
Il n’y a qu’une seule chose de celles que l’on raconta au sujet de ce chien que je veuille écrire ici. Dans ces Indes, les Espagnols eurent toujours pour habitude, lorsqu’ils avaient des chiens, de leur jeter les Indiens qu’ils attrapaient, hommes comme femmes, soit pour passer le temps et exciter davantage les chiens, soit pour accroître la crainte des Indiens d’être mis en pièces. Ils décidèrent un jour de jeter une vieille femme audit chien [Becerrillo] et le capitaine [Diego de Salazar] donna à la femme un morceau de papier en lui disant : « Porte cette missive à ces chrétiens » – ceux-ci se trouvaient à une lieue – afin de lâcher ensuite le chien lorsque la vieille femme serait sortie de la foule. L’Indienne prit la lettre avec joie, croyant ainsi pouvoir échapper aux Espagnols. Une fois partie et après qu’elle se fut écartée de la foule, ils lâchèrent le chien. Lorsqu’elle le vit accourir si féroce, la femme s’assit par terre et se mit à lui parler dans sa langue : « Seigneur chien, je vais porter ce message à des chrétiens : ne me fais pas de mal, Seigneur chien » et elle tendait la main vers lui en lui montrant le morceau de papier. Très calme, le chien s’arrêta, se mit à la renifler et levant la patte, il urina sur elle comme font habituellement les chiens sur les murs et ainsi ne lui fit aucun mal. Émerveillés, les Espagnols appelèrent le chien et l’attachèrent et libérèrent la pauvre femme pour ne pas se montrer plus cruels que le chien.16
L’appréciation du chroniqueur Antonio de Herrera rapportant le même épisode demeure des plus neutres : « […] les Castillans en restèrent ébahis »17.
En revanche, pour Las Casas, l’anecdote est l’occasion de confronter l’entendement et la mesure manifestés par l’animal à la cruauté gratuite des Espagnols sacrifiant au chien une vieille femme… pour passer le temps, précise-t-il. Réputé tant pour son courage personnel que pour sa férocité à l’égard des indigènes caribéens, c’est le capitaine Diego de Salazar qui est ici tout particulièrement visé. Le récit du dominicain le dépeint comme plus sauvage que la bête qu’il envoie accomplir ses méfaits. L’anthropomorphisme et l’inversion des rôles sont ici évidents : c’est bien Becerrillo qui fait preuve d’humanité en refusant d’accomplir le dessein bestial de Salazar.
Bien que sa version de l’anecdote de la vieille femme diffère quelque peu de celle de Las Casas, Fernández de Oviedo ne suggère pas autre chose quant à la personnalité du capitaine :
Les chrétiens considérèrent que c’était là un grand mystère, tant le chien était intrépide et féroce. Alors, le capitaine, voyant la clémence dont le chien avait fait preuve, le fit attacher et on appela la pauvre Indienne qui revint épouvantée vers les chrétiens, pensant qu’ils avaient envoyé le chien pour la ramener et tremblante de peur, elle s’assit. Peu après arriva le gouverneur Juan Ponce et, ayant eu connaissance de l’affaire et ne voulant pas être moins miséricordieux avec l’Indienne que ne l’avait été le chien, il donna l’ordre de la libérer et de la laisser partir où elle voulait, ce qu’elle fit.18
Ici, la mansuétude dont fait preuve Becerrillo ne suffit pas pour faire libérer la vieille femme injustement emprisonnée. Il faut encore l’intervention du gouverneur Juan Ponce de León – « ne voulant pas être moins miséricordieux […] que ne l’avait été le chien » – pour contrebalancer toute la sauvagerie d’un Diego de Salazar. Le moins que l’on puisse dire est que le capitaine ne sort pas grandi de l’épisode et que la comparaison homme/bête est clairement en faveur de cette dernière. En courage et en bravoure, Becerrillo est – au minimum – l’égal de son maître du moment. En mesure et en humanité, ce dernier ne lui arrive pas au jarret.
Un tel animal ne pouvait mourir autrement qu’en accomplissant quelque action héroïque, en étant traîtreusement abattu, ou en combattant face à un ennemi bien supérieur en nombre. Ce fut tout cela à la fois. Sa mort survint en 1514 sur l’île de Boriquen – l’actuelle Puerto Rico – qu’il avait contribué à conquérir et à soumettre en compagnie de son second maître, le gouverneur Juan Ponce de León :
[…] il fut finalement tué par les Indiens Caraïbes alors qu’il était avec le capitaine Sancho d’Aragon lequel, blessé mais luttant toujours, put échapper aux Indiens grâce à Becerrillo. Celui-ci poursuivit à la nage un Indien et un autre, qui se trouvait sur la rive, l’atteignit d’une flèche empoisonnée ; le chien continua de nager pour rattraper l’Indien et mourut ensuite. Mais c’est grâce à lui que le capitaine Sancho d’Aragon et d’autres chrétiens furent sauvés […]19
Plus sensible aux souffrances des Indiens qu’à la mort d’une bête, Las Casas enterre quant à lui Becerrillo d’une phrase laconique : « […] Finalement, les Indiens qui tentaient de tuer cet ennemi juré finirent par l’abattre d’une flèche. »20
Bon sang ne saurait mentir
Becerrillo eut un fils, Leoncillo – ou Leoncico – qui naquit sur l’île de Puerto Rico et fut la propriété de Vasco Núñez de Balboa, célèbre pour avoir été, en 1513, le premier Européen à découvrir l’océan Pacifique depuis sa côte orientale.
Selon Gonzalo Fernández de Oviedo qui, le premier, diffusa les récits de ses exploits, Leoncillo était tout le portrait de son père : robe fauve et museau noir, il était fort et massif et, précise-t-il, « […] il avait de nombreuses marques et cicatrices qu’il avait reçues à la guerre en luttant contre les Indiens. »21
[…] je veux faire mémoire d’un chien de Vasco Nuñez qui s’appelait Leoncico, qui était le fils du chien Becerrico de l’île de San Juan [Puerto Rico] et qui ne fut pas moins célèbre que son père. Pour cette offensive et d’autres encore, ce chien fit gagner à Vasco Nuñez plus de mille pesos en or car, lors du partage, on lui donnait la même part en or et en esclaves qu’aux autres compagnons. […] Ce chien avait un instinct merveilleux et distinguait l’Indien paisible du guerrier comme moi-même, ou n’importe quel autre être […] doué de raison. Lorsque l’on capturait et enfermait quelques Indiens et Indiennes, s’ils s’enfuyaient, de jour comme de nuit, on disait au chien : « Il est parti. Cherche ! » […] et il était si fin limier qu’il était rare qu’il ne retrouvât ceux qui avaient échappé aux chrétiens. Et lorsqu’il le rejoignait, si l’Indien restait coi, il le saisissait par le poignet ou par la main, sans mordre ni serrer, et le ramenait aussi certainement qu’aurait pu le faire un homme ; mais s’il se montrait belliqueux, il le mettait en pièce. Et il était tellement craint des Indiens que dix chrétiens accompagnés du chien étaient plus en sécurité et plus efficients que vingt en son absence.22
Et Fernández de Oviedo d’ajouter que lui-même vit le fameux Leoncillo de ses propres yeux en 1515, peu de temps après le débarquement de Pedro Arias de Ávila, récemment nommé gouverneur de la Castille d’or, territoire recouvrant l’essentiel de l’actuelle Amérique centrale.
Leoncillo possède les mêmes qualités que son géniteur – courage, intelligence, discernement, générosité – et suscite une admiration semblable chez ses contemporains. Une différence de taille sépare cependant les deux bêtes. Si Fernández de Oviedo était le seul auteur à mentionner l’existence d’une solde attribuée à Becerrillo – « Y a-t-il plus grande ignominie pour un lâche que de voir […] une bête recevoir sa solde ? »23 – tous les chroniqueurs insistent sur les sommes versées à Leoncillo et le gain qu’en retirait Nuñez de Balboa, son maître.
Une fois la cinquième partie du butin prélevée pour le roi, Balboa partagea l’or entre ses compagnons ; et comme il y en avait beaucoup, tout le monde en eut et le chien Leoncillo eut même plus de cinq cent castellanos ; il gagnait en effet plus qu’un arquebusier pour le compte de son maître Balboa, mais il le méritait bien.24
[…] il gagnait ainsi une part de butin et parfois deux, comme les meilleurs guerriers, et on les payait à Nuñez de Balboa en or et en esclaves. Je sais qu’il en tira parfois plus de cinq cent castellanos que le chien gagna en parts de butin qu’on lui donna lors des offensives.25
Les soldes – voire les doubles soldes – gagnées au combat par Leoncillo contribuent à nourrir un anthropomorphisme déjà très présent dans les Chroniques, qui font du mâtin un guerrier comme les autres et, à de nombreuses reprises, un guerrier meilleur que les autres. En effet – et comme c’était déjà le cas pour son père – l’exaltation des prouesses de l’animal est souvent l’occasion de récriminer contre la fainéantise des hommes.
[…] et ce chien était tel, qu’il la méritait bien plus [sa part] que nombre de compagnons ensommeillés qui se vantent de ramasser sans rien faire ce que d’autres gagnent à la sueur de leur travail.26
Les mérites de Leoncillo, l’admiration dont il faisait l’objet, les comparaisons peu flatteuses et les parts remises à Nuñez de Balboa – qui diminuaient d’autant le butin à se partager – durent susciter quelques aigreurs parmi la troupe. C’est tout du moins ce que laisse entendre Fernández de Oviedo : la mort de Leoncillo fut malheureusement moins héroïque que celle de son père. « […] Puis, qui que ce fût, on donna au chien par jalousie une nourriture qui le tua. Quelques chiots de sa descendance demeurèrent mais on n’en vit plus aucun comme lui en ces contrées. »27
S’il n’est pas aisé de tirer des conclusions définitives des quelques informations qui sont arrivées jusqu’à nous concernant les chiens Becerrillo et Leoncillo, l’intérêt que les chroniqueurs ont porté aux deux animaux en tant qu’individus appelle quelques remarques.
Soulignons tout d’abord que, dans son acception de « dévoration par les chiens », le verbe aperrear ne fit son entrée dans les dictionnaires espagnols qu’en 1770, date à laquelle ce mode de mise à mort était irrévocablement tombé en désuétude. L’Académie espagnole donnait alors comme définition du terme : « Livrer quelqu’un à la férocité des chiens pour qu’ils le tuent et le dépècent. Cela fut pratiqué comme châtiment. Canibus lacerandum projicere »28. L’usage attesté dans les textes depuis le XVe siècle mit donc près de trois cent ans à intégrer les nomenclatures officielles : on peut légitimement se demander s’il ne fallait pas que le fait disparaisse pour que l’existence même du mot devînt acceptable.
Un processus parallèle semble avoir affecté les célèbres chiens de la Conquête dont les noms furent tus – sinon oubliés – durant plusieurs siècles. Deux raisons sans doute à cela : leur nature et leur fonction.
Tout d’abord, rappelons l’évidence : à titre individuel, celui qu’il est convenu d’appeler le meilleur ami de l’homme a laissé peu de traces dans l’Histoire. Bucéphale et Alexandre le Grand, Incitatus et Caligula, Babieca et Le Cid, Traveller et le général Lee : les noms des chevaux des grands hommes ont parfois traversé la barrière du temps. Mais qui peut seulement citer les noms d’un ou deux chiens illustres ?
Dans la partition entre animaux vils et animaux glorieux qui régit le rapport de nos sociétés occidentales au monde animal depuis le haut Moyen Âge, le chien mit fort longtemps à s’extirper de la première catégorie pour intégrer progressivement la seconde. Il est remarquable que les quelques noms de chiens célèbres que la plupart d’entre nous est à même de citer appartiennent tous au XXe siècle et qu’en très grande majorité – Milou, Lassie, Belle, Rantamplan, Rex, Snoopy, Pluto, Idéfix – ils relèvent du domaine de la fiction. L’une des seules exceptions à cette règle pourrait être la chienne soviétique Laïka, dont le nom resta célèbre pour être celui du premier être vivant mis en orbite autour de la Terre en 1957.
La fonction assumée par les molosses ibériques lors de la Conquête ne dut pas non plus jouer en faveur de leur popularité. En effet, pour un Becerrillo père et un Leoncillo fils, célébrés tant pour leur bravoure que pour leur discernement, combien de bêtes furent employées à terroriser aveuglément indigènes rebelles et populations pacifiques ?
L’historicisation des figures animales dépend directement du regard porté sur elles à une période donnée. Le désintérêt pour les chiens de la Conquête et l’occultation de leurs faits d’armes accompagnent fort logiquement l’évolution des sensibilités et des représentations liées à l’image de la colonisation castillane de l’Amérique. Ainsi, le rôle des chiens de guerre fut très tôt associé à ce qu’il est convenu d’appeler la « Légende noire » de la Conquête. Celle-ci commença à se répandre en Europe dès 1578 avec les traductions en hollandais de la Très brève relation de la destruction des Indes de Las Casas, puis surtout avec l’édition latine de 1598, illustrée par Théodore de Bry. Près d’un siècle et demi plus tard, les abus des conquistadors seraient dénoncés dans la lettre apostolique Immensa Pastorum du 20 décembre 1741, au cœur même de cette Église catholique pour laquelle les conquistadors étaient censés être allé évangéliser les autochtones.
Chronologiquement, Becerrillo et Leoncillo ont donc fait l’objet de deux projections consécutives : héroïques pour leurs contemporains, sanguinaires pour leurs successeurs, ils disparurent tous deux des livres d’Histoire jusqu’à une époque assez récente. On ne les retrouve au XIXe siècle que dans quelques ouvrages spécifiques. C’est le cas par exemple de la littérature militaire, comme la monographie consacrée aux chiens de guerre publiée par Édouard de La Barre Duparcq en 186929, ou encore dans des florilèges de récits animaliers, comme le Bestie delinquenti [1892] de Carlo d’Addosio30.
Il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle et l’avènement d’une historiographie latino-américaine qui prenne en compte ce que Nathan Wachtel appelait en 1971 La vision des vaincus31 pour que soit à nouveau reconnu – et dénoncé – le rôle de la gent canine dans la répression des populations autochtones et pour voir ainsi réapparaître les récits des hauts faits des chiens de la Conquista.