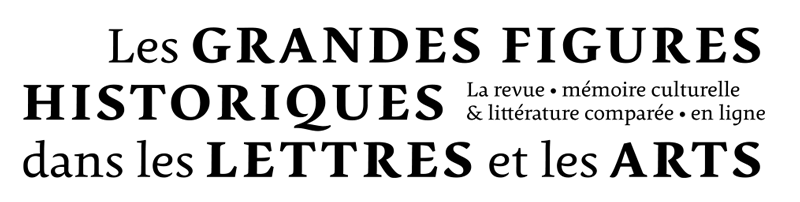divinæ particulam auræ
Horace, Satires, II, 2
Vie et biographie : voici le couple de mots autour duquel s’articule l’histoire de la pratique biographique scindée par une pliure centrale. À mont l’âge des Vies (de l’Antiquité au XVIIe siècle), à val l’âge des biographies (du XVIIIe à nos jours)1 : l’hellénisme tardif et moderne, d’origine savante, apparaît à la fin du XVIIe siècle, par emprunt au grec, pour désigner un ouvrage caractérisé par sa rigueur scientifique, supplantant ainsi le terme d’origine latine Vie, qui, passé depuis longtemps dans l’usage courant, rassemblait les anciennes formes de l’éloquence sacrée ou institutionnelle. Le régime ancien postule l’existence d’une continuité et d’une contiguïté temporelles entre le présent et le passé, et la supériorité de la relation historique (historia rerum gestarum) sur les faits historiques (res gestæ) eux‑mêmes, auxquels elle confère la puissance cognitive de la construction rhétorique ; le régime moderne, héritier des Lumières et de la Révolution industrielle, met en avant l’affirmation d’une coupure radicale entre le passé et le présent et la primauté des faits historiques sur la relation qu’en donnent les historiens, faisant ainsi du passé un objet de savoir plutôt qu’un répertoire d’exemples.
Se dessine donc une ligne de partage entre deux méthodes et, par voie de conséquence, entre deux visées dans les biographies consacrées aux écrivains : d’un côté, la critique rhétorique qui reste en deçà de l’homme (considéré comme un être dont l’identité demeure invariable et inébranlable), dans la mesure où elle dégage des caractéristiques de l’œuvre, elle‑même jugée à l’aune des lois du genre auquel elle ressortit, l’image d’un écrivain, autrement dit ce que la Poétique d’Aristote nomme ethos, c’est‑à‑dire le principe de cohérence psychologique et moral qui permet de rendre compte de l’ensemble des actions accomplies par une personne dans le cours de son existence ; de l’autre, la critique historique qui va au‑delà de l’homme (envisagé comme la partie d’un tout qui l’explique et qu’il représente), puisqu’elle cherche à reconstituer le milieu que l’écrivain a fréquenté, la période politique au cours de laquelle il a vécu et l’école littéraire dans laquelle il s’est inscrit, afin de dégager les lois générales dont son caractère résulte.
On situera l’ambition critique de Sainte‑Beuve au croisement de ces deux projets : d’un côté, le moraliste cherche à remonter à l’homme, en empruntant la voie des écrits intimes et privés, comme la correspondance, lus comme des aveux personnels ou des souvenirs autobiographiques, où la comédie aurait prétendument cessé, car l’écrivain y laisserait épancher son âme en liberté ; de l’autre, le naturaliste détecte les variétés, enregistre les variations, afin de reconnaître dans le caractère de l’écrivain étudié celui de la « famille » d’où il est issu et où son talent s’est formé, d’établir des regroupements à partir des accointances et des antipathies, d’inscrire son modèle dans une continuité historique tout en impliquant une ascendance2. La beauté d’un ouvrage ne dépend donc pas de sa fidélité à un modèle immuable ou de sa conformité à une grille explicative, mais d’abord et surtout de ses rapports avec l’« homme réel ». Toujours soucieux de se distinguer du « vulgaire des biographes3 », vivement irrité contre ce qu’il appelle la « superstition historique et biographique4 » qui s’intéresse aux reliques anodines d’un écrivain, Sainte‑Beuve a mainte fois répété son dédain pour l’érudition sèche et pesante : la biographie demeure un « vilain mot à l’usage des hommes, et qui sent son étude et sa recherche5 » ; on doit lui préférer l’esquisse élégante, l’ébauche suggestive, le croquis évocateur. « Ménagerie6 » pour Barrès qui la range aux côtés des pièces de Shakespeare et des romans de Balzac, « comédie littéraire7 » pour Albert Thibaudet, qui rappelle que ce promeneur a substitué à la critique de la chaire une « critica pedestris », les Portraits et Causeries s’apparentent à une formidable anatomie critique, source d’aperçus originaux et de vues profondes, où il s’agit moins d’opposer la critique de goût à la critique historique, que de fonder celle‑là sur celle‑ci8 : le geste de Sainte‑Beuve ne consiste pas à délaisser « l’ancien bon goût (en attendant le nouveau)9 », mais à l’annexer à de nouveaux paramètres comme la science historique. Son changement d’optique, il le résume en une formule : « Les biographes s’étaient imaginé, je ne sais pourquoi, que l’histoire d’un écrivain était tout entière dans ses écrits, et leur critique superficielle ne poussait pas jusqu’à l’homme au fond du poète10. » Le critique du xviiie siècle veut, comme le rappelle Mercier, « traiter l’auteur comme son livre11 », celui du siècle suivant prétend, tel Sainte‑Beuve, « aller droit à l’homme sous le masque du livre12 ».
Mélange subtil des scrupules de la science et des enchantements de l’art, de l’étude et de la méditation, de l’intelligence et de l’intuition, de la réflexion et de la suggestion, de la distance critique et de la connivence sensible, le genre biographique prétend faire synthèse des deux principes apparemment inconciliables qui consisteraient soit à faire de l’homme un système cohérent et compréhensible (mais faux) soit à rendre compte de ces agissements divers et contradictoires, suivant ainsi un projet ambitieux (mais illusoire). Pour étudier la nature ambivalente d’un genre qui est fils de Clio et Érato, pour cerner le génie particulier d’un critique qui avait choisi pour épitaphe « écrivain, auteur d’Élégies et de Portraits13 », on choisira d’organiser le propos autour de cette ambivalence : d’un côté, on verra comment la pratique de Sainte‑Beuve s’inscrit dans une ancienne et riche tradition (celle de l’éloge) qui lui sert de cadre structurel et de creuset imaginaire, de contexte de pensée et d’écriture, entièrement revivifié par les travaux de la science historique naissante ; de l’autre, on envisagera la manière dont le discours critique se présente comme le relais de la production poétique en prenant la forme d’un thrène élégiaque.
La « transformation de l’éloge académique »
S’il reconnaît le poids du modèle journalistique dans l’élaboration de cette nouvelle forme critique14, Sainte‑Beuve rêve d’une voie moyenne devant le paysage critique contemporain oscillant entre les éloges académiques condamnés à la pompe oratoire, qui ne peuvent donner qu’une image appauvrie et solennelle de la personne de l’auteur dont on fait le panégyrique, et les minces notices biographiques purement informatives qui se contentent de rappeler les principaux événements de sa vie, sans tenter de le faire revivre ou de percer le mystère de sa création poétique.
Autrefois il existait deux sortes de notices littéraires : l’une toute sèche et positive, sans aucun effort de rhétorique et sans étincelle de talent, la notice à la façon de Goujet et de Niceron, aussi peu agréable que possible et purement utile ; elle gisait reléguée dans les répertoires, tout au fond des bibliothèques ; et puis il y avait sur le devant de la scène et à l’usage du beau monde la notice élégante, académique et fleurie, l’éloge ; ici les renseignements positifs étaient rares et discrets, les détails matériels se faisaient vagues et s’ennoblissaient à qui mieux mieux, les dates surtout osaient se montrer à peine : on aurait cru déroger. J’indique seulement les deux extrémités, et je n’oublie pas que dans l’intervalle, entre le Niceron et le Thomas, il y avait place pour l’exquis mélange à la Fontenelle.15
À mi‑chemin des deux formes distinguées, on placera l’ancienne forme rhétorique de la Vie, et plus exactement l’éloge historique, dont la formule avait été inaugurée par Charles Perrault, poursuivie par Pellisson et d’Olivet dans les deux tomes de l’Histoire de l’Académie française et parachevée par d’Alembert et Fontenelle dans leurs Éloges d’académiciens. L’académicien, élu à la Maison des Lettres françaises le 14 mars 1844 au fauteuil de Casimir Delavigne et reçu le 27 février par Victor Hugo, voit ainsi dans l’éloge une forme supérieure de la critique capable de fixer les acquis de la tradition et de cultiver les vertus de la mémoire16.
Certes, on note déjà à la fin du xviiie siècle le déclin de « cette éloquence thuriféraire, débris des panégyriques du Bas‑Empire17 » au profit du portrait : que l’on songe aux études de Madame de Lambert, qui brosse le « Portrait de M. de La Motte » (1754) et le « Portrait de M. de Fontenelle » (1761), ou encore au Portrait de Jean‑Jacques Rousseau en dix‑huit lettres de Longueville (1779)18. À cet héritage en droite ligne, on préférera toutefois les parentés plus lointaines, les filiations indirectes et dérivées. Car la relation des articles de Sainte‑Beuve avec le massif encomiastique du siècle précédent, on ne cesse de la pressentir, puis de la ressentir, comme discrète et subtile. C’est de cette tradition que se réclame indirectement le critique, tout en cherchant à la renouveler à partir des recherches de la science historique naissante (notamment incarnée par Walckenaer ou Taschereau). Il prétend par solidarité d’âme et de goût avec l’orateur détenir quelque compétence rhétorique susceptible de faire discerner au lecteur les bonnes des mauvaises performances de ses contemporains. Il cherche par conformité d’esprit et de méthode avec l’historien à appuyer son étude sur les données sûres de l’archive et à inscrire son modèle dans un contexte historique, un milieu social, une école littéraire. De l’éloge, le critique conserve donc la brièveté de la forme qu’impliquent les contraintes éditoriales du journalisme : la méfiance à l’égard de la biographie bénédictine l’amène à refuser l’érudition historiographique pour lui préférer « une manière de coup d’œil sur des coins de jardins d’Alcibiade, retrouvés, retracés par‑ci par‑là, du dehors, et qui ne devraient pas entrer dans la carte de l’Attique19 » ; en somme « une forme commode, suffisamment consistante et qui prête à une infinité d’aperçus de littérature et de morale20 », un « aperçu, cette chose légère, [qui courrait risque d’être étouffé sous le document21 ».
Au lieu « des biographies minces et sèches » qui ont longtemps eu cours, il est réduit à apprécier les « larges, copieuses, et parfois mêmes diffuses histoires de l’homme et de ses œuvres », dont les premiers exemples avaient été offerts par les études que Ch.‑A. Walckenaer avait consacrées à La Fontaine (1820) et à Madame de Sévigné (1842‑1852) et celles que Jules‑Antoine Taschereau composait, à la même époque, sur Molière (1825) et sur Corneille (1829) – travaux auxquels il reconnaît un certain mérite dans la mesure où ils inventorient les fonds archivistiques propres à chaque auteur. Lisons, par exemple, l’hommage qu’il rend au biographe du fabuliste à sa mort :
L’ouvrage de M. Walckenaer, qui est resté modèle dans cette forme développée et pourtant limitée encore, est l’Histoire de la Vie et des Ouvrages de La Fontaine (1820). M. Walckenaer a le goût du complet, en même temps qu’il en a le moyen dans la diversité de ses connaissances. S’il parle d’un homme célèbre, il le voit dans sa famille, dans sa race, dans sa province, dans ses relations de toutes sortes ; s’il parle d’un des écrits de son auteur, il met de même cette production dans tout son jour ; il la rapproche des événements qui lui ont donné naissance ; il explique tout ce qui peut s’y renfermer d’allusions personnelles et de peintures de la société. Ainsi il a fait pour La Fontaine, et, sans excéder encore la mesure, il nous a donné de ce délicieux et grand poète une histoire animée, coulante, facile comme lui‑même et où il revit tout entier. Toutes les femmes qu’a aimées La Fontaine et qui le lui ont si bien rendu, qui l’ont recueilli, nourri et soigné dans les distractions et les oublis de sa vieillesse, ont leur place dans cette biographie de curiosité et d’affection. Quand on a lu ce volume, et qu’on a relu tous les vers que le biographe indique et qu’il rappelle, on sait tout de La Fontaine, on a été son ami, et l’on n’a plus, pour achever son idée, qu’à faire comme lui, à sortir seul en cheminant au hasard et à rêver.22
Aux yeux du critique, Walckenaer demeure « le plus ample, le plus instructif, et […] le plus serviable des biographes23 ». Aussi cet « Argus attentif24 », ce « grand investigateur biographe25 », est‑il remercié pour avoir le premier introduit « en France ce genre de grandes biographies à l’anglaise, qui a remplacé la notice sèche et écourtée dont on se contentait auparavant26 ». Biographe de seconde main27, Sainte‑Beuve condense dans un double mouvement, d’élagage du matériau historique et d’approfondissement de la réflexion critique, les copieux ouvrages documentés qu’il n’hésite pas à dénigrer par ailleurs, suivant ainsi deux étapes : le recensement des matériaux documentaires afin de connaître à fond le modèle à étudier et la condensation des renseignements recueillis en vue de dégager un caractère. Dans son article consacré aux Mémoires touchant la vie et les écrits de Madame de Sévigné, Sainte‑Beuve reconnaît que la « riche et copieuse biographie » a le mérite de l’abondance et la compare à « une promenade que nous ferions à Saint‑Germain ou à Versailles en pleine Cour de Louis XIV, avec d’Hacqueville pour maître des cérémonies et pour guide », l’ami de Madame de Sévigné qui sait le dessous des cartes et connaît tous les masques. En somme, cela donne un livre
plein d’intérêt et de longueur […] qui rendrait Madame de Sévigné bien reconnaissante et qui l’impatienterait un peu ; elle dirait de son d’Hacqueville biographe, comme elle disait de l’autre : « Il est, en vérité, un peu étendu dans ses soins. »28
En éclairant le lecteur moderne sur Madame de Sévigné et son oncle, sur ses amis et sa culture, Walckenaer aurait accompli le programme que Sainte‑Beuve appelait de ses vœux en 1829 :
Il semble qu’on ait tout dit sur elle ; les détails en effet sont à peu près épuisés ; mais nous croyons qu’elle a été jusqu’ici envisagée trop isolément, comme on avait fait longtemps pour La Fontaine, avec lequel elle a tant de ressemblance.29
Derrière l’éloge mitigé de cette catégorie de biographes par Sainte‑Beuve, qui salue à la fois l’envergure et l’exhaustivité du travail d’investigation, se profilent des critiques ouvertement adressées sur la forme et la manière adoptées, qui manqueraient à la fois d’art et de vie30. À sa biographie de la marquise il aurait oublié d’ajouter « la note juste du langage de ce temps‑là31 » :
Cette infidélité de ton, il l’aura en toute circonstance lorsqu’il parlera du grand siècle, et malgré sa familiarité si réelle avec les principaux comme avec les moindres personnages de ce beau temps.32
Le biographe chercherait à traduire, polir et moderniser les caractéristiques propres au style de ces écrivains et de leurs contemporains, contrairement à Sainte‑Beuve qui souhaite être fidèle à l’esprit de son modèle. C’est dire que l’ « élégance trompeuse33 » reposant sur « ces anachronismes de ton34 » qui se dégage des ouvrages de Walckenaer altère le portrait. En somme, si ces enquêtes remplissent les exigences d’honnêteté intellectuelle de premier niveau, elles manquent de satisfaire à l’exigence créatrice de deuxième niveau qui consiste pour un Sainte‑Beuve à donner la « fraîcheur du sentiment intime35 », qui s’acquiert par une lecture répétée et une étude délicate, où le critique cherche non seulement à connaître les faits positifs relatifs à l’écrivain et à l’époque dans laquelle il évolue, mais également à sentir et respecter son style. Ce que Sainte‑Beuve reproche à son contemporain, c’est cette incapacité de se dédoubler qui demeure à ses yeux la condition de toute critique et la saveur de toute lecture – « défaut général de l’époque où est venu M. Walckenaer36 », à en croire le critique, car le biographe conserve dans son écriture, même quand il veut peindre le « siècle de Louis xiv » « quelque chose de ce qui caractérise l’époque de Louis xvi37. » Ce trait caractéristique de l’esprit et de la méthode de Walckenaer a également été relevé par Joseph Naudet, qui ne lui refuse pas « l’exactitude de l’esquisse qui reproduit les détails les plus fins, les plus fugitifs, [… cette fidélité du daguerréotype, mais d’un daguerréotype vivant, qui aurait la vertu d’animer ses empreintes, de les faire mouvoir, et de nous entraîner à leur suite38. » À l’ « infidélité de ton » répond donc la « fidélité du daguerréotype ». Derrière l’opposition entre l’art rhétorique et l’érudition historique, se devine un enjeu d’ordre critique, car au style répond une méthode : d’un côté, un critique qui rend compte de la couleur du temps et des lieux ; de l’autre, un critique qui regarde son modèle à travers le goût et la mode de sa propre époque – l’un est un guide qui moyennant quelques citations bien prises fait repasser sous les yeux du lecteur les morceaux d’anthologie d’une œuvre considérée comme un trésor de sagesse ou de grâce ; l’autre est un traducteur, qui s’interpose continuellement entre le lecteur et l’auteur pour conférer aux expressions de ce dernier un air du temps39.
On dira ainsi que le critique renouvelle l’art encomiastique en puisant aux sources du savoir historiographique le plus exigeant qu’il cherche malgré tout à mettre à distance critique et réflexive. Devant la révolution qui a substitué le règne de la « notice érudite » à celui de l’éloge, le critique s’indigne :
L’ancien genre de l’Éloge académique est détrôné ; il a fait place décidément à la notice érudite, à la dissertation et à la dissection presque grammaticale de chaque auteur. […] Le danger serait, si l’on y abondait sans réserve, de trop dispenser le critique de vues et d’idées, et surtout de talent. Moyennant quelque pièce inédite qu’on produirait, on se croirait exempté d’avoir du goût. […] Se pourrait‑il que l’ère des scholiastes eût commencé pour la France, et que nous fussions désormais, comme œuvre capitale, à dresser notre inventaire ?40
La critique des monuments d’érudition de la science historique dessine en creux un aveu de préférence pour un tour à la fois libre et respectueux de la tradition. Cette nouvelle forme suppose à l’origine une attitude de sympathie à l’égard du modèle et une attention constante portée au public. Tantôt précis pour donner relief et présence à sa silhouette en indiquant certaines qualités ou failles, tantôt alerte pour ne pas entrer dans tous les détails, l’art du biographe consiste à marquer le trait et à entrer avec prudence dans certains replis, sans se laisser piéger par le menu des anecdotes : la gageure à relever consiste à « montrer l’homme au vrai, dégager ses qualités morales, son fonds sincère, sa forme de talent, sa personnalité enfin41. » La tâche de Sainte‑Beuve s’apparente davantage à celle d’un moraliste qu’à celle d’un historien ; son œuvre critique relève davantage d’une peinture des hommes de lettres que d’une encyclopédie des hommes illustres.
À ses yeux, le critique doit s’approprier le génie de son modèle, nouant ainsi une relation d’émulation que les orateurs cherchaient également à créer dans leurs productions. C’est dans la manière d’écrire de l’auteur, entendue progressivement comme une marque de la singularité individuelle42, que le critique recherche ce principe explicatif capable de dévoiler le mystère d’un auteur et de son œuvre. Cette posture est un gage de variété dans le cadre d’une galerie d’éloges académiques, si l’on en croit d’Alembert lui‑même :
J’ai tâché de donner à chacun la variété de ton et de style si nécessaire à ce genre d’ouvrage, pour en rompre la monotonie, pour rendre en même temps chaque éloge plus analogue et, j’ose le dire, plus ressemblant à celui qui en était l’objet. … J’ai quelquefois emprunté le style des différents académiciens qui, dans leur discours de réception, ont payé à leurs successeurs le tribut de louanges ordinaires, ou qui ont fait dans leurs ouvrages un éloge particulier de quelques‑uns de leurs confrères.43
On reconnaît volontiers que le charme de cette œuvre découle des effets d’échos subtilement ménagés entre le modèle critiqué et la plume du critique : Sainte‑Beuve colore son propre style, recherché et nuancé, composé de phrases longues, aux nombreuses incidences et fortes images (que Balzac raille avec joie dans sa nouvelle Un Prince de la bohème), du style de l’auteur dont il parle, pour mieux en dégager les caractéristiques profondes. Définir l’homme et l’œuvre avec les couleurs de sa palette, c’est un geste de sympathie hissé au rang de principe moral dans un exercice critique dès lors envisagé comme un dialogue fécondant. Mais l’on serait parfois bien en peine d’y lire une image fidèle du style de l’auteur dont on raconte la vie – preuve, s’il en fallait, que le pastiche opère par la médiation d’une représentation, celle que les biographes se font de leur modèle. Ne soyons donc pas dupe : c’est moins la réalité objective d’une écriture qu’ils imitent que l’image qu’ils en ont. Mais la qualité d’un écrit biographique se mesurerait au degré d’imitation atteint par le biographe vis‑à‑vis du modèle supposé. Avec Sainte‑Beuve, le critique abolit toute distance entre celui qui analyse et ses modèles jusqu’à devenir un « hôte perpétuel44 », cet acolyte en quête de quelque grande âme à épouser. Donnons à cette heureuse formule son sens plein, et ne faisons pas de ce critique une âme qui ne vit pas d’une vie personnelle, un talent pur sans caractère et sans conviction, qu’une facilité de vibration mettrait en état de mimer tout ce qu’il n’est pas. Le biographe n’existe que par et pour l’existence d’un autre dans une relation que Sainte‑Beuve résumait en la qualifiant d’ « âme seconde45 » dans Volupté – ce qu’on appellera le pacte lyrique de la relation biographique.
La continuation de « l’élégie interrompue »
À cette forme complexe, située à mi‑chemin du simple croquis allusif et de l’investigation érudite, Sainte‑Beuve imprime une dynamique singulière : celle de l’art élégiaque, ménageant ainsi à sa critique un baptême de littérarité.
Ce cadre où la critique, au sens exact du mot, n’intervient souvent que comme fort secondaire, n’est dans ce cas‑là qu’une forme particulière et accommodée aux alentours, pour produire nos propres sentiments sur le monde et la vie, pour exhaler avec détour certaine poésie cachée. C’est un moyen quelquefois, au sein d’une Revue grave, de continuer peut‑être l’élégie interrompue.46
Comprenons la dernière formule dans son sens étroit et précis : le poète cède le pas au critique, qui en retour rattache son activité à une riche et ancienne tradition poétique. Que retient‑il de l’élégie, genre diversement pratiqué à Rome, richement illustré au cours de la Renaissance et de l’âge classique ? Une double caractéristique qui fera la spécificité du portrait : une forme simple et souple oscillant aisément entre l’anecdote biographique et le tableau historique pour aspirer à l’universel à travers le parcours d’une singularité ; une visée de haute ambition, qui consiste à rappeler le souvenir de ce qui n’est plus pour apaiser le sentiment de la perte, combattre l’enfouissement dans l’oubli, soupirer la douleur causée par la mort.
Présenté comme le successeur, double et rival à la fois, de Chénier et de Lamartine, Joseph Delorme, sous les traits duquel on devine ceux de Sainte‑Beuve, esquisse son projet dans l’une de ses « Pensées » :
Et moi aussi, je me suis essayé dans ce genre de poème, et j’ai tâché, après mes devanciers, d’être original à ma manière, humblement et bourgeoisement, observant la nature et l’âme de près, mais sans microscope, nommant les choses de la vie privée par leur nom, mais préférant la chaumière au boudoir, et, dans tous les cas, cherchant à relever le prosaïsme de ces détails domestiques par la peinture des sentiments humains et des objets naturels.47
On le sait depuis le mot « profond » prêté à Leconte de Lisle et rappelé par Baudelaire, « tous les Élégiaques sont des canailles48 » dont il convient de se méfier. S’il signe en 1839 l’acte de décès du genre élégiaque en rattachant son succès aux formes propres de la sociabilité et de la sensibilité de l’Ancien Régime49, Sainte‑Beuve inscrit sa production poétique dans l’héritage des Élégies de Ramond De Carbonnières (1778), des Tristes de Nodier (1806), des Élégies et Chants élégiaques de Millevoye (mort en 1816), des Poésies de Chénier (publiées en 1819), des Élégies de Marceline Desbordes‑Valmore (1819 et 1825), des Méditations de Lamartine (1820)50. Et l’on devine que son œuvre relève moins de l’élégie molle du boudoir qui sent les bosquets de l’idylle ou de l’églogue, comme dans les Poésies érotiques (« vilain titre51 », dit Sainte‑Beuve, qui lui préfère celui d’Élégies) de Parny (1778) ou les Amours, élégies en trois livres de Bertin (1780), que de l’élégie domestique de la chaumière rehaussée par une visée morale. Ce projet poétique trouve son plein accomplissement dans l’activité critique de Sainte‑Beuve. Dira‑t‑on pour autant que cette continuation de plume et d’esprit qu’on ne cesse de deviner entre l’œuvre poétique et la production critique procède d’un essaimage des traits traditionnellement attachés à l’art élégiaque ? Et qu’en retour l’activité critique reconnue comme instance spécifique et autonome est dénaturée par la (trop ?) forte implication dans l’objet étudié, qui ne laisse guère la possibilité d’établir une science objective52 ? Non pas. Certes la transposition implique quelque effort d’adaptation, mais on fait le pari que chez Sainte‑Beuve l’élégie, « genre de composition naturel à l’homme53 », se renouvelle en s’approfondissant dans l’ « élégie d’analyse54 », où s’épanouissent à la fois la curiosité de son esprit, la solidité de son jugement, la profondeur et la finesse de son analyse.
Cette étiquette générique aux contours flottants, caractérisée par sa formidable variété thématique et formelle, et pour cette raison même ouverte aux expérimentations, permettrait de mieux comprendre l’union de deux tendances : le désir de rêverie poétique et l’ambition de réflexion critique. Sainte‑Beuve transporte au sein de chaque production cette bipolarité fondamentale : la perméabilité des frontières habituellement établies s’approfondit dès lors en une osmose fécondante55. La poésie s’ouvre sur des réflexions critiques, l’étude critique se pare d’ornements poétiques. À la conjonction de ces deux ordres se tient donc un créateur, qui de leur superposition, de leur interaction, tire profit pour exploiter toutes les ressources de l’art élégiaque. Du monument consacré à la mémoire du défunt qui console de la tristesse de la perte et calme les eaux du fleuve, on retiendra trois modalités qui permettent de mieux cerner les spécificités du discours critique de Sainte‑Beuve : la louange (laudatio) hissée au rang de « curiosité d’étude » et d’ « ouverture commode », de « penchant » et de « méthode56 », par laquelle il prétend toujours faire débuter la critique et qu’il retient dans la limite de la bienséance et de la vérité ; la lamentation (lamentatio) aux accents variés qu’il se garde bien de forcer, puisque loin des éclats de fureur et des cris de désespoir, sa plainte part en quête de l’expression la plus juste pour mettre à l’abri des accidents du temps le souvenir d’un homme et la mémoire d’une œuvre ; la consolation (consolatio) présentée comme l’ultime visée de l’activité critique, car si « des fibres saignantes furent à l’origine les premières cordes de la lyre57 », le critique, médecin de l’âme qui cherche, comme Joseph Delorme, « les regards consolants de quelques amis poëtes58 », doit déterminer la nature du mal souffert par l’écrivain et dont l’œuvre témoigne.
Dans l’imaginaire beuvien, les figures du poète et du critique s’unissent et se combinent, sans jamais se fondre complètement, dans celle du statuaire : tous cherchent à créer par le pouvoir éloquent du verbe ou la force ciselante du burin une image, reflet ou impression, de leur personnage afin de lui donner une seconde vie.
Si le statuaire, qui est aussi à sa façon un magnifique biographe, et qui fixe en marbre aux yeux l’idée du poète, pouvait toujours choisir l’instant où le poète se ressemble le plus à lui‑même, nul doute qu’il ne le saisît au jour et à l’heure où le premier rayon de gloire vient illuminer ce front puissant et sombre. À cette époque unique dans la vie, le génie, qui, depuis quelque temps adulte et viril, habitait avec inquiétude, avec tristesse, en sa conscience, et qui avait peine à s’empêcher d’éclater, est tout d’un coup tiré de lui‑même au bruit des acclamations, et s’épanouit à l’aurore du triomphe. Avec les années, il deviendra peut‑être plus calme, plus reposé, plus mûr ; mais aussi il perdra en naïveté d’expression, et se fera un voile qu’on devra percer pour arriver à lui : la fraîcheur du sentiment intime se sera effacée de son front ; l’âme prendra garde de s’y trahir : une contenance plus étudiée ou du moins plus machinale aura remplacé la première attitude si libre et si vive. Or, ce que le statuaire ferait s’il le pouvait, le critique biographe, qui a sous la main toute la vie et tous les instants de son auteur, doit à plus forte raison le faire ; il doit réaliser par son analyse sagace et pénétrante ce que l’artiste figurerait divinement sous forme de symbole. La statue une fois debout, le type une fois découvert et exprimé, il n’aura plus qu’à le reproduire avec de légères modifications dans les développements successifs de la vie du poète, comme en une série de bas‑reliefs. Je ne sais si toute cette théorie, mi‑partie poétique et mi‑partie critique, est fort claire ; mais je la crois vraie, et tant que les biographes des grands poètes ne l’auront pas présente à l’esprit, ils feront des livres utiles, exacts, estimables sans doute, mais non des œuvres de haute critique et d’art ; ils rassembleront des anecdotes, détermineront les dates, exposeront des querelles littéraires : ce sera l’affaire du lecteur d’en faire jaillir le sens et d’y souffler la vie ; ils seront des chroniqueurs, non des statuaires ; ils tiendront les registres du temple, et ne seront pas les prêtres du dieu.59
Cette comparaison entre la critique biographique et l’art du statuaire, si récurrente au milieu du xviiie siècle jusqu’aux premières décennies du siècle suivant60, rattache Sainte‑Beuve à la plus noble tradition encomiastique. « Imagier des grands hommes61 », à la fois tuteur et protecteur des disparus et des oubliés, qui érigea des monuments de papier aux hommes de lettres, le biographe en dette avec les morts assumerait une magistrature des tombeaux : Exegi monumentum ære perennius. Médiateur ou passeur, le critique brosse le portrait d’un écrivain comme s’il « passait quinze jours à la campagne à faire le portrait ou le buste de Byron, de Scott, de Goethe62 » ; il s’assimile à ce « chantre lyrique, véritable prêtre comme le statuaire, [qui décernera au milieu d’une solennelle harmonie les louanges des vainqueurs63 ». En rapportant le portrait au genre in memoriam du tombeau qui connut une nouvelle vigueur au moment où les Romantiques redécouvrirent la Renaissance, Sainte‑Beuve rappelle l’une des fonctions essentielles de la critique, perçue comme un relais censé faire barrage au temps. En reconstituant le souvenir d’une âme disparue, le biographe offre un passeport pour la reconnaissance susceptible de sauver le défunt de l’oubli et de l’inscrire dans l’éternité, comme le suggère déjà la figure ailée de la Renommée, mi‑ange mi‑femme, gravée en tête du recueil de Vasari, que Georges Didi‑Huberman propose de lire comme la figure même de l’historien, soufflant dans sa trompette pour ressusciter les morts et veiller sur leur gloire64.
Aussi peut‑on rappeler la distinction de méthode et de visée que Sainte-Beuve opère entre la critique consacrée aux Anciens et celle consacrée aux auteurs contemporains dans la préface de ses Portraits littéraires : avec les premiers, on sait moins, mais l’on dit plus et l’on dit vrai ; avec les seconds, on sait plus, mais l’on dit moins et l’on dit « avec le sous‑entendu des amitiés et des convenances65. » Malgré l’éloignement temporel présenté comme un gage de franchise pour le critique et de vérité pour l’historien, le sens d’une œuvre ancienne et le caractère d’un auteur ancien sont malaisés à pénétrer et à saisir : l’analyse procède par conjecture probable, par hypothèse plausible, sans jamais pouvoir donner quelque assise stable et sûre au jugement. La distinction est développée et approfondie dans deux articles : d’abord, à l’ouverture de son portrait consacré au comte de Rémusat, le critique rappelle qu’il ne peut prétendre pénétrer plus intimement les Anciens « que le premier venu qui en parla avec aplomb et d’un air de connaissance », mais qu’il peut saisir « l’idée, l’air du personnage » contemporain grâce à son entourage, ces « témoins de la ressemblance66 », capables de garantir la validité du jugement ; ensuite, au début d’un de ses articles consacrés à Chateaubriand, il admet qu’avec les Anciens le critique est condamné à « commenter l’œuvre » et « rêver l’auteur et le poète à travers » et qu’avec les Modernes la critique a un autre devoir : « connaître et bien connaître un homme de plus, surtout si cet homme est un individu marquant et célèbre67. » À mi‑chemin entre les patronymes grandioses unanimement et perpétuellement admirés et les noms médiocres susceptibles de ne causer que de la pitié, se tient une catégorie intermédiaire peuplée d’« hommes en partie célèbres et en partie oubliés, dans la mémoire desquels, pour ainsi dire, la lumière et l’ombre se joignent », des écrivains jadis célèbres, encore recommandables, mais aujourd’hui presque oubliés, dont le nom « passe de la bouche ardente et confuse des hommes à l’indifférence, non pas ingrate, mais respectueuse, qui, le plus souvent, est la dernière consécration des monuments accomplis68 » :
les auteurs eux‑mêmes m’apparurent en songe, accompagnés de toute la foule des ombres poétiques dont le temps a dispersé les restes et nivelé les tombeaux. Et puisque c’est un rêve qui se dessine à ma pensée, en ce moment, qu’on me laisse continuer d’y rêver. – C’était, je vous assure, un lamentable spectacle que celui de toutes ces ombres une fois illustres, et qui elles‑mêmes en leur temps, à des époques éclairées et florissantes, avaient paru distribuer la gloire et l’immortalité, – de les voir aujourd’hui découronnées de tout rayon, privées de toute parole sonore, et essayant vainement, d’un souffle grêle, d’articuler leur propre nom, pour qu’au moins le passant pût le retenir et peut‑être le répéter.69
Au cours de cette vision, où défile une procession d’écrivains dépouillés de leur lustre, détrônés de leur chaire, destitués de leur gloire, le critique perçoit le sens ultime de sa mission : le nouveau couronnement de ces hommes errants, déjà presque oubliés, mais promis à une résurrection qui leur assurera une nouvelle vie, plus sereine, dégagée des préoccupations du temps. Tout « grand homme » peut succomber à une double mort : la disparition physique et la chute dans l’oubli. C’est contre cette seconde mort que les biographes agissent : la mémoire que suppose leur activité est gage de vie éternelle. La loi universelle de la société qui consiste à se détourner naturellement des gloires d’un jour pour fréquenter d’autres lieux, le critique en tire ainsi leçon et profit : placé à distance critique et réflexive de l’écrivain et de son œuvre, il peut formuler un jugement rétrospectif plein de mesure et de clairvoyance capable de corriger les sentences maladroites ou insensées. Si l’admiration la mieux méritée pour un écrivain ne peut rien contre la force irrésistible de l’oubli, le souffle élégiaque saura l’en sortir en constituant un point d’amarrage qui autorise le repos à son âme qui sans ce simulacre aurait été condamnée à divaguer70. Au cœur de cette rêverie intime, le critique retrouve indirectement la leçon du pseudo‑Longin qui invitait chaque auteur à supposer qu’il est en présence des plus grands écrivains pour ainsi avoir le passé devant soi et l’avenir dans son dos71, et la sagesse d’une fable ancienne chantée par l’Arioste dans son Roland furieux (xxxv) et rappelée par Francis Bacon dans son De dignitate et augmentis scientarum (ii, 7) : à l’extrémité du fil des Parques, on trouve suspendue une médaille sur laquelle est gravé le nom de chaque défunt. Le temps emprunte les ciseaux d’Atropos, coupe le fil, retire les médailles, les emporte avec lui et les jette dans le cours du Léthé. Autour de ce fleuve voltigent une infinité d’oiseaux qui saisissent ces médailles à leur chute ; puis les tenant dans leur bec et les promenant çà et là, les laissent tomber par mégarde dans le fleuve. Mais parmi ces oiseaux, il est quelques cygnes qui saisissent telles de ces médailles et les portent aussitôt dans un temple consacré à l’immortalité. Dans cette logique de remémoration et de commémoration destinée à prendre acte d’un passé ainsi mis à distance et offert à la méditation, le critique conjure l’oubli pour créer une communauté de sympathie où chacun fait l’expérience intime de son humanité sensible.
Ne croyons pas que le portraitiste attribue à son personnage un caractère inébranlable. « Nous sommes mobiles, et nous jugeons des êtres mobiles72 » : telle est la devise empruntée à Sénac de Meilhan que Sainte‑Beuve place en exergue des Portraits contemporains. D’où l’adoption d’un style varié d’expressions et de rencontres pour un critique qui ne craint pas de mettre en avant la contradiction et le désordre des sentiments qui agitent et égarent les individus. « Quand on aime à étudier les hommes et à les voir tels qu’ils sont, on ne saurait s’accoutumer à ces statues symbolisées dont on menace de faire les idoles de l’avenir73. » À la bipartition traditionnelle de la notice biographique (vita et mores) se substitue ainsi une distinction chronologique et critique qui structure le récit et la pensée. Convaincu de la « duplicité74 » de chaque homme et persuadé que l’œuvre littéraire est une comédie où l’auteur prend un masque et crée une image de soi, Sainte‑Beuve s’engage à dévoiler une vérité, morale et psychologique, en distinguant « dans les ouvrages de tout grand auteur ceux qu’il a faits selon son goût propre et son faible, et ceux dans lesquels le travail et l’effort l’ont porté à un idéal supérieur75 », à retrouver ce qui relie l’« existence première, obscure, refoulée, solitaire » à la « seconde existence, radieuse, éblouissante et solennelle76 » : la vie de La Fontaine est partagée en deux moitiés, « l’une élégante, animée, spirituelle, au grand jour, bercée entre les jeux de la poésie et les illusions du cœur ; l’autre, obscure et honteuse, il faut le dire, et livrée à ces égarements prolongés des sens que la jeunesse embellit du nom de volupté, mais qui sont comme un vice au front du vieillard77 » ; celle de Fontenelle laisse entrevoir deux personnages, le « bel esprit » des ruelles, « à l’esprit mince, au goût détestable », se piquant de composer des églogues et des opéras, et le « grand esprit » de l’Académie des Sciences investi de la dignité de sa fonction « disciple de Descartes en liberté d’esprit et en étendue d’horizon », qui s’articulent si étroitement qu’on peut retrouver « l’un jusqu’au milieu de l’autre.78 »
Pour le biographe en quête d’un principe fondateur susceptible de récapituler toutes les causalités antérieures et d’y appuyer toutes celles qui suivent, l’objectif est clair : repérer le point initial qui constituera le nœud d’une existence et, par voie de conséquence, le mystère d’une œuvre. Selon les goûts et les esprits des critiques, les mots diffèrent pour désigner cette quête continuelle d’un foyer mystérieux où résiderait la clef de l’écrivain. Se déploie ainsi une même ambition à travers l’histoire : cerner et percer le caractère profond et intime d’un homme illustre à partir du repérage de thèmes récurrents et l’élucidation de motifs personnels. D’où la visée morale ou psychologique censée couronner cette quête. Pellisson, premier historien de l’Académie française, n’avoue‑t‑il pas déjà en 1653 qu’il a « cette faiblesse d’étudier souvent dans les livres l’esprit de l’auteur beaucoup plus que la matière qu’il a traitée79 » ? Gabriel de Mably rappelle aux historiens qu’ils doivent s’intéresser au portrait du personnage historique et à la « qualité dominante qui ne l’a jamais abandonné, mais, qui comme un Protée, a pris des formes différentes80 » ; Thomas invite les orateurs à dégager du modèle célébré « l’idée unique et primitive qui a servi de base à toutes ses idées », car les « grands hommes » se font « un principe unique et général dont toutes leurs idées ne sont que le développement81 ». En vue de réduire les diverses étapes d’une vie à un principe général d’organisation et de compréhension, Sainte‑Beuve part en quête de « la clef de cet anneau mystérieux, moitié de fer, moitié de diamant82 ». Cette clef ne résout pas toutes les énigmes, mais constitue un « noyau » qui permet au lecteur de considérer de l’intérieur l’ensemble de l’œuvre d’un auteur. Ni constructive ni dogmatique, la critique ne vise qu’à expliquer celle‑ci à partir de ce que les linguistes anglo‑saxons appelleront un pattern – doublon de ce que Sainte‑Beuve préfère nommer le « mot de prédilection, qui revient fréquemment dans le discours et qui trahit par mégarde, chez celui qui l’emploie, un vœu secret ou un faible83 », où l’on peut déjà deviner ce que la plume aux accents moins métaphoriques et plus scientifiques de Taine appellera la « faculté maîtresse84 » dont il fera un des instruments majeurs de sa réflexion théorique. Quelle que soit l’époque dans laquelle il s’inscrit, le milieu au sein duquel il évolue, le genre dans lequel il s’illustre, le biographe vise un primum mobile qui justifie et couronne sa quête, l’algorithme d’une vie où le secret d’une âme se révèle. Quel que soit le moyen d’y parvenir, l’explication par les causes extérieures et circonstancielles ou la compréhension par intuition des motifs et des fins, la visée est identique : rechercher la voie d’accès au caractère d’un individu. « J’admets volontiers, affirme Sainte‑Beuve dans un article consacré à Taine,
que chaque génie, chaque talent distingué a une forme, un procédé général intérieur qu’il applique ensuite à tout. Les matières, les opinions changent, le procédé reste le même. Arriver ainsi à la formule générale d’un esprit est le but idéal de l’étude du moraliste et du peintre de caractères[…].85
Ne voyons là rien de dogmatique : certes, il existe « une loi supérieure des événements » qu’il convient de dégager, mais les hommes demeurent incapables de la saisir et de la formuler, car « la clef qu’on croit tenir nous échappe à tout moment86. » N’attendons de sa part aucun exposé organisé autour d’une pensée systématique, où chaque article est le maillon d’un ensemble qui le dépasse : « rien n’est tout à fait simple dans la nature des choses, et il ne faut pas, en tirant du personnage l’idée essentielle, ne voir en lui que cette idée87 », nous prévient Sainte‑Beuve, hanté par la conscience d’un hiatus entre l’homme et l’écrivain, que la méthode biographique espère et désespère tout ensemble de pouvoir réduire, visant à satisfaire l’exigence rationnelle d’une continuité entre ces deux instances, sans parvenir toutefois à abolir tout sentiment de discontinuité.
Si Boileau fait naître l’acte critique au sein de sa création poétique, Sainte‑Beuve prolonge le chant poétique dans sa réflexion critique. Dans les deux cas, c’est dans et par l’activité critique que se manifeste la conscience d’une autorité intellectuelle et pratique – cette « conscience intérieure que chaque talent porte naturellement » et que le critique parvient à porter au dehors « dans la personne d’un ami, d’un juge assidu qu’on respecte88 ». Cette activité n’est donc pas un « pis‑aller89 », autrement dit : un genre compensatoire par rapport aux genres proprement littéraires. Dans la célèbre « Pensée » introduite dans la deuxième édition de Joseph Delorme (1830), Sainte‑Beuve établit une distinction entre les œuvres littéraires dispersées et isolées et l’art critique ondoyant comme une rivière autour d’elles :
L’esprit critique est de sa nature facile, insinuant, mobile et compréhensif. C’est une grande et limpide rivière qui serpente et se déroule autour des œuvres et des monuments de la poésie, comme autour des rochers, des forteresses, des coteaux tapissés de vignobles, et des vallées touffues qui bordent ses rives. Tandis que chacun de ces objets du paysage reste fixe en son lieu et s’inquiète peu des autres, que la tour féodale dédaigne le vallon, et que le vallon ignore le coteau, la rivière va de l’un à l’autre, les baigne sans les déchirer, les embrasse d’une eau vive et courante, les comprend, les réfléchit ; et, lorsque le voyageur est curieux de connaître et de visiter ces sites variés, elle le prend dans une barque ; elle le porte sans secousse, et lui développe successivement tout le spectacle changeant de son cours.90
Prêt à tout accueillir, à tout embrasser, le lecteur prend l’allure d’un voyageur curieux, d’un nomade disponible, d’un homme qui ne se pique de rien pour goûter à tout. De cette « pensée » articulée autour de cette élégante métaphore filée, se dégagent les principales caractéristiques que la critique doit revêtir pour aborder ses modèles : la mobilité et la souplesse de son approche supposent une puissance d’adaptation devant les reliefs de ce paysage sinueux ; la fluidité et la labilité de son style impliquent un pouvoir de réflexion (en forme de reflet) devant les massifs de ce décor varié. Ce que faisant, la critique prend le chemin de l’« éloge historique » et de l’« élégie analytique91 » pour cerner les contours (et tenter de percer) « ce sceau unique de diamant, dont l’empreinte se reconnaît tout d’abord, qui se transmet inaltérable et imperfectible à travers les siècles, et qu’on essayerait vainement d’expliquer ou de contrefaire », cette « perle qui brille encore aussi pure aujourd’hui qu’à l’heure de sa naissance92 », « cette parcelle qu’Horace appelle divine (divinæ particulam auræ), et qui l’est du moins dans le sens primitif et naturel93 », cette part de mystère attachée à toute création artistique et vouée à demeurer insondable malgré la force de cette critique hissée au rang de science humaine.