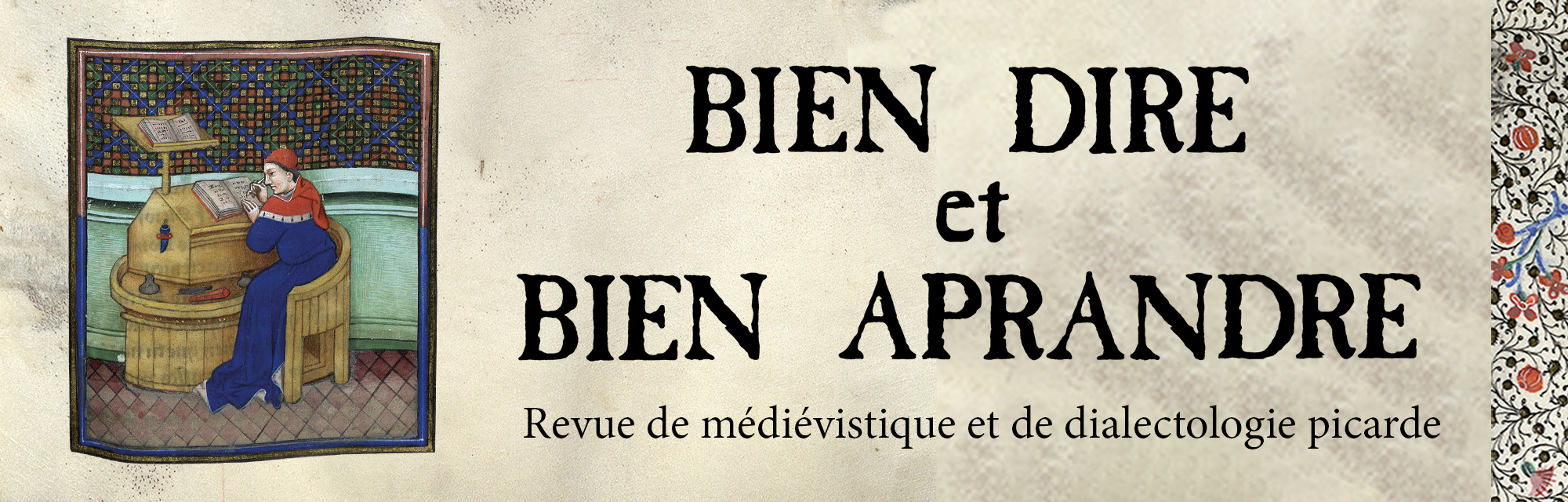La tradition
Le cycle d’Othovien s’ouvre vers la fin du xiiie siècle par une chanson en octosyllabes intitulée Romanz d’Othevien (dorénavant RO), se poursuit au xive siècle avec l’amplification en 18500 alexandrins intitulée Florent et Octavien (dorénavant FO) et continue avec une longue mise en prose datée de 1454, Othovyen, qui relève de FO et qui rattache à Othovyen la Chanson de Florence de Rome en alexandrins. Il existe, enfin, une deuxième rédaction en prose, intitulée Florent et Lyon (dorénavant FL), transmise par l’editio princeps datée de 1500, qui puise directement de la version en octosyllabes1. La tradition textuelle des quatre rédactions françaises est la suivante :
RO2
Oxford, Bodleian Library, Hatton, ms. 100 (moitié du xiiie siècle).
FO3
Paris, BnF, ms. fr. 1452 (première moitié du xve siècle) ;
Paris, BnF, ms. fr. 12564 (1461) ;
Paris, BnF, ms. fr. 24394 (1455-1456).
Othovyen4
Bruxelles, KBR, ms. 10387, olim 177, datant de 1454-1467/695 ;
Chantilly, Musée Condé, ms. 652 (2e moitié du xve siècle) ;
Orléans, Bibliothèque municipale, ms. 466 (2e moitié du xve siècle) ;
Paris, Bnf, ms. n. a. fr. 21069 (2e moitié du xve siècle) ;
Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. L-I-14, xve siècle, fragment (ce manuscrit a été partiellement détruit durant l’incendie de 1904)6.
FL7
Lyon, Martin Havard, 1500 [editio princeps] ;
Paris, Jean Janot, s.d., ante 1522 ;
Lyon, Olivier Arnoullet, 1526 ;
Lyon, Olivier Arnoullet, 1532 ;
Paris, Alain Lotrian, s.d. (ca 1530/1540)… (15 témoins au total).
Il existe également deux versions en moyen anglais8 et une rédaction en allemand (Octavianus. Ein schöne vnd Kurtzweilige Hystori von dem Keyser Octauiano, Strassburg 1535)9. Enfin, deux versions italiennes du récit sont insérées, au xive siècle, dans les Storie di Fioravante et, au siècle suivant, dans les Reali di Francia d’Andrea da Barberino10.
Le récit
D’après le texte-souche, le récit est le suivant :
La mère du roi/de l’empereur Othevien fait croire à son fils que son épouse est adultère ; à son instigation, l’empereur fait bannir la reine et ses deux jeunes enfants. Peu après leur départ, un singe ravit l’un des deux bébés, et l’autre est emporté par un lion ; Florent, est vendu à un bourgeois, Climent, tandis qu’Othovien retrouve sa mère ; avec le lion, qui s’était laissé attendrir par les supplications de la dame et lui avait rendu l’enfant, il va à Jérusalem. Le roi Dagobert, menacé par le Sultan d’Iconium, appelle le roi Othevien à son secours ; Florent, qui ne supportait guère l’existence menée chez Climent, se mêle à la bataille et tue le Roi des géants. Il tombe cependant amoureux de la fille du Sultan, Marsabile, qui avait été promise justement à l’adversaire de Florent, et tente de l’enlever. Entretemps, Dagobert livre bataille ; l’armée d’Othevien se trouve en grave difficulté mais finalement, grâce à l’intervention de saint Denis, les Sarrasins sont vaincus par Dagobert ; toutefois, Othovien et Florent ont été faits prisonniers. À ce moment, le jeune Othovien, au service du roi d’Acre, vient en France dans l’espoir que ses parents se réconcilient ; apprenant que le roi Othevien et Florent sont assiégés à Paris, il les secourt et les délivre. Enfin, l’impératrice reconnaît ses fils et pardonne à l’empereur son mari, puis Florent épouse Marsebille et Othevien regagne Rome avec sa famille réunie.
Dans RO, Othevien est décrit comme l’initiateur de la glorieuse époque de l’Empire, même si cette époque est en réalité fictionnelle, car le conte est situé au temps du roi des Francs, Dagobert. En fait, RO et ses suites s’insèrent dans un cycle narratif comprenant Charles le Chauve, Theséus de Cologne et Ciperis de Vignevaux, c’est-à-dire des chansons qui représentent toutes le roi franc à différentes époques de sa vie11.
La critique a débattu autour du fait que RO soit effectivement un romanz ou, plutôt, une chanson de geste : dans l’incipit et dans l’explicit RO se présente comme un romanz bien que, comme l’écrit François Suard, « le texte, par son contenu et son style, [soit] une chanson de geste : le poète la présente comme telle, et le copiste lui-même est sensible à son style, puisqu’il découpe son texte en séquences cohérentes qui commencent par une lettrine, comme s’il s’agissait de laisses12 ». De son côté, Noëlle Laborderie pense qu’« en effet bien que l’auteur vante sa ‘bonne chanson’ (début et v. 4770 sqq.), c’est bien à un roman que nous avons affaire, le roman des aventures et des amours de Florent, dans lequel deux souverains se partagent les rôles nobles13 ». Pour ma part, malgré le choix de l’octosyllabe fait par le poète, je partage l’avis de Suard14.
Dans sa partie initiale, l’histoire s’inspire du motif de l’épouse persécutée, qui eut un grand succès à l’époque des chansons dites « tardives », y compris celle, fragmentaire mais célèbre, de la Reine Sebile, épouse de Charlemagne, ou celle de Florence de Rome, rattachée à Othovyen dans la tradition manuscrite de cette version15. Ce corpus de textes inclut également un autre motif à succès se combinant traditionnellement au premier : la dispersion familiale et sa réunion successive, d’après un schéma fondamental dans cette typologie narrative16.
Le roi Othevien, homologue de Charlemagne dans le récit de Sebile, occupe un rôle central, notamment au début du récit, car, suite aux accusations d’adultère commis avec un valet et adressées à la reine par la mère du roi, ce dernier bannit sa femme qui venait d’accoucher de jumeaux, Florent et Othevien le jeune17. Peu après intervient le motif de la séparation : Othevien le jeune est enlevé par un lion qui deviendra par la suite son fidèle compagnon, tandis que Florent est enlevé par un singe18. À partir de ce moment, chaque membre de la famille sera confronté à son propre destin, jusqu’à la réunion qui se réalisera après plusieurs années. L’un des archétypes de ce schéma narratif qui en assura une très large diffusion est la légende de saint Eustache, dont la famille fut dispersée peu après la conversion du général romain Placidas et réunie peu avant que le martyre final ne s’accomplisse19. Le succès non seulement de cette hagiographie, mais également des textes inspirés de la légende d’Eustache, est prouvé par la présence de plusieurs œuvres développant ce motif, à partir de l’Apollonius de Tyr20. L’un des textes français les plus connus inspirés de la vie du saint romain est le roman du Pseudo-Chrétien intitulé Guillaume d’Angleterre (dorénavant GdA, xiie siècle) où, à l’instar du saint, une triple injonction divine invite le roi Guillaume à quitter son royaume et tous ses biens : le roi part avec sa femme Gracienne, enceinte de jumeaux et, après une période d’exil, elle accouche dans une caverne. À partir de ce moment, la famille est séparée et, non sans surprise de la part du lecteur, Guillaume se transforme en marchand accompli sous le pseudonyme de Gui, tandis que ses enfants sont élevés par des bourgeois aux coutumes pas très raffinés mais à l’esprit fort pratique. Ainsi, dans ce roman entre puissamment en jeu une aventure mercantile qui ne concerne pas uniquement les enfants, lesquels se révoltent contre les pères adoptifs respectifs sous l’impulsion de leur nature noble. En revanche, il suffit de rappeler que c’est grâce à son habileté que Gui « redevient » Guillaume, à savoir roi d’Angleterre, en démontrant mériter les biens qu’il possède grâce au dur travail de marchand et en faisant fructifier son capital sans avoir recours à l’usure. Au-delà des analogies, lorsqu’on compare le récit du GdA à celui du RO, on remarque une différence macroscopique : dans le cas du RO la séparation familiale est la conséquence immédiate de la décision d’Othovien et non de Dieu21. Suite à cette action, l’empereur ne participe qu’indirectement aux souffrances et aux pérégrinations de sa famille, bien qu’il se montre chagriné et se repente de son acte. Cela implique, au moins dans l’immédiat, l’exclusion du personnage des aventures individuelles auxquelles les autres membres de la famille sont soumis durant leur périple. En revanche, ces derniers ont la possibilité de vivre des aventures individuelles qui, d’ailleurs, auraient été impossibles sans la funeste décision du roi.
L’expérience marchande occupe dans le RO un rôle moins central par rapport au roman de Crestien, bien qu’elle aussi concerne le « vrai » personnage principal du texte, dans ce cas Florent22. Par rapport à son frère Othevien, l’expérience de Florent ne peut pas être mise en relation avec l’aventure individuelle de Guillaume, s’approchant davantage de celle vécue par les fils du roi d’Angleterre : Marin et Lovel23. En effet, durant l’aventure de Florent la parodie de la bourgeoisie marchande mais, surtout, la caricature du vilain restent présentes et, bien que différemment conçues par rapport au roman de Crestien – où l’on distingue nettement entre le bon bourgeois/marchand et le vilain proprement dit – elles permettent de façonner efficacement le personnage de Climent, père nourricier de Florent24. D’abord il suffira d’observer que, par rapport à d’autres vilains de la littérature française médiévale, Climent n’est pas traité comme une créature déformée. En revanche, si l’on revient à l’un des homologues les plus proches et célèbres du changeur parisien, à savoir Varochier, malgré les services rendus par ce dernier à Sebile et à son fils Louis, on ne lui épargne pas l’exagération des détails physiques25. Au contraire, Climent et sa famille sont présentés très dignement :
Climens li vilein[s] l’acheta,
Bien le norri et le garda,
Il et sa famme le norrirent,
Et baptisier en fons le firent ;
Florent le firent apeler.
Climens, come l’oï conter,
Un enfant out et bel et gent,
Gladouains l’apelent la gent.
Ambedui furent conpainons,
Mes Florens sembloit plus frans hons.
[…]
Climens estoit bien [a]aisiés,
A sain Germain fu herbergiés,
Ses hosteaus fu et bons et beaus
Et clos de tours et de quarneaus26.
Le poète a voulu sortir d’un cliché exploité auparavant en octroyant à son personnage, un marchand prospère, une plus grande marge d’évolution et de compatibilité par rapport au milieu naturel de Florent et qui, à partir de FO, augmentera ultérieurement27.
L’un des éléments marquant l’aventure de Florent est le fait qu’elle commence par une vente presque aux enchères du nourrisson par des larrons ; en outre Climent, décrit comme au cuer enterin28, achète littéralement l’enfant que les malfaiteurs avaient volé au chevalier. À son tour, ce dernier s’était battu au pris d’un bras et d’autres blessures sérieuses afin de sauver le nourrisson d’un singe. Dans cette scène, l’utilisation du lexique concernant le profit n’est pas ménagée, s’agissant justement d’une question de bonnes ou de mauvaises affaires : dans RO, Climent fait une offre aux larrons considérée comme folle par les confrères de l’aspirant père : Cent perpres d’or pour lui dona29, ce qui lui attire des inévitables moqueries : « Deniers avés a bon marchié, / bien avés vostr’or enploié »30. Dans FO, l’achat de Climent vaut un besant d’argent fin, ce qui lui coûte également les railleries de sy cousin, auxquelles s’ajoute le mestre de la nef31, qui réclame sa part :
« J’en veul avoir ma part et aussi fait Guerin ».
Et Guerin respondi : « Non fais, par saint Martin,
Je n’ay cure d’enfant par delés mon coyssin,
Quar ils ne font que braire de vespre et de matin ;
S’il en avoit sept tans pour ung seul estellin,
Ma part j’en quitteroye pour un seul pot de vin32 »
Dans FL : incontinent sont venuz lesditz larrons au port de la mer ou ilz ont trouvé plusieurs marchans qui demanderent aux larrons se l’enfant vouloyent vendre, et iceulz respondirent : « Seigneurs, pour vendre le portons nous33 ». Le premier marchandage au prix de dix livres échoue mais, comme on le sait, Climent transgresse la règle du métier et donne trente escus d’or, malgré les railleries s’ajoutant au montant faramineux qu’il vient de débourser. Par la suite, on remarquera la même insouciance de l’argent chez Florent, cette fois-ci aux dépens de Climent, bien évidemment. Dans ce dernier cas, la transgression même pour l’achat de Florent constitue une qualité en soi, s’approchant de la noblesse du fils adoptif. La transgression constitue probablement un lien paradoxal entre ces deux personnages dont les destins, rendus initialement incompatibles par leurs origines, convergeront de plus en plus par la suite.
Les motifs insistant sur le gain et sur l’argent fonctionnent en tant que présage du rapport très difficile, voire dramatique, que Florent aura avec la vie marchande qu’on tentera de lui imposer en vain : en effet, la nature du jeune homme s’avère trop enracinée en lui pour qu’il puisse s’adapter à des métiers « de nourriture », tels que boucher ou changeur. Au contraire, dans le GdA, en présence du marchand qui l’aidera à se remettre débout après la perte de sa famille, le roi exilé ne recule pas devant les métiers les plus humbles :
« Eur me di, Gui, que sez tu feire ?
Savras tu mes chevaus torchier ?
Et mes anguilles escorchier ?
Savras tu mes oisiaus larder ?
Se tu sez ma meison garder
Et tu la sez bien feire nete
Et tu sez mener ma charreite,
Donques desserviras tu bien
Ce que je te donré dou mien ».
« Sire », dist Guiz, « je ne refus
Tout ce a faire et ancor plus ;
Ja de faire vostre servise
Ne troiveroiz an moi faintise34. »
S’agissant de tâches les plus misérables dont un serf puisse s’acquitter, la dégradation sociale acceptée sans hésitation de la part d’un roi met en évidence le choix apparemment contradictoire avec sa condition d’origine, ainsi qu’une forte valeur exemplaire permettant de faire ressortir le fond hagiographique sous-jacent. En définitive, à travers les mésaventures de Guillaume, dans cette partie de son roman, Crestien façonne un personnage rappelant le Christ qui accepte, obéissant, les souffrances qui lui ont été imposées par une volonté et des fins supérieures. En revanche, malgré leur reconnaissance, les enfants Marin et Lovel – élevés ensemble sans savoir qu’ils étaient frères – ont du mal à se conformer aux projets de leurs beaux-parents et quittent finalement les maisons des vilains après avoir été battus suite à leur refus. Comme on le verra, le topos concernant l’explosion de colère et de violence du vilain concernera également Florent, suivie par une réconciliation successive, une fois que Climent acceptera la nature du jeune garçon et comprendra les inévitables implications de ce fait. Par rapport au refus obstiné de la part des jumeaux de se soumettre aux métiers choisis par les vilains dans le GdA, Florent essaie, au moins, de suivre les indications de Climent, mais la réussite est toujours très, voire trop « chevaleresque ».
Florent : un enfant « illégitime »
Une partie peu étudiée du récit concerne la justification de Climent en présence de sa femme à propos de son retour de la Terre Sainte accompagné d’un enfant et d’une nourrice. La question, visiblement délicate, détermine précisément des différences au sein du cycle ; dans toutes les versions du cycle Climent achète l’enfant, lui trouve une nourrice et tous les trois se rendent à Paris où le nourrisson est présenté aux bourgois et à sa femme. Certains détails varient, comme l’on peut constater grâce au résumé suivant :
| RO, v. 520-536 | FO, t. 1, v. 896-902 | Othovyen, fol. 15va-vb | FL, fol. 10 |
| « Et por les sains de Beliant Et que avoie a fere d’enfant ? Porter le m’esteut a mon col, Bien me puet l’en tenir por fol. » Et puis dist aprés : « Ne me chaut, Se Diex l’ament, [molt] bien le vaut, Onques ne poi avoir enfant. » Un ane achete maintenant, Si a l’enfant de suis chouchié, Puis a tant quis et porchacé Que norrice li a trovee […] Puis se met Climens au chemin, Einsint son erre tret au fin Tant qu’il est a Paris venus. |
Climent […] jure dame Dieu et sainte Katherine Que nourrir le fera par amour vraye et fine. Pour iceluy garder loua une meschine A qui il donna roube et pelliçon d’ermine […] Tant quë a Paris fu, la cité belle et fine. |
Bien avés oÿ par cy devant comment Climens vint a ung port de mer et comment il achetta l’autre enfant qui par le singe fu emportés et depuis par l’escuier rescoux et comment Climent l’apporta en son hostel a Paris, puis le fist baptisier et ly mist non Flourent. | « Il ne m’en chaut gueres car l’enfant vaut bien le pris, et aussi ma femme n’a que un enfant. Je ne sçay s’il est vif ou mort, car il n’avoit que deux ans quand je vins outre mer et se je le puis porter jusques a Paris, je le feray nourrir et feray a croire a ma femme qu’en Hierusalem l’ay engendré. Et si mon fils est trespacé, cestuy sera mon confort et de luy je feray mon heritier ». Et loua une nourrice […] et ne cessa de cheminer jusques a ce qu’il vint a Paris. |
Dans FL, on anticipe le problème de justification de l’existence de l’enfant en apportant des modifications au récit du modèle, à savoir RO : l’autre fils de Climent, Gladouain, est né deux ans avant le départ du père en Terre Sainte et Climent trouve opportun de dire à sa femme qu’il a procréé Florent à Jérusalem. De plus, ignorant si Gladouain est mort ou vif, il songe à faire de Florent l’héritier de tous ses biens. Voyons la suite du récit :
| RO, v. 537-552 | FO, t. 1, v. 903-912 | Othovyen, fol. 15vb | FL, fol. 11 |
| Quant il fu des borjois veüs, Si li dient tuit : « Bien vengniés ! Ou fu cist enfes gaaingniés ? ». Climens respont : « Outre la mer, La l’ai fait norir et garder ». […] Sa famme reçust bonement Lui et l’enfant a molt grant joie : « Un tel enfant bien norriroie. » L’enfant a enbracé et plore, Et le besoit [tot] sant demore, Qu’ele cuidoit por verité Que l’enfant eüst engendré Climens qui l’avoit aporté. L’enfant norrist par grant amor Por l’amistié de sen seingnor. |
La [à Paris] luy fit on grant feste, ne cuidés que devine ; Climent dit a sa femme qui ot non Eudeline, Que cest enfant venoit de terre alexandrine Et qu’i l’olt engendré en une Sarrazine. « Sire, s’a dit la dame, ce soit en bonne estrine ! Or avés vous deux hoirs, si croist votre racine : Quant de moy departistes, il ha longe termine, Ensainte me lessate, or ay fait ma gesine D’ung filz qui vous ressemble de corps et de poitrine, Clodoain a nom, de Paris est sa marrine. |
Moult bien le fist nourir aveuc ung sien enfant qu’il ot de sa femme et tant qu’il vint en l’eage de .xv. ans. | Alors Clement […] vint a Paris ou il fut receu honnestement de tous ceulx qui le congnoyssoient et sur tout de sa femme. Plusieurs luy demanderent ou il avoit prins cestuy bel enfant, et le bon Clement leur disoit que oultre la mer l’avoit gaigné et que il le faisoit a ceste femme nourrir pource que sa mere estoit morte, « dont j’ay au cueur grant douleur, car [s’]elle fust en vie deça la mer, l’eusse admenee. Si me convint louer ceste nourrice que est d’estrange terre ». Atant le bon Clement s’en alla a sainct Germain des Prez a son plus beau manoir qu’il avoit et sa femme le receut moult noblement et de bon cueur, et eut grant joye de l’enfant et de la nourrice, car elle creoyt fermement que Clement l’eust engendré. L’enfant nourrit par grant amour pour l’amour de son mary et le firent baptiser, car ilz doubtoyent qu’il ne le fust pas. Et fut appellé ledict enfant Florent. |
Le motif des origines de Florent est fort problématique : refusé par Octavian, il est acheté et adopté par Climent lequel, en revanche, ignore comment expliquer à sa femme la présence du nourrisson suite à un long pèlerinage. D’après RO, au moment de son départ le bourgeois n’avait pas d’enfant (onques ne poi avoir enfant), ce qui justifie l’achat impulsif de Florent. Ce détail a été modifié dans FL, où Climent est au courant de l’existence de son premier fils. De sa part, FO rend explicite le fait que Climent dit a sa femme qui ot non Eudeline, / que cest enfant venoit de terre alexandrine / et qu’i l’olt engendré en une Sarrazine, sans que cette nouvelle ne vienne perturber Eudeline, qui annonce à son tour avoir accouché d’un garçon ressemblant – au moins lui ! – à son père, de corps et de poitrine. Pour revenir au RO, on remarque que la femme, à la vue de Florent, le besoit [tot] sant demore, / qu’ele cuidoit por verité / que l’enfant eüst engendré / Climens qui l’avoit aporté. Donc, d’un côté Climent ment sur l’achat d’un enfant à un prix démesuré, en préférant opter pour la solution d’une maîtresse sarrasine que, dit le marchand dans FL, « s’elle fust en vie deça la mer, l’eusse admenee ». Cependant, on a du mal à croire que la femme de Climent aurait mieux accepté l’achat de l’enfant par rapport à l’éventualité qu’il ait été conçu par son mari et par une étrangère inconnue : ce qui compte pour le bourgeois est de faire croire qu’il s’agit de son fils naturel et, sa femme étant persuadée de ce fait, l’enfant norrist par grant amor / por l’amistié de sens seingnor. Dans FL, l’importance de cette machination est mieux explicitée : ne sachant si son fils est vif ou mort, Climent songe à un héritier légitime. La nature du vilain et celle de Florent rendront néanmoins impossible la réalisation de ce projet, car si le premier voit d’une part comme condition nécessaire le fait que son fils soit une image de Climent même, de l’autre, malgré tous ses efforts, Florent ne saura que le décevoir, au moins jusqu’au moment où le père nourricier et surtout sa femme comprendront qu’il « ne vos apartient […] il n’a cure de vostre avoir35 ».
En définitive, la naissance de Florent pose problème dans la mesure où elle est soupçonnée d’être le fruit d’un adultère, soupçon avancé d’abord par son père naturel. Par la suite, sa mère adoptive doit croire qu’il a été engendré en Terre Sainte, ce qui est également faux ! Sans vouloir trop idéologiser cet expédient narratif, les liens familiaux de Florent sont bien compliqués dès le début : il s’agit d’une prémisse visant à préparer le public aux difficultés du garçon à s’adapter aux conditions de vie qu’on lui imposera jusqu’au moment où sa nature rendra impossible tout type de soumission aux souhaits de Climent36. On peut donc parler d’un héros prédestiné, bien sûr, tel qu’il est décrit, par exemple, dans FO :
Et ot a non Florent, no livre le destine.
Molt fu bon chivalier et de grande aastine,
Puis fit tant de beaux faiz sur la gent appoline,
Et conquit deux royaulmes qu’il ot en sa saisine37.
Dès son achat et son adoption, Florent se présente également comme un « anti-héros prédestiné », au moins jusqu’a ce qu’il devienne prisonnier des liens familiaux fictifs qui en faisaient le fils bâtard d’un vilain aisé. À ce propos, peut être tirée une autre conclusion : si l’on tient compte des accusations portées par la mère d’Octavian à la reine et, indirectement, par le roi son fils, on dirait qu’à l’époque de la rédaction de notre corpus, le fait qu’une femme ait des enfants illégitimes était interprété différemment par rapport à l’époque actuelle38. En revanche, Climent ne se pose pas la moindre question lorsqu’il prétend avoir « engendré » Florent avec une sarrasine et ce fait ne scandalise guère sa femme, qui accueille le nourrisson por l’amistié de sens seingnor. Cette tolérance relève du fait qu’au Moyen Âge, l’attitude envers les bâtards n’était pas uniquement négative39. En outre, le lien de sang avec Climent aurait mieux « légitimé » l’insertion de Florent au sein de la nouvelle famille par rapport à l’adoption suite à l’achat, cette légitimation étant visiblement un réel souci du bourgeois. Donc, Climent est, par rapport à Florent, un faux père naturel mais, en réalité, il est un père adoptif. De sa part, Florent est à la fois un enfant abandonné (par Othevien), trouvé (par le Chevalier, les larrons et Climent), puis vendu (par les larrons), bâtard (de Climent) et adopté (toujours par Climent). C’est donc à partir d’un tel cadre que la suite des ses (més)aventures du garçon s’explique et se déroule40.
L’épisode de l’épervier
Le parcours de Florent, à travers une réalité qui ne lui appartient pas et qui tend à l’exclure, commence par l’épisode de l’épervier : Florent est envoyé chez un boucher avec deux bœufs ; une fois en route, il tombe sur un
Escuier bien asenné,
Seant sor .I. corant destrier,
Sor son poing ot .I. espervier41.
Florent est immédiatement attiré par l’épervier, l’un des symboles les plus connus de la chevalerie, tant et si bien qu’après avoir reçu une réponse méprisante de la part de son propriétaire (si l’a si durement ramponé / […] « mainés avant, ne targés mie, / vos bues jusqu’en la boucherie42 »), il répond à son tour :
« Hé beaus amis, ce dist Florent,
Si m’aït Diex omnipotent,
Que je ne soi a chief venir ;
Ice vos di je sant mentir
Que volentiers l’acheteroi43 »
Finalement, l’escuier accepte d’échanger l’oiseau contre les bœufs et Florent, joians et liés, s’en va et la coue li aplanoit44. Bien évidemment, lorsque le jeune homme rentre chez lui avec l’animal et sans les bœufs, Climent le réprimande durement, en suscitant l’amusement du public lorsqu’il exclame :
« Mauvés garcon, mal eürés !
Estes vos rois ne dammoiseaus,
Por acheter si fais oiseaus ?
Ce doient porter chevaliers
Et damoiseaus et escuiers45 ».
Les vers finaux de ce passage soulignent la valeur sociale de l’escoufle alors que, dans la vision du vilain, Florent se retrouve exclu des groupes mentionnés par Climent : chevaliers, damoiseaus et escuiers46. Finalement, Climent lui dit :
« Voire, biax fieuz, gardés le bien,
Tot riches encore vos fera ;
Ore mangés ce qu’il vos donra47 »
Si l’on réfléchit au système de valeurs auquel l’oiseau renvoie, la référence au manger est presque triviale, donc amusante. Dans FO se trouve une digression intéressante : l’escuier sans scrupules profite de la naïveté de Florent et, une fois le marché conclu,
Sy luy a dit : « Amis, aiez vraie fïance,
Il mangüe bien pain et lait pour sa soustance ;
Par nuyt a la gïolle sera sa demourance ;
Et s’il advient demain qu’aiez vo desirance
D’aller voller au champs, faittes sans detrïance
Que de pain et de lait soit emplie sa pance,
Plus le laissiez voller par dessus unne branche
Et vous serés dessoubz, et n’aiez ja doubtance
Qu’a vous retournera par droitte accostumance,
Oyseaulx apportera de sy grant habundance
Que plains vo chaperon et plaines vostre manche
En arez tous lez jours sans nulle deffaillance ».
« Amis, se dist Florent, par saint Denis de France,
Vees cy tres bon oysell, j’aye malle mescheance
Se le donnoie point pour tout l’or de Constance48 ! »
La conséquence de cette modification narrative est qu’une fois apporté l’oiseau à la maison, Climent écoute le discours de son fils adoptif puis, ayant compris que ce dernier a été dupé, il s’en prend plutôt au vendeur : « Tres mal jour luy doint Dieu, qui marchande ensement49 ! ». Dans cette version, l’écuyer ressemble davantage à un mauvais marchand qu’à un écuyer ; de son côté, Florent insiste en rassurant son père, en manifestant une fois de plus toute sa naïveté :
« Pere, se dit Florent, ne vous courrouchiés noyant,
Quant vo corps et le mien verrons l’esbatement
Et arés des oyseaulx assés et largement
Sans avoir autre cher, je le sçay vrayement50 »
La conclusion de l’aventure est prévisible : l’oiseau refuse toute proposition de nourriture qui ne lui convient pas et, l’épreuve de la chasse arrivée, il se lance à la poursuite d’une hirondelle, tant et si bien que :
[…] Ly oyseau s’en va et a queilli le vant,
Huymais ne le tenrront qu’il puist certainement51.
Comme on l’a vu, la douceur de Climent vis-à-vis de Florent est l’une des caractéristiques distinctives de FO par rapport à RO : d’après le vilain, la faute du mauvais marché ne tombe pas sur le jeune homme trop naïf, mais sur l’écuyer, car « moult s’est mocqué de vous cilz qui en fist la vente52 ». Une telle attitude protectrice pousse le vilain à mentir à sa femme qui, par contre, ne ménage pas l’ironie, spécialement lorsqu’elle dit :
« Dieu ! que de beaux oyseaulx no sire nous presente !
Vo filz est bon merchant, voz bienz mest bien a vante,
Il nous honnira tous, Dame Dieu le gravente !
Oncques ne fist proffit d’une seulle poutente53 »
Climent répond à son tour que :
« Noz oyseaux est venduz, ne vous demantez sy,
Car j’en doy .XXX. livres recepvoir merquedi
D’ung escuier qui est au Seigneur de Nully.
Vous m’en pouvés bien croire ». Quant la dame l’öy,
Cuida qu’il die vray54.
Interpréter Nully comme nului ‘aucun, personne’ est, peut-être, tendencieux, mais le vers suivant, « vous m’en pouvez bien croyre » en relation avec un mensonge manifeste invite à aller dans cette direction, d’autant plus que, comme on l’a vu dans la partie du récit concernant le retour de Climent de la Terre sainte, ce dernier est bien capable de mentir d’une façon assez « créative », pour ainsi dire.
Par rapport à son modèle, FL ajoute un passage concernant la première rencontre de Florent avec un boucher qui se rattache plutôt à FO et à O. Il s’agit d’une digression plutôt comique et qui souligne la distance, impossible à combler d’ailleurs, entre le fils d’un roi et un boucher. Ce dernier, après avoir écouté le discours du jeune homme, oppose un refus très dur, bien que masqué du rire et motivé, probablement, par la richesse paternelle que Florent affiche naïvement :
Et lors Florent fist son plain commandement, les deux beufz print et s’en alla jusques a la boucherie, ou il trouva ung escorcheur et tantost luy demanda ou il pourroit trouver le maistre des bouchiers, car a luy veult parler. Et l’escorcheur regarda Florent et puis il luy dist : « Voulez vous boucher devenir ? ». « Ouy sire », dist Florent, « car mon pere est assez riche qui me baillera assez, vaches, beufz, veaulx et pourceaulx, aigneaulx, chevreaulx et de gras moutons. Je veulx le mestier apprendre, car il me dist au soupper que l’on y faict d’un denier trois, et aussi on y menge de bons lopins et boit on vin blanc et vin clairet, ainsi que mon pere me le dist ». Adonc l’escorcheur fort se print a rire de Florent et incontinent luy dist par grant mocquerie : « Le diable vous fist icy bien venir pour apprendre a estre bouchier. Ja par Dieu boucher ne serez, ne ja ne coupperés chair de beuf ne de mouton. Allez vous pendre au gibet et vous ostez d’icy, ou de ce boyau qu’en ma main je tiens vous donneray parmy la joue »55. Adonc Florent la figue luy fist en disant : « Vecy pour toy je m’en revoys a mon pere qui a vous parlera56 ».
Dans Othovyen, Climent demande à Florent :
« A quel mestier vous voldrés que je vous mette. – Peres, ce dist Flourens, puisque c’est vostre plaisir, je voldroye estre bouchiers, car je me sens assés fort que pour avoir la maistrise sur ung boef que ja sy fort ne sera que eschapper me puist pour tant que par la corne le puisse tenir ». […] Alors Climent vint a ung sien compere qui son bouchier estoit et lui dist : « Beaux comperes, je vous amaine ycy ce josne filz que pour le mettre aveuc vous demourer, adfin que vostre mestier sache aprendre57 ».
Florent commence à travailler la cuingnye a son col apprés son maistre, mais malgré son enthousiasme, est aussitôt distrait par la vue des jeunes écuyers montés sur chevaulx sur cez genés d’Espaigne en poursaillant par les rues, les espreviers et faulcons sur les poingz en demenant grant bruit58. Cet événement marque le fils du roi qui, peu après, décide de vendre les deux bœufs qu’on lui avait confiés afin de les mener vers la boucherye pour acheter l’épervier, comme on le sait. L’écuyer, dépourvu de toute honnêteté, est devenu dans cette version un faulconnier qui, en voyant bien celui a qui il avoit afaire […] luy dist : « Mon amy, je veul que de cy en avant soyés marchant d’oiziaulx59 ». Cette rédaction suit FO, mais avec des différences sur lesquelles il est intéressant de s’attarder. Voyons le passage suivant :
Quant Climent oÿ que Flourent ot donné deux boefs pour l’oysel, il fu moult esbahy et dist : « Mal jour doinst Dieux a celuy qui ainsy vous a apris a marchander ! – Peres, ce dist Flourent, ne vous tourblés, car demain nous sarons que l’oysel sara faire ». Climent commencha ung pou a sousrire60…
Le sousrire du marchand laisse comprendre que ce dernier était averti dès le début du risque qu’il avait couru en envoyant le fils chez son compere boucher. En effet, même lorsque l’épervier s’échappe, l’attitude de Climent correspond à celle d’un père patient qui constate la déception de ses enfants, plus qu’à celle d’un vilain ruiné, au point que
Il escria en hault et dist : « Enfans, retournés a l’ostel, car pour nient attendés apprés l’oysel, car jamais ne le verrés ! ». Moult dolant furent ly doy enfant quant ainsy veirent leur oysel perdu, sy s’en retournerent a l’ostel. Alors Climens dist a Flourens : « Biaux filz, or voy je bien que vous avés perdu nostre argent, car il fauldra bien que lez deux boefs que avés donné pour l’oysel que je le rende a vostre maistre61 ».
Dans FO, après avoir durement critiqué le père à cause de son avarice (« par ma foy, s’il fust mort, je fusse bien joyant, / j’eusse deniers toujours assés de demeurans62 »), Florent mène deux bœufs a l’iscourcheüre, sans qu’on fasse mention de leur provenance. Par conséquent, suite à l’échange malheureux avec l’épervier et à la fuite de ce dernier, Climent ment à sa femme en lui racontant avoir vendu l’oiseau au seigneur de Nully et
La se sont demouré jusques au samedi.
Florent achete ung beuf pour tüer sans detry,
Pour vendre le dymanche, adonc s’est reverti,
Droit a la boucherie s’en vint, je vous affy.
Je ne sçay pour quel cause comance leur estry,
Mais ly ung des bouchiers le ber Florent fery
De la paulme en la joe tant que sanc en sailly63.
En revanche, dans Othovyen, le sens du conflit entre Florent et le boucher est explicité :
Flourens fu moult dolant de son oysel qu’il ot perdu et fu a l’ostel de Climent trois jours que bonnement n’osoit retourner a l’ostel de son maistre de peur de estre truffés et mocqués des varlés de la boucerye. Flourens fist tant qu’il eult argent a Climent, sy achetta ung boef, lequel il amena a la boucherye pour tuer et quant ly bouchiers veyrent que Flourens revenoyt et sy ne ramenoit que ung seul boef, ly ungs vint vers lui et lui dist : « A ! faulx garchon, il y a trois jours que avons attendu apprés vous ! ». Et en ce disant il assist son poing sur le visage de Flourent et tellement que le sanc luy fist saillir par bouche et par nez. Et quant Flourens se senty feru, il fu tourblé, sy haulcha la cuygnye et aconsievy celui qui l’ot feru de tel force qu’il lui abatty le brach et l’espaulle et se sy tost n’euist esté secourus, il le euist parochis64.
Apparemment, le récit fait plus sens dans cette version que dans FO où, au contraire, on se contente de motiver le conflit entre le jeune homme et le boucher avec le très vague vers : je ne sçay pour quel cause comance leur estry.
L’épisode du destrier
Par rapport à la mésaventure marchande de l’épervier, la suivante faillit coûter encore plus cher à Florent, notamment du point de vue de sa propre intégrité physique. Climent confie à son fils Gladouain la tâche d’apprendre à Florent le métier de changeur qui est, en effet, le métier paternel ; les garçons se mettent en route avec un montant considérable à leur charge mais, encore une fois, l’occasion se présente au moment le mois opportun : un marchand se promène avec un palefroi magnifique qu’il a l’intention de vendre. Bien évidemment, Florent ne peut pas s’opposer à sa propre nature, il se dirige donc vers le marchand et, contre toute prudence qu’un tel achat aurait imposé, il demande :
« Amis, vendriés vos le destrier ?
Dites por conbien le donriés,
Vesci le deniers tout contés65 »
Le vendeur profite immédiatement de la naïveté du jeune homme et, comme dans le cas de l’épervier, demande trente livres. Cependant Florent n’estime pas ce prix suffisant :
Li enfes dist : « Estes vos ivres,
Qui me le faites trente livres ?
Ne veil pas que vos i perdés :
Quarante livres en avrés66 »
Le marchand n’en croit pas ses oreilles, il remercie donc de Diex qui en la Croiz fu mis67 et, l’argent empoché, livre le cheval au garçon, puis
Li marcheans s’en va fuiant,
Regardoit soi molt durement,
Que l’enfes aprés ne venist
Et le destrier ne li rendist.
Mais li enfens n’[en] out talent,
Ains se regardoit durement,
Florens molt forment se doutoit
Por le marcheans, qu’il venoit,
Qu’il ne li rendit ses deniers.
Ensi fu chascun esmaiés68.
L’inquiétude réciproque et l’étonnement des deux personnages clôt parfaitement l’une des scènes les plus humoristiques de la chanson : en même temps, ce virage sur la caricature nous prépare au parcours d’émancipation de Florent du contexte « vilain ». Revenons donc à Florent et à son cheval : le garçon, tout heureux, rentre chez lui en caressant doucement la croupe de l’animal, mais se trouve devant Climent et sa femme assis pour le dîner. À la vue du cheval, on pressent immédiatement le frisson du vilain :
Climens le voit, si l’apela :
« Que ce, beaux fiux, por le cor Dé ?
Si beax destrier qui t’a doné ? ».
« Pere », dist Florens li sennés,
« Tos vos deniers j’ai donés ;
Ore ai je bien ces enploiés,
Cent livres vaut de bon deniers69 »
D’abord Climent est saisi par le désespoir le plus pur, puis
Lors sailli sus de maintenant,
A .II. poins a saisi l’enfant
La l’eüst malement batu,
Quant sa famme li a tolu70.
La femme de Climent a tout compris : on ne peut pas attribuer la moindre faute à Florent qui, dit-elle, « ne vos apartient », car « nature, espoir, li fait entendre / a ce qu[e] il devroit aprendre. / Il n’a cure de vostre avoir71 ». Climent se repent de son acte et se réconcilie aussitôt avec Florent qui, obéissant, lui répond :
« Pere », dist il, « ore m’entendés :
Mes peres estes, si me batrés
Totes les fois que vos voldrés72 ».
J’ai déjà souligné que l’obéissance vis-à-vis du père adoptif, malgré le sentiment de révolte et le dégoût devant certaines tâches imposées ou devant certaines attitudes – notamment l’attention excessive à l’argent –, est l’un des traits communs aux textes suivant le schéma narratif de la dispersion familiale. Par contre, dans FO se trouve un passage intéressant dont j’ai fait rapidement mention auparavant et qui, sauf erreur de ma part, n’a pas de correspondance dans RO et dans FL. Florent est envoyé apprendre le métier de boucher, alors que le vrai fils du vilain, Clodoain,
[…] Fu au change seans
Pour avoir mains de paine, quar nature est tirans
Et donne que on ayme tousdiz mieulx ses enfans
C’om ne fait les estranges, quar le cueur habundans
Est toudiz par nature par raison enclinans
A ce qui de son sanc et de luy est yssans73.
Peu après, l’auteur décrit Florent qui, la congnie a son col, est tellement beau que tout le monde l’admire. De sa part,
| FO, t. 1, v. 1302-1314 | Othovyen, fol. 16ra |
| Florent les entendoit, si en fu molt joyant ; Mes quant veoit passer ces chivaliers puissans […] A luy mesmes disoit : « Dieu ! Tant je suis dolans ! Mon pere a tant d’avoir et tant d’or reluisant, Encore a en son change plus de mille besant Et oncques il ne fu sur un destrier montant, Tout adés se maintient ensi comme ung truant, Il ne me lest chaucier fors que ces souliers grans Et celle lee coste qui tant m’est let estant ; Par ma foy, s’il fust mort, je fusse bien joyant, J’eusse deniers toujours assés de demeurans ». |
« A ! biaux sire Dieux, mon pere est tant rice et puissant d’avoir et sy en a a son change plus de mile mars d’or et oncques jour de sa vie fu sy larges que de avoir ung cheval qui fust sien, car tant est eschars qu’il ne s’oze nulz biens faire ; ce lui procede de villenye quant a ce mestier m’a volu mettre. Certes, se je puis ne say, je le feray marvoyer, car je voy qu’il me tient tant vil : quelz solers, quel robe grise me fait il porter ? A paines le daigneroit porter ung truant ! Par ma foy, s’il estoit mors, je l’aroye tost oubliet, car je aroye argent fuison pour moy tenir joly comme je voy les aultres ». |
En effet, un tel raisonnement ne semble pas avoir été conçu par quelqu’un plein d’enffance, comme Florent avait été décrit durant sa rencontre avec le valet qui lui avait vendu l’épervier. On penserait plutôt à la condition de ces cadets ou exclus de l’héritage – n’oublions pas que le fils naturel du vilain est Gladouain – obligés d’attendre la mort du père pour obtenir une indépendance économique et sociale74.
Dans notre cycle les liens familiaux sont bouleversés, comme on le sait, donc tout doit être interprété à un autre niveau. Or, si d’un côté l’apparence de Florent en tant que vilain aux souliers trop grands suscite spontanément le rire et l’empathie, de l’autre la considération finale sur la mort de Climent et sur l’obtention de son héritage semble très cynique et, apparemment, contradictoire par rapport aux prémisses. En définitive, malgré le pardon réciproque et l’amour paternel et filial mutuellement affichés, la séparation entre Florent et la famille adoptive reste nette, davantage soulignée qu’édulcorée par le ton humoristique. Alors, bien que le rôle assigné à Climent dépasse par son importance les frontières habituelles dans lesquelles le vilain était traditionnellement confiné dans les textes français de l’époque, la caricature reste la même dans tous les cas en contribuant, par contre, à l’un des épisodes les plus réussis du cycle, dont je parlerai par la suite75.
Le retour à la « nature » et l’héritage d’Audigier
Après sa deuxième expérience marchande, Florent peut enfin prouver sa valeur chevaleresque sur le champ de bataille où, du reste, il sera moins en danger qu’entre les marchands/vilains – pour lesquels il n’est qu’un corps étranger – et, surtout, qu’entre les mains de son père nourricier, exaspéré par l’incapacité de son fils adoptif. Le retour à sa « nature » permet aux qualités innées de Florent de jaillir et, par conséquent, il cesse de se comporter comme un exclu maladroit dont tout le monde se moque ; au contraire, il émerge en tant que héros, malgré une tenue peu recommandable, comme on le verra. À ce propos, Noëlle Laborderie observe :
L’auteur de Florent et Octavien a introduit une habile progression de l’achat de l’épervier niais qu’il perd aussitôt, à celui du cheval qu’il paie seulement trop cher, de ses premiers combats contre les païens à son combat de champion officiel contre Fernagu. Cette progression n’existe pas dans Octavian où l’achat de l’épervier et celui du cheval se placent exactement sur le même plan : un mauvais marché, et où brusquement sur son initiative personnelle Florent va combattre Fernagu. Elle rend plus naturelle dans Florent et Octavien la révélation du héros qui se fait par degrés successifs76.
Je reviendrai par la suite sur l’évolution de Florent ; à mon avis l’épervier et le cheval ne sont pas que de mauvais marchés : ils synthétisent au contraire l’essence du choc entre le héros et la réalité dans laquelle il est obligé de grandir. Sur la symbolique qui caractérise cet épisode, Baudouin Van Den Abeele observe :
L’achat insensé est un acte de révolte vis-à-vis du père adoptif. Cette tension se double d’un conflit social : le monde aristocratique […] s’oppose radicalement à celui des marchands, et répugne à l’idée du gain, de la transaction financière, du commerce. Les relations féodales supposent le don et sa contrepartie nécessaire. Cet achat, absurde aux yeux du marchand, est en quelque sorte un don déguisé, signe d’une largesse tout aristocratique77.
Autrement dit, Florent tâche obstinément de se procurer les équipements et les symboles dont il a besoin pour se raccrocher à ses racines, en utilisant l’argent de Climent comme s’il n’avait aucune valeur par rapport aux deux animaux/symboles qu’il achète. Dans FO, cette insouciance économique est explicitée lorsque Florent dialogue avec son père adoptif à propos des armes dont il a besoin pour se battre contre le sarrasin Fernagu :
« Aÿ ! Peres, dit il, soyés moys si courtois
C’un seul don me donnez, s’il vous plaist, ceste foiz,
Ne le refusez mie et ce soit vo voloirs ».
« Par foy, dist il, beaux filz, je l’acort ceste fois,
Mais que ne demandés florins, gros ne tournois,
Car alouez m’avez de ceux de plus fort pois.
« Nennil, ce dist Florent, je n’y compte une nois.
Je ne veul seullement qu(e) armeures et arnois,
S’iray a ce paien qui tant est maleois78 »
Après les « exploits » marchands à l’inverse du fils d’Othovien, le récit revient en France, qui se trouve sous le joug de l’invasion sarrasine ; l’ennemi avance sans arrêt et un adversaire redoutable, Rois des jaians (RO), appelé Fernagu dans FO, Akarius dans la mise en prose et Roy des geants dans FL, défie la fine fleur de la chevalerie française et impériale à travers un nain messager repoussant (je suis ici la version de RO) :
« Demain, quan jor iert escleriés,
Vendra ses amis tos abrievés,
L’escu au col et tos armes,
Tout seul venra sant conpiaingnie,
Bataille quere por s’amie
A un des meillors chevaliers
Que vous avés et des plus fiers.
Se vers lui s’en veult assaillir,
Bataille avra, n’i puet faillir79 ».
Le géant, auquel la fille du soudain a été promise, offre à Florent la possibilité de se réhabiliter en montrant toute sa valeur à Othevien. Alors, un problème surgit : le jeune chevalier n’a pas d’équipement, ce qui l’empêcherait de se présenter dignement face à son adversaire. Ce fait entraîne l’adoubement « vilain » de Florent. La description du géant redoutable sert, évidemment, à préparer le terrain pour celle, bien différente, du héros ; par exemple, le premier :
Le hauberc a molt tost vestu,
A son col pendi son escu,
Ains ne li deingna lance baillier,
Ne ne vout monter sor destrier,
Que nus destriers ne le portast,
Que son cors outre ne brisast ;
Car li jaians si grans estoit,
Que plus de .xv. pies avoit.
En un quir fu estroit laciés,
Atant s’en vait tos eslaissés80.
Malgré le fait de ne pas monter sur un destrier par pitié du pauvre animal et de ne pas se servir d’une lance, il s’agit sans doute d’un chevalier redoutable. Le géant tue facilement le premier adversaire ; par la suite, on passe au dialogue entre Climent et Florent qui, ému par la bataille et excité par la possibilité de venger la mort du chevalier, demande au père « qu’au jaiant me laissés aler, / a lui veil mon cors esprover81 ». À son tour, Climent est pris de pitié et essaye de le détourner de son propos ; toutefois, Florent insiste et, finalement, il déclare : « Se le congié ne me donés, / a lui iroi tout desarmés82 ». Le vilain comprend alors qu’il ne lui reste qu’à satisfaire la demande de son fils et, au lieu de l’adouber comme il lui faudrait le faire, à savoir « lui fournir son matériel, le rendre ainsi ‘opérationnel’83 »,
Par mautalent li dist : « Alés,
Ore faites ce que vos voldrés.
[Mais] par le mon los n’irés vos mie,
Je n’ai arme que soit forbie,
Mes un haubers (qui n’est) [ne] bons ne beaus,
Ne mes escus n’est tains noveaus,
Ne ma lance n’est mie blanche,
Ains est plus noire que n’est branche84 »
La réponse de Florent contraste avec cette description fort peu attirante :
« Sire », dist Florens li sennés,
« Tieus com il sont (si) les me prestés,
Ja por autres nes changeroi ».
Dist Climens : « Les vous bauderoi85 »
Cette partie du texte permet d’établir un rapport direct avec Aiol : dans cette chanson faisant « place aux gabs et à des scènes proches du fabliau86 », se trouve une description des armes que le père Elie confie au fils Aiol :
« Ma lanche s’est molt torte, mes escus viés,
Et mes haubers ne fu piecha froiés
Ne mes elmes forbis ne esclairiés.
Povrement en irés a ce premier,
Que ne menrés sergant ne escuier87 ».
Il ne s’agit pas d’un emprunt isolé, comme on le verra. Dans RO fait suite à ce passage une parodie de l’adoubement se terminant, très opportunément, par un grand rire :
Florens les armes demanda,
Et Climens les li aporta.
Un tapis estendi Climens,
Desus fist asseoir Florens.
Climens les chauces li laça,
Ne furent forrees pieça.
Le hauberc vesti verement,
Qui fu plus noirs que arrement,
Molt estoit lais et enfumés,
Et de tote parz [molt] roilez,
Un heaumë li a [a]porté,
Deseur son feu l’avoit geté,
Plus estoit noirs que pos de terre,
La suie en est cheüte a terre.
En le chef l’enfant l’a posé,
A .II.(II). cordeles novelé88.
Le symbole chevaleresque par excellence, l’épée, mérite une place à part…
Aprés li aporta l’espee,
Molt a lonc tans ne fu forbee.
Climens l’a par le poing saisie,
A l’autre poing l’a repaumie ;
Du fuerre la cuida sachier,
Mais qui li donast Monpeller,
Ne fust li brans por soi ostés
Tant estoit au fuerre serrés89.
L’opération d’extraction du fourreau n’a rien de légendaire et nécessite, en revanche, une aide supplémentaire :
Climens Gladouain apela,
Son fiuz estoit et molt l’ama.
« Pren », fait il, « d’une part l’espee,
Par le fuerre soit bien tiree […]
Tire vers toi molt durement,
Car au fuerre tient fermement,
Que ne la puis a moi sachier,
Diables l’ont fait [tot] [en]ruillier ».
[…]
Par tel aïr l’espee ont trait,
Que Climens verse et ses fieuz chent.
Florens en a grant joie eü,
De ceu qu’andui feurent cheü.
« Pere », dist Florens, « cest’espee
N’a pas esté molt enovree ».
« Fieuz », dist Climens, « voir dit avés,
Toutes voies l’en porterés90 ».
Encore une fois la « joie » se cachant derrière le rire satisfait de Florent après la chute de ses deux « valets » rend explicite le décalage social entre le protagoniste et sa famille adoptive. Par la suite, le même schéma est exploité pour la monture, le bouclier enfumés et tot derompus et la lance qui molt estoit torte et enfumee91. Le pic du comique est atteint lorsque Climent observe le résultat et, tout content, dit à son fils : « Or alés, / car vos estes tré bien armés », en promettant son soutien au moment de la bataille « se je vos voi grant cops doner / et desor le j[ai]ant fraper92 ».
Dans les versions restantes la parodie de l’adoubement se déroule sans innovations importantes :
| FO, t. 1, v. 2531-2578 | Othovyen, fol. 27vb-28ra | FL, fol. 32 |
| « Beaulx fieulx, ce dist Climent, tes toy se tu me croys ; Toutes mes armes sont plus noires que n’est pois » « Ne m’en chault, dit Florent, je n’en donne ung tournois, Car se je fais bonne euvre d’ouscis mauvaiz et noirs, Mieux en seray prisiez que s’eüsse bon arnois. Sire, se dit Florent a la chiere membree, Se la vostre armeüre est ung peu enfumee Contre ce seray preulx en iceste journee. […] Adonc [Climent] va son harnois querre sans demouree : Ung haulbert apporta plus noir que cheminee Et ung grant aucqueton a une manche lee, Si ot tres bonne coiffe que Climent a frotee Et pour oster le roul l’a aussi bien lavee. Adonc s’arma Florent qu’il n’y fist demouree, Et Climent luy a dit : « Florent, vesci m’espee, Mais bien y a .XII. ans, par la Vierge loee, Et plus qu’elle ne fu hors du feurre sachee ». […] Et Climent luy ala son vielz escu offrir, Sy tres noir que painture n’y peüst on veïr, Puis ly baille une lance, le fer faulsit fourbir. |
Climens, sans plus arester, fist apporter ses armures ; premierement il lui apporta ung viel jacque bien lonc a unes larges manchez et une vielle huvette enroullie que oncques plus noire on n’avoit veue. Climens le bouta en l’yawe, puis atout ung drappel et ung pou de chendres, il le blanchist ung pau. Apprés lui bailla son espee et luy dist : « Biau filz, plus y a de .XX. ans que elle ne fu sachye. » Alors Climent le cuida sachier, mais tant estoit enroullye que oncques ne le pot tirer dehors. Clodoains vint avant et prist l’espee par le fourel et Climent sachoit par la poingnye et sacherent sy tresfort ly ungz a l’encontre de l’autre que tous deux reverserent par terre les piés deseure. Quant Florens vey que Climent et Clodoain cheÿrent, il leur dist en riant : « Mon pere, ne vous hastés point, mais faittes tout par loisir. – Biau filz, ce dist Climent, je vous conseille que jamais ceste espee ne laissiés dedens le foureau, mais le portés toute nue, car se le payen vous venoit assaillir en soursault, vous ne l’aryés pas sy tost sachye, dont moult grant damage vous porroit avenir. – Peres, ce dist Flourent, quant la venra, je en cheviray bien. » Lors prinst l’espee et s’en escremist autour de lui, puis le chaingny. Son cheval fu appresté, sy monta sus. Climens lui bailla sa lance et son escu qui tant estoit noir et enfumé que on n’eust sceu dire de coy il estoit, tant estoit verny de la fumiere, puis lui bailla une lance en laquelle avoit ung fer sy fort enroullyé que en trois jours on ne l’euist sceu esclarchir tant estoit noir. Florent prist la lance en son poing et dist a Climent : « Peres, je vous commans a Dieu ! Je me voys offrir au roy pour combatre ce payen, dont ly gent font tant de parlement. » | Atant Clement plus ne sejourne, si s’en va a son hostel et delivra ses harnoys a Florent, puis Clement les chaussa et luy vestit le haulbert, lequel estoit tout enrouillé et tout noir. Ung heaulme luy aporta tout plain de suye, si le mist sur le chief de Florent. Aprés luy apporta l’espee, laquelle avoit gardee longuement […] Clement bailla l’espee a Florent, puis aprés son cheval luy admene, tout selle et bride. La selle estoit toute despecee et les regnes en quattre lieux noués, si les fortifia Florent tant qu’il peut, […] Clement luy bailla ung escu tout enrouillé lequel estoit bon et fort et le mist Florent sur son col, puis demanda la lance et Clement luy bailla laquelle estoit moult forte et roide, mais elle estoit toute enfumee. |
Ainsi harnaché, Florent se dirige vers le lieu de la bataille et traverse Paris. D’après RO, le jeune homme se présente devant le géant, tandis que dans FO il se rend au palais du roi où il subit les lourdes moqueries des écuyers et, surtout, de l’un des huissiers :
Il [Florent] entra en la court, mais pour luy escharnir
Veïssiez escuiers tout entour luy venir
En se mocquant de luy :
« Ou voulez vous courir ?
Venez vous cy le roy Dagobert assaillir? »
[…]
Donc oucÿés gens rire et leurs bouches ouvrir,
Quant Florent lez parçoit, sy en olt grant aÿr.
Adonc ung des huissiers envers luy va venir
Et luy dit : « Descendez, compains, sans alentir,
Venez vous en au roy vostre affaire gehir,
Foy que doy saint Denis, le glorïeulx martir,
Au disner vous feray tres noblement servir
Et vous donrray bon vin pour vo chief endormir,
Se bien avex beü, s’adonc voullez yssir,
Vous ferez devant vous tous lez payens fouïr93 »
Dans la scène correspondante d’Othovyen, les railleries sont condensées et celle de l’huissier se transforme en moquerie collective : Et quant ceulx qui la estoient l’oÿrent, ilz commencherent moult fort a rire, sy lui disoyent : « Compains, hastés vous de saillir aux champs, car seur soyés se les payens vous voyent, tous les venrés fuir94 ! ». Voyons un résumé concernant cet épisode dans toutes les versions du cycle :
| RO, v. 2274-2336 | FO, t. 1, v. 2759-2812 | Othovyen, fol. 29ra | FL, fol. 32-33 |
| Tuit le suivent, petit et grant, Et croioient : « Laissiés aller Avant le hardi bachelier, Qui vengera ancui Foréa, Par lui serons [nos] amonté. Beles armes a aportees, Diex, come sont bien eslumiees, Vés, que heaume et quel escu ! Cis est de[s] chevaliers Arthu, Qui ocient quanqu’il atainent ! De ses cops li sarrazins tainent. C’est li fiuz Audegier sant faille. Ancui verons tré grant bataille. Mors est li jaians, s’il l’ata(i)nt, Contre cestui n’avra garant. Diex a eu de nous pieté, Quant cestui nos a envaié ! ». |
Mais li pluseurs disoient en mocquant haultement : ‘Voiez du bel armé com fait essillement !’. Et le hüent si hault que Florent lez entent, Lors se tourne li enffe(n)s, s’a veü de gent tant Que trestous les creneaux a ce léz en pourprant […] |
Flourent prist congiet du roy et de l’empereur et des barons, puis monta Flourens sur son cheval et le bon congnestable le convoya jusques a la porte, mais saciés mainte risee y ot faitte a son partement pour les estranges armures dont il estoit armés. Moult euist esté hués et mocquiés se ce n’euist esté pour le congnestable qui l’acompaignoit ; tous s’en donnoient grant merveilles et sy ne sçavoient que penser et pour ce hommes, femmes, petis enfans couroient apprés, sy furent tous esbahis quant dehors la porte tout seul l’en veyrent aler […] | Florent se mist en chemin et Clement va aprés parmy la ville. Les grans et les petis alloyent aprés Florent et se mocquoyent de luy en criant : « Hé ! Dieu, regardez quel hardy chevalier ! Laissez le aller : Par sa hardiesse aurons honneur et pris ». Les aultres disoyent : « [C]e chevalier occira le jayant ». L’aultre disoit par mocquerie : « C’est ung des douze pers de France. Il s’en va combatre la pucelle contre le jayant : les Sarrazinz doibuent bien avoir grant paour ». L’aultre disoit : « Advisez le bien, car jamais plus vous ne le verrez ». L’aultre disoit : « C’est ung fol qui va sa mort cherchant »b. Le noble Florent tous les escouta et oncques mot ne leur dist, ains s’en alloit fierement. |
| Li jaians l’enfes venir voit, Net tant ne quant ne li douta, Por ce que [si] petis esta. A Florens vint, si l’apela : « Chevaliers, aten a moi ça. Forment les vout bien esploier Qui tiex armes te fist bailler. Merveilles font ore a priser. Ont eles estié en fimier ? Durement sont enruilies. Qui les t’a orë enblanchies ? Va t’en ariere, beaus amis, Ja de moi ne seras requis ». |
Fernagus : « Dame, dit le payen, par Mahon qui ne ment, Vecy ung crestïen de moult fol penssement, Qui vien tout seul a moy tournoyer ensement […] » Quant le payen l’entent, sy fronchy le manton : « Crestïen, dit le Turc, de ce ne vous blamon Se vo seigneur servés a sa conmandyson ; Maiz il a fait vers moy trop grande mesprison, Quant il m’a pour combatre envoyé tel garçon ». |
[Akarius] tout a piet s’en vint au devant de Flourens et quant il ot advisé Flourent que ainsy mal abilliet et mal armé venoit, il pensa que le roy Dagombert lui envoiast pour le mocquier et desprisier, dont il fu sy couroucyés que a pou qu’il ne marvoioit. | Le Roi des géants observe Florent et lui dit : « Par Mahon, bien devez aymer celluy qui vous a armé. Voz armes sont belles et riches : je croi qu’elles ont couché dedans ung fumier, car elles sont fort enrouillees. » [Le roi payen réfuse de combattre avec Florent, qui le défie]. |
| a. Forré est un roi sarrasin tué par Roland (E. Langlois, Table des noms propres de toute nature compris dans les chansons de geste imprimées, Paris, Bouillon, 1904, entrée Forré). Dans Aiol, éd. cit., p. 638, on lit : « Ce personnage est associé constamment dans le poème à des formes du verbe venger pour constituer une sorte de proverbe ». L’éditeur, J.-M. Ardouin renvoie également à P. Le Gentil, « Vengier Forré », dans Études de langue et de littérature du Moyen-âge offertes à Félix Lecoy par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Champion, 1973, p. 307-314. Cf. enfin Fr. Suard, « Les habits surprenants », p. 339, n. 23. b. Dans l’exemplaire Bonfons cité supra on lit : « C’est un des chevaliers Artus qui font mourir tous ceux qui tuent. Par ma foy, c’est un fol : il se va faire tuer. » « C’est un tres vaillant homme, dit l’autre, si aura fiere bataille : le geant est mort s’il l’attend’. ‘Dieu a pitié du bon roy Dagobert, dist l’autre, quand ce vaillant chevalier luy envoie ». |
|||
Le passage en question n’est pas passé inaperçu, notamment à cause du renvoi à Audigier. Luciana Borghi Cedrini écrit à ce sujet :
Nella chanson de geste di Aiol (XII sec.) ci si fa beffe del giovane protagonista, ipotizzando ch’egli appartenga al casato di Audengier, che cioè i suoi genitori siano Audigier e Rainberge (laddove quest’ultima è in realtà madre di Audigier, moglie di Turgibus ; analogamente, in Florent et Octavien (versione duecentesca d’un originale del secolo precedente) si identifica un cavaliere male armato con il figlio di Audigier97.
Par rapport aux noces entre Audigier et sa digne épouse Troncecrevace qui clôt la chanson, la chercheuse ajoute :
Di questa prevedibile ciclicità ha invero già dato rapido accenno la Lazzerini […] (là dove afferma : « Con la nuova coppia Audigier – Troncecrevace… il ciclo ricomincia : ecco un nuovo fidanzamento a croupeton, com’era stato quello di Turgibus e Rainberge, con corredo di generose defecazioni di buon auspicio… per l’abbondanza delle future messi e della futura prole audigeriana ») ; ma mi preme sottolinearla […] perché in essa, piuttosto che o comunque più che in un involontario scambio tra Audigier e Turgibus, vedrei la ragione per cui sia Aiol sia Florent et Octavian [sic] identificano per gab un cavaliere col figlio non già di Turgibus, ma di Audigier98.
À la lumière de ce renvoi, les mots adressés à Florent par le géant révèlent que la couleur des armes du premier n’a pas été choisie au hasard :
« Merveilles font ore a priser.
Ont eles estié en fimier ?
Durement sont enruilies.
Qui les t’a orë enblanchies99 ? »
Évidemment, il ne s’agit pas d’une citation anodine, dans la mesure où l’auteur de RO fait allusion à la matière fécale qui, comme on le sait, entoure l’existence même de cet anti-modèle de chevalier100. Voyons, par exemple, l’adoubement d’Audigier :
Seignor, or escoutez touz sanz noisier.
Dirai vos d’Avisart et de Raïer,
Qui Audigier, lor frere, font chevalier.
Le vallet amenerent sor un fumier,
Ses armes li aportent en un pannier.
Hauberc li ont vestu blanc et legier,
.XV. sols de marcheïs costa l’autrier.
En son chief li lacerent heaume d’acier
Qui .iii. anz fuz en gaiges por un denier.
Ti[r]arz li çaint l’espee, qui molt l’ot chier :
Plus mauvais vavassor de lui ne quier.
La paumee li done sor le colier,
Que d’un genoil le fait agenoillier.
En la place li traient son bon destrier101.
Le protagoniste part à la recherche de Grinberge qui, au moment de la fête successive à l’adoubement, tres enmi les queroles ala chïer, en raison du fait que molt li desplot la joie du chevalier102. Audigier n’est visiblement pas content, donc il se lance, à sa façon, à la poursuite de la vieille et, une fois cette dernière trouvée,
Audigier tret l’espee qui plus ombroie
Que jus de viez fumier quant il nerçoie103.
La couleur de l’épée rappelle celle de Florent. Déjà Foerster avait repéré un certain nombre de similitudes entre RO et la chanson d’Aiol, notamment par rapport aux moqueries et à la description de la lance de Florent104 : d’ailleurs, le fait même que cette chanson soit un modèle des mésaventures de Florent ne nous étonne guère car, comme le souligne Ménard, « aucune chanson de geste ne fait autant de place aux mésaventures que la chanson d’Aiol. Durant plus de 2000 vers, le conteur se plaît à multiplier les avanies et les outrages dont est victime le héros105 ». En résumant, Foerster cite les vers suivants d’Aiol :
Et cil borgois s’en gabent qui l’ont veü,
Et dist li uns a l’autre : « Trai toi ensus !
Cis est de la taverne trop tost issus.
Che samble des cevaus le roi Artu :
Ne peut consentir home que tout ne tut.
E ! Dex, com fait a loer cis escus !
Che resamble des armes dant Esaü
Qui vesqui par eage .C. ans u plus ».
Quant l’entendi Aiols, dolans en fu,
Parfondement reclaimme le roi Jesu106.
On ajoutera à ces vers la description des armes d’Aiol lorsqu’il arrive à Poitiers :
Aiols entra es rues parmi l’estree.
Sa lance estoit molt torte et enfumee,
Et ses escus fu vieus, la boucle lee,
Et sa resne ronpue et renoee,
Et les piaus de son col sont descirees
[…]
Chevaliers et borgois l’en esgardent,
Et dames et puceles es tors monterent ;
Et dist li un a l’autre : « Voiés, conpere,
Par la foi que vou doi, qui est chis leres ?
Ces armes que il porte a il enblees,
Mais molt par a le chiere bele et clere,
Et bien resamble fiex de France mere107 »
Après avoir tué un ivrogne qui l’avoit gabé et laidengié108, le héros avance :
Et dist li un a l’autre : « Cousin, voiés !
Tout avons de novel regaï[n]gié,
Car chi nous est venus un chevaliers
Qui samble del parage dant Audegier ».
Li borgois sont felon et malvoisié,
Molt li aront lait dit et reprovier :
Dites, sire, u menrés [i]cel destrier ?
Bien ait qui vous aprist a cevaucier !
Vous vengerés Fouré quant tans en [i]ert109 ! »
Peu après, reviennent les noms d’Audigier et de Raiberghe :
« Vasal, cevalier sire, a nous parlés :
Furent ces arme faite en vo resné ?
Fu Audengier vos peres qui tant fu ber
Et Raiberghe vo mere o le vis cler ?
Iteus armes soloit toudis porter.
Car remanés o nous en cest esté !
A ceste Pentecouste nos ju ferés,
Vos chevaus ert terchiés et abevrés,
Si nous en juerons par la chité110 »
Foerster repère également de nombreuses occurrences de l’expression lance torte et enfumee111. Compte tenu de la datation présumée d’Aiol « entre la fin du xiie siècle et le début du xiiie siècle », un rapport d’intertextualité entre cette chanson et RO est presque manifeste112. En revanche, la référence au fimier se trouvant dans ce dernier texte par rapport à la couleur des armes de Florent peut relever d’une connaissance directe d’Audigier.
Comme cela était prévisible, l’allusion de RO à Audigier disparaît dans les versions successives du récit, y compris FL, probablement à cause du fait qu’elle n’aurait pas été saisie par les publics respectifs. En revanche, la version imprimée cite les douze paires de France en substitution du renvoi, moins évident, à Forré, mais garde la référence aux chevaliers Artus qui font mourir tous ceux qui tuent, alors que cette dernière était absente dans les versions précédentes.
Dans FO, les premières armes endossées par Florent ne sont pas celles appartenant à Climent, comme dans RO ; dans la version en alexandrins elles étaient à un sarrasin et ont été conquises sur le champ de bataille, avec l’aide d’un valet :
Adonc ly ber Florent sur le payen monta,
Et luy tolly l’espee et le chief luy couppa,
D’auqueton, de hauber, tantost le despoilla.
Et ung vallet a pié qu’après eulx chemyna,
Quant il vit que Florent sy tres bien se porta,
Tost et isnellement envers luy s’adressa,
Et luy a dit : « Beau sire, le myen corps vous ayd(e)ra
A vous tres bien armer ainsi qu’apartiendra113 »
Ce choix n’est pas banal : l’effet parodique de l’adoubement vilain en résulte visiblement nuancé, et pour cause. Le fait que Florent ait conquis ses armes en les soustrayant à un Turc prouve d’abord sa valeur chevaleresque en rendant par la suite accessoire, donc moins immédiat par rapport au texte-souche, le fait qu’il endosse des armes peu dignes d’un chevalier au moment de l’affrontement avec le géant. Cette digression souligne le besoin primordial du jeune garçon de s’armer, étant donné que son père putatif n’est pas un chevalier, il ne veut donc pas contribuer à lui fournir l’équipement dont il a besoin. Par rapport à cette capacité de se procurer ce qui lui est refusé, on peut s’arrêter sur la scène où Florent récompense le valet d’un cheval enlevé à un sarrasin :
Le cheval se tint quoy et Florent le combra,
Puis s’en vint au vallet, erramment luy bailla,
Et luy a dit : « Amis, desarmés tot cilz la,
Et les armes qu’i porte vostre corps les ara,
Puis vous venez combatre aux payens par deça114 »
La réponse du valet, jadis empressé à armer le héros, est surprenante et conforme à la naïveté de Florent devant des propos beaucoup moins nobles que les siens :
« Sire, dist le varlet, ce ne saray je ja ».
Et a pris le cheval et par dessus monta,
Et dist a Florent : « Savez comant il va ?
A Dieu je vous commande, qui le monde crea,
Car combate qui veult qui combatre vorra !
Le corps de moy huymaiz plus avant sy n’yra,
Je ay bien bon cheval que mon corps sy vendra
Et en merray bon temps tant que l’argent durra ».
Et aprés celluy mot erramment s’en ala115.
Le pauvre Florent ne peut que constater son énième mauvaise affaire et assés se reppenti de ce qu’i luy livra / le bon destrier courant qu’aveques lui mena116. Malgré sa valeur, le héros n’est pas encore mûr, il est donc exposé à la ruse des autres personnages, tout simplement. Dans Othovyen, le valet disparaît et le prosateur ne manque pas de souligner le fait que Florent ôte à son adversaire l’espee hors des poings, sy lui en trencha la teste et le desarma d’un aucqueton qu’il avoit vestu et du haubert, sy s’en arma au mieulx qu’il pot et prist le healme et le mist en son chief ainsy qu’il sot, car il n’y ot nulz qui ad ce faire lui aidast en riens117.
En définitive, l’épisode où Florent se procure des armes avant que Climent lui offre les siennes et qui est absent dans RO, sert également à confirmer une fois de plus le conflit potentiel, voire l’impossibilité d’une véritable compréhension entre Florent et Climent. Lorsque le connestable de France invite le jeune chevalier à prendre un prisonnier en otage, car il est roy couronné, s’en aras grant argent118, le garçon refuse de peur :
« Que mon pere sceüst le mien demainement
Ne que je fusse cy venuz au chapplement ;
Car sur trestoutes choses, c’est ce qu’i me deffent
Que ne voysse combatre ne en tournoiement,
Et si a tant d’avoir, ne sçay ou tant en prent,
Et oncques ne monta sus cheval ne jument,
Armeures ne me veult acheter nullement,
J’ay cestez cy conquises en cestuy chapplement ;
Je ne veul qu’i le sache et le payen vous rent ».
Et quant le connestable ceste parole entent,
A rire commença assez et largement119.
Par la suite, Florent donne ses armes a ung rybault tout ivre qui tres bien le mocqua120, cette moquerie étant un prélude à l’humiliation collective qui l’attend peu après et qui précédera sa rédemption. La situation de Florent est même inférieure à celle de qui on définit normalement un « bacheler », à savoir un ‘jeune homme [ou] un jeune homme qui aspirait à devenir chevalier’121. En décrivant la condition des jeunes chevaliers, Georges Duby évoque un
transfert très brusque dans un autre monde, celui des cavalcades, des écuries, des magasins d’armes, des chasses, des embuscades et des ébats virils. Les garçons grandissaient là, intégrés à la bande de cavaliers, adolescents mêlés dans la promiscuité militaire aux hommes déjà mûrs. Ils appartenaient déjà, en position subalterne, confondus dans les premiers temps avec les goujats de service, à l’escouade qu’entretenait chez lui un autre patron, chargé de les éduquer, de les amuser, qui devenait ainsi leur nouveau père, tandis que la figure du père, du vrai père, du père « naturel », s’effaçait rapidement de leur mémoire, si puînés, ils n’attendaient pas d’hériter un jour de lui122.
Comme il est souligné au v. 2104 de FO, « que je voysse combatre ne en tournoiement », pour un aspirant chevalier le fait de se battre et de tournoyer était fondamental pour son apprentissage militaire, ainsi que pour son épanouissement. La situation de Florent est complètement renversée par rapport au cadre décrit par Duby : comme il le dit lui-même, non seulement il est éloigné de toute situation de combat ou de tournoi, mais la cause principale d’une telle situation est, justement, son père nourricier – auquel il souhaite la mort – tandis que le père naturel « ne s’efface pas de la mémoire » du jeune homme, vu que Florent ne peut pas même s’en souvenir. Parallèlement, c’est l’héritage naturel provenant d’Othovien et de Florimonde et non, malgré lui, le patrimoine inatteignable de Climent, qui pousse le protagoniste à se sentir exclu et inapte à la vie marchande, tant et si bien qu’il supplie Climent de lui octroyer la permission d’aller se battre avec ses vieilles armes, vu que le changeur, bien que très aisé, n’a pas la moindre intention de dépenser son argent pour lui en acheter de nouvelles123.
On peut conclure que, dans RO, l’adoubement vilain s’inscrit parfaitement dans le parcours parodique de Florent au sein d’une réalité qui l’exclut. Tel qu’un laissez-passer, les armes noircies de Climent permettent, finalement, la sortie de Florent de ce monde hostile et favorisent le retour à sa vraie nature. Par contre, comme je viens de le dire, dans FO et Othovyen, Florent se bat contre un turc, s’arme, se bat encore une fois, rencontre son père naturel et, seulement après ces étapes, assiste à la mort d’un chevalier chrétien, puis quitte le palais royal et demande ses armes à Climent qui, dans ces deux versions, est désormais bien averti des qualités chevaleresques de son fils adoptif. Malgré la possibilité d’obtenir une armure beaucoup plus digne en s’adressant directement au roi, Florent préfère solliciter Climent, comme on le sait : cette scène était trop réussie pour qu’on la supprime mais le statut du héros a été modifié par une auto-investiture chevaleresque antérieure rendant la demande de Florent au père nourricier comme une simple forme de dévotion filiale. Au contraire, dans RO le héros a à peine laissé entrevoir ses qualités, mais il s’approche de la chevalerie en compagnie du vilain qui :
[…] Par la main le tenoit,
Vint ans li damoiseaus avoit124.
L’âge de vingt ans n’est pas mentionné au hasard, tout comme l’appellatif damoisel ‘jeune homme de condition noble qui n’est pas encore chevalier, fils d’un seigneur125’ : il s’agit, justement, de l’âge où un bachelier se prépare à devenir chevalier, alors qu’ici Florent, qui n’a presque rien expérimenté de la chevalerie, est tenu par la main – un geste soulignant son immaturité – par son père adoptif. De plus ce dernier, n’étant qu’un changeur, est chargé de lui expliquer les causes du désarroi de l’armée défilant sous les yeux admirés du jeune homme, faute d’un père noble qui se serait acquitté de cette tâche en toute connaissance de cause. Par conséquent, étant toujours étranger au champ de bataille et encore dépendant de Climent, ce ne sera qu’avec des armes « vilaines » et enfumées qu’il pourra se manifester en tant que futur chevalier.
L’humiliation du chevalier dans le Libro del cavallero Zifar
Pour finir, je voudrais élargir mon discours par le biais d’une comparaison avec le premier roman castillan qui ne soit pas une traduction, à savoir le Libro del cavallero Zifar. Cette œuvre en prose fort complexe date du xive siècle : son éditeur le plus accrédité, Ch. Ph. Wagner, en souligna sa subdivision en trois parties, dont la première est largement influencée par la vie de saint Eustache126 : le chevalier et sa famille sont obligés par une malédiction – la mort de la monture de Zifar qui intervient tous les dix jours – à abandonner leur terre et, durant leur périple, sa femme, Grima, et ses enfants, Garfín et Roboán, sont séparés. Zifar se trouve ainsi en grande difficulté, mais durant le moment le plus dur de son parcours, il tombe sur un personnage étrange, El Ribaldo ‘malin, scélérat’ qui l’aide à se relever et à gagner le trône du royaume de Mentón qui se trouve sous le siège d’un royaume ennemi. Or, pour pouvoir pénétrer dans la ville de Mentón en traversant le siège, El Ribaldo et Zifar inventent un stratagème consistant à habiller le chevalier avec les habits peu convenables de son aide, en endossant en plus una guirnalda de fojas de vides en vuestra cabeça e una vara en la mano, bien commo sandio. E maguer vos den bozes vos non dedes nada por ello127.
Ainsi, le travestissement mis en place, quando entraron por la hueste començaron a dar bozes al cavallero todos, grandes e pequeños, commo a sandio, e deziendo : « Ahe aqui el rey de Menton, syn caldera e sin pendon » […] e el cavallero, commoquier que pasava grandes verguenças, fazia enfinta que era sandio128. Le protagoniste est donc humilié et appelé « Roi fou de Menton » mais, une fois entré dans la ville, sort l’épée qu’il dissimulait en dessous de ses habits et se présente al mayordomo del rey. « E commo te dexaron pasar los de la hueste ? », dixieron los que estavan en los andamios. « Certas », dixo el, « fisme entrellos sandio, e davanme todos bozes, llamandome rey de Menton129 ».
Comme on peut le constater, bien que dans le but d’ourdir un stratagème lui permettant de dépasser le siège de la ville et malgré le contexte différent, lorsque le schéma narratif commun à la première partie du cycle d’Othevien agit, se manifeste parallèlement la présence d’un personnage de condition humble, comme Climent, El Ribaldo ou Varochier, pourvu d’une certaine utilité mais, surtout, de traits comiques très poussés130. Voyons, par exemple, ce que dit un ermite à propos de ce personnage, considéré par plusieurs chercheurs comme un avatar de Sancho Panza du Quijote131. El Ribaldo fréquente assidument l’anachorète qui, un jour, accueille Zifar dans son ermitage. Ainsi, le vieillard prévient son compagnon de la façon suivante : « Ve tu via, ribaldo loco », dixo el hermitaño. « Cuydas fallar en todos los otros omes lo que fallas en mi, que te sufro en paçiençia quanto quieres dezir ? Çertas de algunos querras dezir las locuras que a mi dizes, de que te podras mal fallar132 ».
D’ailleurs, l’origine humble de Climent et du Ribaldo n’empêche pas qu’une fois leur dévotion prouvée, ils soient anoblis : ainsi, dans FO, Climent perd son qualificatif de vilain et, dans la troisième partie de la chanson, il devient roi de Syrie, alors que Clodoain aura en baillie Babylone133. De la même manière, El Ribaldo est d’abord adoubé chevalier sous le pseudonyme de Cavallero Amigo et, par la suite, de Conde Amigo. La dissimulation du héros derrière un travestissement – qui est en réalité l’équipement hérité de Climent par Florent – accentue l’humour implicite au niveau du rapport entre les deux chevaliers et les aides respectifs, avec des degrés différents de complicité, bien évidemment. Ainsi, qu’il s’agisse d’un bourgeois marchand comme celui qui aide Guillaume à remonter l’échelle de la société, ou bien d’un vilain musclé et combatif comme Varochier dans Sebile/Macaire ou, encore, d’un marchand pas trop brillant, mais finalement attaché à son fils adoptif, comme Climent et, enfin, d’un ribaud, un vagabond qui met à disposition de son nouveau seigneur toute sa malice et sa ruse afin qu’il réussisse dans les objectifs qu’il s’est fixé, on est toujours en présence de variantes multiples du même motif. Une telle répétition relève même du fait que ce schéma narratif offrait de larges possibilités d’application à plusieurs contextes et époques et que, parallèlement, il se combinait avec d’autres cadres narratifs, d’autres aventures et d’autres exploits personnels, de sorte que le succès était presque assuré.
Conclusions
Le cycle d’Othovien montre une capacité d’adaptation étonnante : la fraîcheur de la composition la plus ancienne permet en fait la survie d’un récit qui pouvait être modifié au gré des remanieurs, tout en restant dans le cadre d’une formule dont l’efficacité se trouve sous nos yeux. À mon avis, l’un des éléments fondateurs d’une telle continuité dans le temps est le parcours individuel de Florent, notamment dans le cadre de celle que j’ai définie comme une « aventure marchande ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément original, l’auteur de RO a su le renouveler, notamment à travers le développement du caractère de Florent en tant qu’« exclu » parmi les exclus par antonomase de la littérature de l’époque : les vilains134. Cette « trouvaille » va de pair avec le développement du rôle de Climent qui, d’ailleurs, sera davantage accru dans la suite du récit. Or, le rapport apparemment difficile entre Florent et Climent a permis aux continuateurs du cycle d’en adapter les conséquences aux différents contextes de réception : par exemple, dans FO, on n’hésite pas à mettre de côté le parallèle avec Audigier conçu par la chanson mère et qui, bien que très efficace, n’aurait pas été saisi par le public auquel la suite en alexandrins s’adressait. Certains éléments de cette partie ont été préservés dans Othovyen alors que, malgré sa proximité avec RO, FL élimine le clin d’œil à Audigier tout en gardant le gros du récit de l’humiliation de Florent. On a vu également qu’à partir de RO, ce dernier élément relève en grande partie d’Aiol : malgré le ton comique, comme dans le Zifar, l’humiliation exemplaire déclenche une tension entre la situation contingente et les qualités innées du héros qui, tout au long de son parcours, est obligé de souffrir avant que sa réalisation chevaleresque n’aboutisse. La présence du rire dépend, bien évidemment, du contexte de production, mais aussi du modèle choisi par chaque auteur : étant donné que, dans la séquence de l’humiliation publique, le modèle principal de RO était l’Aiol, la parodie se taille la part du lion. En revanche, l’adoubement en soi, qui manque dans ce dernier texte, ainsi que d’autres éléments mineurs, notamment la couleur de l’équipement de Florent, relèvent peut-être d’une connaissance directe d’Audigier.
Le motif parodique lié à l’adoubement de Florent est le symptôme même de sa provenance fictive : les armes rouillées et le ridicule caractérisant toute la scène sont consécutifs au paradoxe vécu par le fils du roi Othovien, ce dernier ayant grandi dans un monde habité par des marchands malhonnêtes, des bouchers plus ou moins violents, des bœufs à vendre ou à écorcher et, en définitive, dans des habits mal taillés et de larges souliers à paysan. Avec les armes dont la couleur rappelle le fimier évoqué par le géant sarrasin, et les railleries humiliantes qui en découlent, ce cadre de vie strictement paysan se transforme en initiation pseudo-chevaleresque dont le rapprochement à Audigier et l’adoubement constituent le climax. La catharsis de Florent arrivera exactement avec la défaite de l’adversaire qui avait demandé ironiquement si ses armes ont eles estié en fimier, comme si le sang du géant les avait lavées et nettoyées de toute souillure passée135. Si on compare cette séquence à celle de l’adoubement « officiel » décrit d’une manière détaillée dans le texte-souche et modifié dans les versions successives, on remarquera une différence aussi frappante qu’intentionnelle : à partir du bain, jusqu’à l’habillage et à la colée, tout se passe en la présence des rois les plus importants d’Europe sans oublier, évidemment, la présence de Dagobert et d’Othevien. Lorsque Climent insiste pour mettre les éperons aux pieds de Florent, la parodie habituelle revient de nouveau :
Lors s’est Climens agenoillés,
Si prist les esperons d’or
[…]
Florent les quida aver chauciés,
Mes a rebours li mist es pés.
Dist Climens : Par [la] moie teste,
Je ne soi li queus va a destre,
Ambedui sont d’une façon136. »
Dans ces vers on peut apprécier l’inversion des rôles : maintenant c’est le vilain qui, sans guère modifier son attitude naturelle, agit hors propos et est aidé par Dagobert, une situation spéculaire à celle vécue par Florent dans une réalité qui lui était également étrangère, alors que cette aide compréhensive et libérale lui avait été niée, ou presque.
Il reste enfin à souligner la particularité de l’évolution chevaleresque de Florent : par rapport à son frère Othevien, l’intention parodique est visible et le choix des modèles dans lesquels le poète a puisé est explicite. L’idée de situer un chevalier portant les stigmates du héros en dehors de son milieu n’est pas nouvelle, comme nous le savons137 : le paradoxe de la « réussite » du mauvais mélange de Florent avec le monde des vilains ou des bourgeois est toutefois indubitable. Le héros agit selon sa propre nature qui, évidemment, est la plus noble possible ; ce fait même le rend inadéquat à la vie que Climent a conçu pour lui, tout comme étaient inadéquats aux entreprises chevaleresques le couple Turgibus/Audigier et, d’une manière encore différente et beaucoup plus subtile, Aiol. L’auteur de RO insiste donc sur la parodie, l’humiliation et le ridicule propres aux aventures des enfances du héros, non seulement grâce à son incapacité à apprendre les métiers de boucher et de changeur, mais aussi par le biais du travestissement extérieur avec des habits mal taillés et, surtout, à travers son « adoubement ». En revanche, le motif de l’humiliation est pour Florent la conséquence d’une incompatibilité entre son origine et un monde qu’il subit, ou auquel il réagit violemment et de façon toujours inadéquate, comme s’il se trouvait sur un champ de bataille. Néanmoins, une fois vaincu le géant et reconnue sa valeur, le héros est désormais prêt à devenir homme en passant par une expérience nouvelle et fondamentale dans son épanouissement, comme il le dit lui-même à Climent à propos de l’amour pour Marsebile. Cette étape ratifiera définitivement son statut de chevalier et de seigneur désormais correctement adoubé et conscient de la nécessité de s’unir à une héritière fille du roy :
« Ains qu’il soit .XV. jours me verrez marïer ;
Encor sçay tel pucelle qui moult fait a prisier,
Qui est fille du roy, que j’aray a moullier
Je l’ay bien sceüe trover et espïer,
Maiz, se juré l’avoient ly Sarrazins lanier,
Se l’iray en son tref conquerre et chalengier.
On n’oseroit jamaiz pencer ne souhaidier
Les biens qui me venrront, je ne puis perillier,
Ma besoigne se prent tres bien a adrecier138 ».
Après son épanouissement Florent ne se débarrassera pas de la compagnie d’un personnage dynamique et capable de traverser mieux que le héros – de sa façon, bien sûr – la frontière entre vilenie et noblesse, à savoir Climent. Ce dernier, à partir de l’achat inconsidéré du nourrisson jusqu’au moment où, non sans difficulté, il en accepte la nature et, par conséquent, la supériorité, rend possible le développement tragi-comique des enfances de Florent. Une telle évolution se produit notamment grâce à sa capacité d’être un anti-modèle, certes, mais également un « miroir » du père naturel et, parallèlement, du fils adoptif, une fois les rôles renversés, ce qui, malgré ses défauts, lui permettra de faire ressortir les qualités innées du protagoniste.