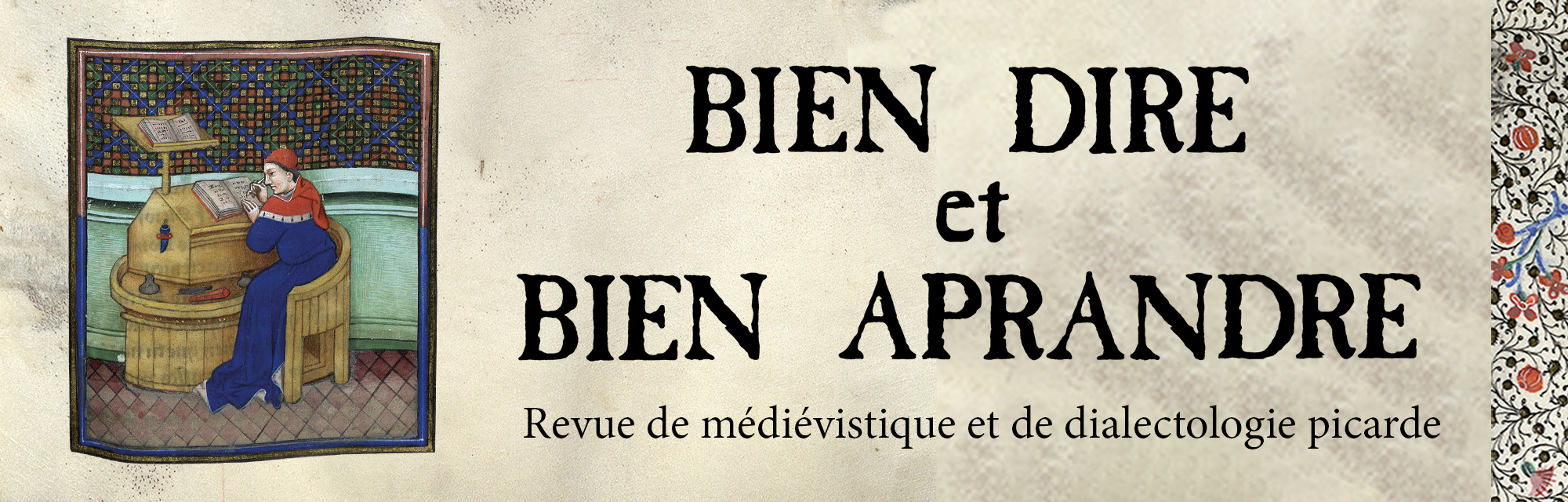De la petite Margot (de Lille, en Flandre) à Julia, l’épouse du grand Pompée, en passant par la reine Penthésilée et par la transgenre Yphis, nombreuses sont les femmes évoquées dans le corpus d’œuvres attribué à Philippe Bouton (1419-1515), chevalier, seigneur de Corberon, chambellan de Charles le Hardi puis de Marie et Maximilien. Mais est-il pour autant possible de découvrir les visages de ces femmes, leur personnalité, leur épaisseur humaine ? La réponse, en partie négative, permettra toutefois d’éclairer la manière dont les rapports de gender traversent la littérature à la cour bourguignonne, puis austro-bourguignonne. Elle trouve donc sa place dans le regard collectif que porte le présent volume sur les « Visages de femmes dans la littérature bourguignonne ». Dans les textes retenus pour la présente étude, à l’exception du Dialogue de l’homme et de la femme, où un personnage féminin assure la réplique, et plus ponctuellement de l’Oraison à Nostre Dame où la Vierge dit quelques mots, le regard porté sur les femmes et les corps féminins émane exclusivement d’un je lyrique ou narratif, assumé comme étant masculin et parfois censé s’identifier à l’auteur par un jeu anthroponymique. Ce qui frappe, sans toutefois trop étonner, c’est la facilité de l’auteur à passer du registre leste, voire très grivois, au registre courtois, parfois au sein de la même œuvre, tout en cultivant bien souvent l’ambiguïté et le double sens, y compris dans une œuvre a priori grave comme le Miroir des dames. D’une certaine manière, on peut se demander si le corpus Bouton n’est pas à l’image de la cour de Bourgogne elle-même, et plus largement peut-être de ces milieux nobles et roturiers, antérieurs au temps des Réformes, pour qui Nature représentait un alibi face à la morale sexuelle des clercs…
L’auteur, le corpus
La carrière de Philippe Bouton reste encore trop peu connue et repose sur des données fragmentaires. Noble bourguignon, au sens propre (c’est-à-dire originaire du duché de Bourgogne), membre de l’hôtel ducal et bailli de Dijon, rallié à Louis XI en 1477, Philippe Bouton fait retour assez vite à Marie de Bourgogne, avant de se ranger à nouveau sous le roi à la faveur de la Paix d’Arras (conclue en 1482 entre Maximilien et Louis XI, et cédant la comté, voisine du duché, à ce dernier). Il enverra toutefois son propre fils vers 1488 à la cour austro-bourguignonne, dans les Pays-Bas ; il continuera, depuis la Bourgogne, à correspondre avec ladite cour, où son propre cousin, Olivier de la Marche, joue d’ailleurs un rôle littéraire et politique important1. Ceci signifie donc que les textes écrits par Philippe Bouton après 1482 ne l’ont plus été à la cour de Bourgogne mais dans le cadre d’un duché rallié à la couronne de France, où il exerce d’ailleurs des fonctions officielles. Ce ralliement ne l’empêche toutefois pas d’entretenir un réseau littéraire avec les Pays-Bas et la cour des premiers Habsbourg : un de ses poèmes, le Regime, on le verra, est envoyé de Bourgogne à un membre éminent de la cour de Malines, tandis que L’An des sept dames et l’Oraison à Nostre-Dame, s’ils sont bien de lui, sont imprimés à Anvers au sein d’un recueil composite, peut-être par l’intermédiaire de son fils Claude, qui a possédé un exemplaire de ce post-incunable.
Son œuvre littéraire paraît s’étaler des années 1450-1460 jusqu’au début du xvie siècle, ce qui est en accord avec la longévité du personnage. Les œuvres qui lui sont attribuées l’ont été, pour l’essentiel, par la critique, car seul un texte du corpus Bouton comporte une indication certaine d’auteur2. On lui attribue un Dialogue de l’homme et de la femme, inédit, et un Poème sur la Toison d’or, à dater du principat de Philippe le Bon. Probablement contemporains, un jeu-parti composé avec le Grand Bâtard, Antoine de Bourgogne, Les Gouges, et un rondeau. Plus tardifs, un Miroir des dames, puis L’An des sept dames, une Oraison à Nostre-Dame et un Régime pour longuement vivre, qui précèdent son Épitaphe. Tous ces textes sont en vers3. Il ne saurait être question de rediscuter ici les critères d’attribution ; nous prenons ce corpus, en l’état, comme hypothèse de travail.
Un point demeure en discussion : Philippe Bouton a-t-il été en outre le compilateur, voire le correcteur, d’un recueil imprimé anversois, paru en 1504 sous le titre Sensieult une œuvre nouvelle, recueil composite dans lequel il aurait aussi assuré la traduction de textes de Virgile et de Plaute4 ? Deux faits militent contre cette hypothèse : d’abord la circonstance qu’à cette époque Bouton était plus que vraisemblablement absent des Pays-Bas, comme on vient de le dire, et d’autre part le fait qu’il a grandi puis évolué dans un contexte chevaleresque et courtois bourguignon, qui ne témoigne aucun intérêt pour l’humanisme philologique avant la fin du xve siècle5, soit un moment où il est fort peu probable que Bouton, déjà septuagénaire, se soit mis à cette école. Pour ces raisons, il me semble prudent de laisser ces traductions en marge d’un corpus dont les limites restent, il faut bien le dire, provisoires.
Dans ce qui suit, je laisse en outre de côté deux textes de ce corpus. D’abord, le Poème sur la Toison d’or : celui-ci consiste en une longue série d’apostrophes moralisantes adressées au duc Philippe le Bon, dans la foulée du Banquet du Faisan (1454), et il ne comporte pas vraiment de trame narrative ni de réels personnages, les éléments de l’histoire de Jason étant supposés connus et faisant ici l’objet d’une moralisation allégorique6. La figure de Médée, allégorie de la foi chrétienne, ne présente ainsi ni visage ni caractère propres7. Quant à l’Épitaphe de Philippe Bouton, rédigée à 96 ans, elle ne fait qu’évoquer brièvement [...] ma compaigne Katherine, / de Dio nommée palatine ; ce texte, centré sur Bouton lui-même et par endroits émouvant sur le thème de la finitude de la vie, ne consacre que deux octosyllabes sur soixante-six à son épouse, qui gît cependant avec lui8. On s’interroge dès lors sur les visages de femmes auquel cet auteur aura pu être attentif…
Je propose d’examiner dans un premier temps les pièces courtes du corpus, ensuite le Dialogue de l’homme et de la femme, puis L’An des sept dames, le Miroir des dames, et enfin l’Oraison à Nostre-Dame.
Les pièces courtes
Commençons par le Rondeau Bouton (non daté)9. L’auteur s’y exprime à la première personne et rapporte une anecdote. Ce pourrait être la chute d’une nouvelle, ce n’est qu’un rondeau. Alors qu’il est à l’auberge, voici qu’arrivent un homme portant des oiseaux, et un curé de village. Le curé s’adresse aux chambrières et leur dit en substance : voyez ce pauvre fauconnier, qui cherche où il pourra pendre son leurre devant le trou de la cheminée, moi ce sont mes couilles que je ferai pendre devant le trou de votre derrière. Soit l’original :
En venant de pelerinage
Trovay ung curé de village
Et ung homme portant oseaulx,
Qui vindrent paistre leurs chevaulx
En la maison du taverni[e]r.
Le prebstre dist aux chamberier[e]s :
« Regardés ung peu les manier[e]s
De ce povre vielz faulconier
Qui regarde autour de ce feu
Où son loire sera pendu.
Et moy, mes gracieuses trouilles,
S’il vous plaist, je pendray mes c...
Devant le trou de vostre c... ! »10.
Dans cette mini-facétie, un prêtre manifeste avec beaucoup de jactance et de supériorité son envie d’une relation sexuelle avec les servantes – il est évidemment dépréciatif à l’égard du vieux fauconnier, dont le leurre ne pourrait attirer les femmes qu’en les dupant. On note l’air bravache et supérieur du curé, dans un contre-emploi égrillard, bien dans le ton de l’anticléricalisme littéraire moquant les besoins sexuels débridés des prêtres, et permettant aux laïcs de prendre leurs distances, de se dédouaner, par rapport à la morale sexuelle prêchée par le clergé mais que les écarts de ce même clergé – réels et fantasmés – permettent de relativiser. Ici le curé ironise sur le vieux fauconnier, dont le leurre, qu’il ne sait où placer, renvoie sans doute à un pénis métaphorique à la fois impuissant et trompeur. Par contraste, le prêtre propose une vigueur non feinte à plusieurs partenaires. Rien ne dit toutefois qu’il ait engrangé quelques succès.
Dans le Regime pour longuement vivre (daté de 1507-1508, aux vers 31 et 33), dont le paratexte indique qu’il fut envoyé de Bourgogne (alors française) par Philippe Bouton à Charles de Croÿ (ca 1450-1527), gouverneur du jeune Charles Quint, enfant11, la sexualité masculine est mise en scène d’une autre manière, avec une autodérision qui rappelle celle dont Jean Molinet sut lui-même faire usage12, mais qui laisse encore une fois peu de place au partenaire féminin. Sur un ton plaisant, Bouton recommande la sobriété en boire et manger, sans toutefois renoncer au vin de Beaune. Il convient d’aller régulièrement au retrait pour pisser. En matière de coït, la modération est recommandée ; il vaut mieux péter à la face du con, ou aller uriner, que de trop abuser des noces :
[...]
Ne fais pas les nopces souvent.
Mieulx vault donner à ton c... vent.
Descherge fort l’artyllerye
Ou du moins joue de la vessye13.
Et plus loin :
D’aller trop souvent a Macon
Je te deffens, fuge le c...
[...]
De faire la beste a deux doz
Trop souvent, tibi defendos.
[...]
C’est le regime de Bouton,
Qu’a le v... plus mol que coton14.
La pièce suivante que nous examinerons est plus ancienne (1454 ?). Il s’agit d’un jeu-parti intitulé Les Gouges, dont les treize strophes sont attribuées alternativement à Bouton (sans mention d’un prénom) et au Bâtard de Bourgogne, en l’occurrence le Grand Bâtard Antoine, selon toute vraisemblance15. Arthur Piaget semble avoir du mal à concevoir que ce dernier, bibliophile et seigneur de haut rang, soit le co-auteur d’un poème grivois et l’attribue en conséquence à Bouton seul16 ; nous ne nous sentons pas obligé de suivre ces réticences, basées sur l’a priori d’une incompatibilité de profil entre haute culture et grossièreté. Au contraire, il faut rappeler la proximité de Bouton et d’Antoine, qui participèrent à un même fait d’armes à la cour d’Angleterre en 1467, événement exclusif s’il en était17.
Le poème met en scène treize types de gouges, toutes avides de relations sexuelles et de partenaires masculins multiples. Ces femmes ne peuvent donc qu’être diffamées, au regard des critères sociaux du temps, et, pour beaucoup sinon toutes, le texte laisse entendre que ce sont des prostituées. Impossible de tout détailler ici. Un exemple :
Bourgogne
Gouge qui veult entretenir chascun
Et a le cueur et le corps si commun
Qu’incessamment fait rembourer son bas,
Sans adviser ne a qui ne comment,
On la devroit couronner haultement
En Bourdelais ou au plat Pays Bas18.
Être commune, s’adonner à la promiscuité sexuelle, c’est cela même qui exclut une femme de la catégorie des femmes honnêtes ou preudes femmes ; c’est même cela, on le sait, qui est au cœur de la définition médiévale de la prostitution, bien plus que le caractère vénal des relations19.
Voici deux gouges dont l’une est plaisamment assignée à garder la frontière mais l’autre est clairement référée comme une prostituée suivant l’armée :
Bouton
Gouge qui sçait son mestier tout par cueur,
Et a tousjours ung nouveau chevaucheur,
Qui la serre terriblement derriere,
Sans bast, sans bride et au besoing sans selle
La chevauche jour et nuyt sans chandelle,
Telle gouge doibt tenir la frontiere.
Bourgogne
Gouge qui suyt nostre ost et nostre armee,
Aux gens d’armes du tout habandonnee,
Pour avoir bruit et pour honneur acquerre,
Qui contre tous veult esprouver son corps
Et ayme mieulx cinq cens vis que deux mors,
Elle se doibt nommer gouge de guerre20.
On notera le double sens sur la prouesse militaire (esprouver son corps, avoir bruit, honneur acquerre), de même que l’emphase sur la promiscuité (les 500 vits) et le jeu de mots sur vit (sexe masculin) et vif (‘vivant’, opposé à mors).
Pour faire bref, on peut dire que, dans ces portraits de gouges, le seul agir féminin est un vague désir, ou supposé tel, qui les confine encore plus dans leur catégorie de femmes-objets diffamées : un désir effréné de phallus (Gouge qui meurt de tirer au baston ; Gouge qui veult que chascun la cullette21), au besoin en contrefaisant la femme honnête (Gouge qui fait la bonne preude fille / Et quiers partout une grosse cheville / Pour estouper le trou d’emprès la cuisse […]22). Point de visages, mais des membres, et surtout une focalisation sur le bas du corps. Avoir des hommes pour s’en faire servir du plat des cuisses / Pour estre mieulx a son gré tricotee23. On peut être obscène24 : Gouge qui rue et pette com ung dain / Quant elle sent ung groz borgne poulain, / pencez que c’est ou d’aise ou de grant peine, / Frappez dedans, n’espargnez point la beste […]25. Une seule de ces gouges prend la parole, et ce n’est que pour confirmer ce cliché de la gouge avide de nombreux sexes masculins :
Bourgogne
Gouge qui veult actendre tous venans,
Criant : « Venez, fourrez vous la dedans ! »
N’est ce pas fait de bonne damoiselle ?
Puisqu’elle fait de son cul ung bersault,
Et qu’elle met les tallons au plus hault,
Chascun devroit crier : « Baille luy belle ! »26.
On aura noté la position envisagée, avec les jambes et les pieds en l’air (Puisqu’elle [...] met les tallons au plus hault) ; on peut l’indiquer au catalogue avec d’autres, comme la position de celle qui est chevauchée sans selle par un partenaire qui la serre terriblement derriere27 ou le fait de sacquer a la musette / C’est a dire la jambe sur l’espaulle28.
On aura noté aussi le jeu sur les catégories sémantiques du registre chevaleresque et du registre grivois. Actendre tous venans, c’est l’attitude du noble qui tient un pas d’armes29 ; le registre est évidemment subverti lorsqu’on considère comme étant d’une bonne damoiselle le défi lancé par la gouge.
Ceci nous offre la transition vers un texte d’apparence toute courtoise, mais d’où l’ambiguïté et la subversion des registres ne sont pas absentes.
Le Dialogue de l’homme et de la femme
Ce Dialogue est inédit. Il est conservé dans un petit manuscrit d’époque, de 12 feuillets, attesté dans l’inventaire de la libraire de Philippe le Bon dressé vers 1467, et se compose de 50 strophes de huit vers30. Le narrateur se met aux champs pour chercher l’inspiration littéraire et pour éviter l’oisiveté ; il déambule jusqu’à une île dotée d’un pré vert, semé de fleurs odorantes, où est rassemblée gente mesnie / d’ommes et femmes (str. 4). Mais voici qu’il s’éloigne de cette société tout agréable, courtoise et convenue, et qu’il repère une femme et ung homme (str. 9), tapis par derriere une haye (str. 8). Pour mieux entendre, il se cache. Voici donc déjà une attitude de voyeur, peu courtoise. Toutefois, le narrateur protège l’anonymat du couple, en garantissant qu’ils ne faisaient rien de mal :
N’avez garde que je les nomme.
Aussi, par saint Pierre de Romme,
Je n’y vy chose que tout bien
[...].
On peut s’esbatre sans meffaire
Et estre ensemble ainsi qu’on doit,
Comme j’entendy ces deux faire,
En qui beaucop biens habondoit (str. 9-10).
Partant, aucune description physique, aucune inscription sociale, même si a priori le contexte indique qu’il s’agit de deux personnes nobles.
Le dialogue que le narrateur espionne se révèle du plus haut intérêt. La dame se plaint d’être née femme, et aurait souhaité être un homme. L’homme proteste que les femmes sont louées pour les grands biens qui sont en elles – c’est d’ailleurs très précisément ce que Bouton fera plus tard en composant le Miroir des dames – et que les hommes né de bonne maison (str. 14) s’empressent de les servir. Mais la femme n’en démord pas :
Entre dire et faire sont deux
[...]
Hommes ont tousjours l’avantage (str. 15).
Ne dénonce-t-elle pas ici la rhétorique du service courtois qui, de manière structurelle, masque le patriarcat31 ? Ce serait un beau signe de clairvoyance, volontaire ou involontaire, de la part de Philippe Bouton, qui aurait placé cette analyse dans la bouche de son personnage. Mais, sur un terrain plus individuel, la dénonciation du personnage féminin est aussi un écho des thèmes du losangier et du faux amant trompeur.
L’homme prétend ensuite que les femmes sont plus libres, tandis que les hommes ont de grandes charges :
Plus franche est femme sceurement
Que n’est homme et mieulx a son ayse,
Sans avoir paine ne tourment.
Il est ainsi, ne vous desplaise (str. 16).
Il affirme qu’il est soumis aux désirs de la dame avec qui il discute – on comprend dès lors qu’il est l’amant courtois de celle-ci :
[...]
Moy mesmes ne me suiz je mis
A vous servir de corps et d’ame
Et a vos bons vouloirs soubmis ?
Cela savez vous bien, madame (str. 18).
Dès le début quand l’homme affirme honorer et servir les dames, et sa partenaire de conversation en particulier, un double sens latent est possible, et la suite le rendra plus plausible. La femme l’accuse d’ailleurs de ne chercher qu’à profiter d’elle, et elle disqualifie explicitement le service courtois comme étant une façade hypocrite :
Se vous ou autres me servez,
Ce n’est que pour baillier le bon
Et que d’honneur me desservez
Non que franche me preservez
Comme vous dittes que je suis (str. 19).
Lui prétend que desservir n’est mie servir / mais violence et malvaisté (str. 20), reprenant la langue de bois de la rhétorique courtoise. Mais, provoqué par son interlocutrice (combien que faciez de l’ermitte, / [...] N’en prendrez-vous mains une micte ?, str. 21), il jette bas ce masque, en affirmant à sa partenaire que, si elle était un homme, elle agirait de même et chercherait à consommer ses plans-dragues.
Dès lors, il la défie et lui demande d’expliquer ce qu’elle ferait, étant homme (str. 22, 24). Ce qui suit relève de l’inversion des rôles hétérosexuels, sans le moindre soupçon d’orientation queer. Cette fois, c’est à la femme de changer de ton ; en tant qu’homme, elle accumulerait les conquêtes féminines (et n’aurait donc cure de redresser les injustices de genre) :
Par Dieu voire, une batelee
De dames aroit, pour quoy non.
Et n’y auroit ja si pelee
Qui ne cogneust le compaignon (str. 25).
À ce stade, on peut gager que l’auditeur médiéval sourit déjà amplement, pour le moins. Si une vérité est dite (à un homme une multiplicité de partenaires ne messied pas, tandis qu’une femme doit se garder d’être asservie et déshonorée), elle est reléguée à l’arrière-plan par le changement du registre de discours. Nous sommes passés du courtois au grivois.
Ce que confirme la curiosité de l’homme : il veut connaître, de la bouche d’une femme, quels sont les trucs pour appâter une future conquête, certain que la femme devenue homme, connaissant ce qui plaît aux femmes, pourra s’en servir à son avantage. On voit au passage que son masque de service courtois, affiché en début de dialogue, n’était qu’un masque, et que son agir propre est porté par un désir de conquêtes sexuelles. La femme affirme que jamais une femme n’éconduira un soupirant (str. 27) mais, pour le reste, elle refuse d’apprendre à l’homme comment parvenir à séduire les femmes (str. 29). Celui-ci affirme qu’il la sert mais qu’elle n’a jamais cédé à ses avances sexuelles (str. 30), ce à quoi elle répond : vous ne m’avez jamais trouvé / Que au point qu’on vous doit escondire (str. 31) ; elle ajoute qu’une femme qui désire passer au lit ne va pas le crier a la trompette (str. 31). Elle reprend donc ici sa posture féminine. L’homme évoque un livre qui prétend qu’une femme qui dit « non », pense en réalité « oui » :
Femme qui dit de chaude cole
« Non, non, plus riens je ne demans »,
Car ce « non, non », en bonne escole,
Vault autant que « ouy » en rommans (str. 32).
Quoique la femme mette en doute ces propos (str. 33), l’homme garde cette idée que le « non » féminin n’est qu’un moyen, cruel et hypocrite, de faire lanterner le galant. En conséquence, il propose une nouvelle inversion des rôles genrés : s’il était, lui, la femme, et qu’elle était son amant, il la ferait attendre et rager (sur ma vie, j’entens / que je vous mectroie en alaine, str. 36). Elle en doute vraiment, car selon elle les hommes-en-femme seraient incapables de réfréner leur envie – en soi, elle affirme donc que les femmes ont une plus grande maîtrise de leurs désirs sexuels que les hommes.
Survient alors une troisième transgression des rôles de genre. L’homme demande à la femme ce qu’il en serait si son couple était temporairement inverti : c’est-à-dire qu’elle soit le mari, et son mari l’épouse (str. 38). Coup de théâtre : nous apprenons donc que la dame courtoise est mariée (et donc que toute la tentative de séduction déployée tourne autour d’un potentiel adultère), et le contexte évoqué par la suite paraîtra bien bourgeois et roturier, peut-être pour les besoins de la farce. Elle commence par répondre qu’être le mari durant un an et demi n’a pas de sens, car redevenue la femme elle subirait la vengeance de son conjoint ; l’inversion devrait donc être à vie (str. 39). Elle précise que son attitude sera dominante :
[...]
Je feroye bien du seigneur.
[...]
Chanter lui feroye « my, la ».
Sachiez que mestre je seroye (str. 41).
Il trembleroit des qu’il me orroit (str. 43).
Mains nous prisent que povres chiennes.
Battre l’en feroye sa coulpe,
Lui disant : « tu as fait des tiennes,
Mais tu auras d’autel pain souppe » (str. 45).
Soir et matin lui feroit on
Couvrir et alumer le feu (str. 47).
L’homme, qui pense qu’il n’y auroit pot n’escuelle / que tout ne luy fissiez laver (str. 46), coupe court à cette inversion pénible à entendre pour le genre masculin : Vengance est moult de Dieu haÿe, / Qui ne veult pas que homme soiez ! (str. 48). Les choses rentrent dans l’ordre. Il lui faut se résoudre à être femme, dit-il : Si vous conseille que doyez / prendre en gré ce que Dieux vous donne ! (str. 48).
Sur ces mots, le soir approche, et tout le monde quitte l’île : l’un et l’autre conviennent qu’il est temps de rentrer. La femme elle-même minimise les propos transgressifs qu’elle a tenu : On dit beaucop quant on solasse. / C’est assez dit pour ceste fois (str. 49). Tout cela n’était-il donc qu’un jeu ? Y compris la posture bourgeoise adoptée par une dame de la noblesse ? À moins que le vocabulaire du début n’ait travesti en société courtoise une simple réunion de citadins à la campagne ?
Quoi qu’il en soit, et sans nous éclairer sur ces questions, le narrateur quitte à son tour son poste d’observation ; il note ensuite ce qu’il a entendu, en souvenir dit-il de la mémoire d’une qui avoit nom Yphis (str. 50). Le dernier mot du poème est ainsi le nom de ce personnage des Métamorphoses d’Ovide, né fille mais élevé en garçon, et que la déesse Isis change miraculeusement en homme la veille de son mariage, pour éviter le scandale. Yphis est connue notamment par l’Ovide moralisé32. Mais de cette antique transsexuelle, Bouton n’a pas vraiment tiré parti dans son poème, sinon peut-être pour tracer des limites : le sous-texte nous dit en effet que la transformation d’Yphis était miraculeuse mais surtout fabuleuse, et donc impossible (une fille ne peut devenir un homme). Par contre, les changements de sexe évoqués par les deux protagonistes du dialogue l’ont été à titre de badinage sur l’île ; ils ne remettent donc pas en question l’ordre voulu par Dieu et rappelé par l’homme (str. 48), un ordre qui reprend ses droits dès lors que les dialoguistes rentrent chez eux.
Dans ce dialogue émerge un portrait psychologique partiel d’une femme, idéal-typique autant que rebelle, caractérisée par sa ténacité, sa finesse, son esprit de répartie. Autant de qualités que prisent les modernes, mais méfions-nous : n’est-on pas en présence du cliché misogyne de la femme querelleuse, destiné à faire sourire les hommes du public, plutôt que d’une préfiguration de la femme moderne et indépendante ? Si elle parle aux contemporains que nous sommes, n’est-elle pas discréditée d’office, dans le contexte d’énonciation original ? D’autant que non contente de contester la domination sociale et maritale des hommes, elle remet aussi en cause leur monopole de la liberté sexuelle, et en particulier le monopole de la sexualité multi-partenaires, s’affirmant même plus prédatrice encore qu’eux sur ce terrain (ce qui rejoint un autre cliché misogyne, celui de l’appétit sexuel féminin excessif). Toutefois, en vertu du principe lector in fabula, ne peut-on pas penser aussi que le Dialogue ait pu échapper à l’intention de son auteur, et toucher une corde sensible auprès des femmes de son auditoire, confrontées, de la naissance à la mort, au cadre contraignant de la domination masculine ? À ce stade du raisonnement, comme historien et en l’absence d’autres indices, je dois m’incliner devant le mystère du texte littéraire et de sa possible agency.
L’An des sept dames
Ce texte, daté de 1503, a récemment été attribué à Philippe Bouton par Françoise Féry-Hue33. Il a été composé alors que Bouton séjournait depuis vingt ans dans la Bourgogne désormais française, mais comporte de nombreuses allusions au contexte des Pays-Bas austro-bourguignons, où il fut d’ailleurs imprimé en 1504 et où, rappelons-le, le fils de Philippe Bouton menait une carrière à la cour.
Le propos en est simple et la structure complexe. Le poète nomme sept dames, une par jour de la semaine. Il établit 52 séries de sept strophes, correspondant aux 52 semaines de l’année. Il passe en revue chaque semaine les sept dames (une par strophe), dans le même ordre, en les associant pour chaque série à un élément particulier (ainsi les sept planètes, les sept métaux, les sept couleurs, les sept âges de la vie, etc.), sur le mode d’un calendrier plaisant. Pour une bonne part, L’An des sept dames tient donc de l’exercice de style et du tour de force littéraire, plus ou moins réussi.
On rencontre ainsi Walbourg, une Hollandaise de La Haye, qualifiée de belle petite, d’enfant34, mais aussi de m’amyette et de ma petite maistresse35 ; entre elle et le narrateur, il s’agit bien de nos amours36. Même la crainte d’être écorché par voie de justice ne l’empêcherait pas de lui faire tout service37. Vient ensuite Jacquelinotte, belle et petiotte, bien jeune, petite et belle38, de Condé en Hainaut. Le narrateur déclare aimer cette ville et tous ses habitants pour l’amour d’elle, ajoutant à l’occasion : du tout me plaist bien son affaire39. L’Artésienne Toinette, de Saint-Omer, est servie par l’auteur depuis longtemps ; il la qualifie de m’amie40, de bel enfant41 ou encore de ma damoiselle42. C’est une dame, elle se défend43 et est rebelle à son amant44, pas si courtois qu’il n’envisage de faire avec elle la beste à deux dos45. Comme la rose épanouie, il est temps de la cueillir46. Il lui offrira ung lit de camp qui pour nous deux porra souffire47. Quatrième dame : l’auteur requiert d’amour Katelinette, gentille et honeste (sic), une Flamande d’Ypres : il se mettrait en péril pour luy garder bien son honneur, et souhaite avoir sa bonne grace48 – registre courtois –, mais il chevaucherait bien sous elle jusqu’à en être hors d’haleine :
Merquedi vouldroy devenir
Une belle blanche haguenée,
[...]
Quant dessus moy seroit montée,
Je me remueroy doulcement
Affin que jus de moy ne chut,
Hors d’alaine seroy souvent,
Ne m’en chauldroit, mais qu’il luy plut49.
Et pour le souper, qu’elle lui apporte en une escuelle descouverte / tetin ou pis de bonne sorte50. Vient encore Jacqueline, flamande d’Audenarde, une pucelle dit-il51, de lui bien aymée52, belle, doulce et toute plaisante53, dont les cheveux sont comparés à ceux de la Madeleine et qui est plus belle qu’une sirène54, deux références bien inappropriées pour une pucelle, car si la Madeleine est une prostituée repentie, les sirènes n’ont en principe jamais renoncé à leur vocation de tentatrices. Il l’aime d’amour bien fine, mais elle le fait languir55. Il lui souhaite à deux reprises qu’on la marie56, il veut la voir habillée en mariée, les cheveux dénoués57, et, de manière très ambiguë, il affirme que, pour prendre son deduyt avec elle, il leur faut dans le plat de fruits des poires de pucelle58, où l’on est tenté de voir une allusion aux seins de la jeune personne. Encore une Flamande, mais de Lille, c’est Margo, m’amie ; elle est à marier59. Et enfin Gomare, une Brabançonne de Bruxelles, petite et bien jeunette, dont il nous dit que servir la veulx plus qu’onque mais60. Sans blesser Nature, elle ferait bien un fils61.
Qu’on ne se laisse pas abuser par quelques mentions d’honnêteté feinte, laissant imaginer un service courtois, en tout bien tout honneur, ou de simples rencontres d’approche avec une jeune fille à marier, dans le but de se positionner comme futur époux. D’abord parce que sept aventures sont menées de front. Ensuite parce qu’à partir de la septième semaine au plus tard, le doute n’est plus permis sur la nature de ces relations. En effet, les sept métiers évoqués par l’auteur, un pour chaque dame, sont tous à double sens grivois62 ; le pêcheur, par exemple, propose ses instruments pour vérifier si le vivier de Margo est profond, sans parler du cuvelier qui propose de boucher le trou ou fendurette du petit tonnelet de Gomare63. Plus loin, à la semaine des métamorphoses, le narrateur souhaite être une puce pour aller hault et bas / dessus [la] char blancette et tendre de Toinette, qui par ailleurs n’a pas bien grant renon64. Ces sept dames – ou ces sept fillettes65, terme ambigu qui peut désigner couramment des prostituées – sont donc bien des maîtresses du narrateur, et probablement pas de lui seul.
Ce qui est intéressant pour notre propos, c’est toute l’ambiguïté mise par l’auteur dans son discours. Alors que certains passages sont anodins, d’autres se situent dans un registre clairement courtois, et d’autres encore donnent dans le ton grivois, assénant même des blasphèmes religieux et politiques. À Toinette, sous le signe de la planète Mars qui échauffe à la guerre, le narrateur dit qu’il pense bien qu’elle ne se battra pas comme une Amazone mais qu’elle a assez de beauté pour une belle meslée :
Bien croy que pas ne combatrez
Ainsy que fit Pantasilée ;
Mais de beauté tenez assez
Pour s’en combattre à grant meslée66.
Il aime sa Margot comme toutes les Margot, car, affirme-t-il, long tans y a qu’ay commencé / tousjours deffendre leurs querelles67 : soit un clair détournement de la phraséologie courtoise. Pour le premier dimanche de Carême, il rappelle la tentation du Christ par le Diable et l’injonction faite aux chrétiens de servir Dieu seul, qu’il ne peut respecter tant il veut servir Walburge : Ce non obstant mon ceur vous donne / Il n’est possible que m’en tiengne / [...] Servir vous veulz quoy qu’il m’aviengne68. Citant le récit évangélique du pardon de la femme adultère au troisième samedi de Carême, il clame cyniquement son espoir que le pardon divin ne sera pas refusé, à un nous qui peut désigner l’humanité en général tout autant que le couple qu’il forme avec Gomar :
Adultère est pechié bien grant ;
Toutesfoiz Dieu luy pardonna.
Vivons tousjours en esperant
Que sa mercy ne nous fauldra69.
Que penser de cette envie d’être trois jours avec Kathelinette comme Jonas fut en la balaine par trois jours70 ? Et de cette affirmation que, si les Juifs ont utilisé des sergans pour arrêter le Christ, Jacquelinotte n’aurait pas besoin de varletz pour mener le narrateur à elle71 ? Et du parallélisme quelque peu osé, sur le plan politique cette fois, entre la naissance de l’infant Ferdinand, fils de la princesse de Castille, épouse du souverain des Pays-Bas72, et le filz que devrait faire, ou apprendre à sçavoir faire, la jeune Gomar73 ?
Le contexte matériel et social est ambigu : certains passages évoquent un contexte matériel de cour – on parle en effet de palais et de la grant sale où tenir cour74, de jardin et de rose75, d’oiseau de proie et de singe attaché en la chambre76, d’étuves apparemment privées77 –, et le vocabulaire tient fréquemment du registre courtois, tandis que d’autres passages évoquent plus franchement la maison bourgeoise des Cent Nouvelles nouvelles. Les sept dames semblent donc habiter dans un entre-deux indéfini. Sur le plan social, elles sont tantôt saluées comme des enfants, tantôt comme des dames à qui s’adressent un service courtois, tantôt comme des filles communes, voire des prostituées. Il s’ensuit que dans ce texte les références courtoises doivent être prises à double sens. D’autant que le narrateur a clairement une aventure avec chacune de ses fillettes.
Il loue celles-ci, s’adresse à elles, mais ne les décrit qu’en termes fort généraux : elles n’ont pas vraiment de personnalité ni de traits psychologiques ou physiques distincts ; on n’entend jamais leur voix. Tout demeure au niveau du cliché, comme lorsque l’on apprend que Walburge ressemble à l’or parce qu’il est doulz et bien traitable ou à l’éléphant parce qu’il est doulz et chastiable78. De même, peu d’éléments concrets transparaissent sur le vêtement ou sur le corps de ces (toutes) jeunes femmes. Ce que l’on entend est une voix d’homme et un exercice de style, reposant sur de multiples pirouettes.
Au demeurant, on peut se demander si le texte ne comporte pas sa propre dose d’autodérision : évoquant ses conquêtes en termes de service des dames, le narrateur ne peut pourtant prétendre à aucune qualité courtoise, puisqu’il dévoile ses maîtresses et qu’en outre il n’est fidèle à aucune d’entre elles, et plus encore, finalement, parce que ses maîtresses sont des femmes communes et n’ont rien de demoiselles honorables. Y a-t-il donc grande matière à se vanter de pratiquer des femmes communes, quand on est de noble naissance et que l’on a été échanson à la cour (qualité explicitement rappelée par le narrateur) ? Toute l’ambiguïté du texte est là. Est-il autre chose qu’une plaisanterie littéraire ? Mais ne serait-il que cela, il n’est pas sans enseignement : il nous donne à nouveau l’image d’un monde où un homme peut évoquer sans trop s’en soucier les femmes diffamées comme de plaisantes femmes-objets, sources de plaisir et de divertissement pour leur partenaire masculin, mais sans guère de personnalité, de volonté ni même de vie propres.
Le Miroir des dames
Ce texte79, dédié à une princesse anonyme, que l’on pense être Marie de Bourgogne, commence par une évocation de la Vierge Marie et se termine sur une invocation à celle-ci. Composé a l’onneur des fames80, il traite des femmes de bien81, ce qui tranche évidemment avec les autres textes, antérieurs et postérieurs, du corpus. La posture du narrateur est chevaleresque, non sans toutefois quelques possibles doubles sens grivois, tout en intégrant également des thématiques mariale, macabre et politique. En de courtes strophes, l’auteur évoque Ève, les douze Sibylles, l’épouse et la mère d’Alexandre, les épouses de César et d’Hector, les reines Ediltrude (du royaume d’East Anglia) et Lassaria (de Perse), des épouses sauvant leur mari (l’une en l’allaitant, d’autres en lui prêtant leurs vêtements), Lucrèce, les épouses perses inspiratrices de la victoire de Cyrus, l’épouse de Pompée, les reines amazones (Penthésilée, Sémiramis, Tomyris), les Preuses bibliques (Déborah, Esther, Judith), et une version de la triade chrétienne de ces mêmes neuf Preuses (Hélène, Gertrude de Saxe, Clotilde). Il aligne ensuite dans un panégyrique général les qualités morales qu’il attribue aux femmes (humilité, générosité se traduisant en aumônes, patience, charité, diligence, sobriété, chasteté82, miséricorde, etc.).
En résumé, le Miroir accumule de nombreux exempla, succincts, où les personnages féminins sont peu élaborés. Il s’agit en outre d’autant de récits, ou de considérations générales, rassurants pour la domination masculine, car toutes ces femmes se signalent par un rôle d’auxiliaire, de médiatrice, de conseillère ou de supplétive83.
L’Oraison à Nostre Dame
L’Oraison à Nostre Dame en 110 quatrains, attribuée à Philippe Bouton par Françoise Fery-Hue, mériterait à coup sûr une plus ample attention que les quelques lignes qui suivent84. Ce texte, qui n’est qu’incidemment une prière, ressemble à beaucoup d’égards à un petit traité, nourri d’un talent narratif certain. L’auteur ne se dit pas digne de chanter les louanges de la Vierge (str. 1), qui est chantée par les prophètes, patriarches, confesseurs, apôtres, martyrs et par l’assemblée des vierges portant cescune ung beau chapeau (str. 6), par crainte de Lucifer et sa compaignie (str. 8), et à nouveau louée ici-bas (évocation des hymnes, du psautier, de l’encens, str. 9-13). Le poète loue sa beaulté et sa clarté (str. 16), ainsi que sa capacité à enfanter ung beau filz / sans entamer virginité (str. 18), qu’avaient annoncée tant les Sybilles (str. 20) que plusieurs préfigurations survenues sous l’ancienne loi (soit le buisson ardent, la manne céleste, la verge d’Aaron, la toison d’or, Hester courtoise et sage et Judith aussi, ainsi que la porte de Salomon, str. 21-30). Tout ceci n’est pas sans rappeler, à certains égards, le Miroir des dames, tant dans la manière que sur le fond.
L’auteur rappelle ensuite successivement la chute des anges rebelles (str. 31-32), la création d’Adam et Ève, qui sont mis en lieu plaisant / De bois, de pretz et de verdure (str. 34), non sans réminiscence des topoï courtois (à l’instar de la situation initiale du Dialogue de l’homme et la femme), puis la tentation d’Ève à qui Lucifer joue ung tour bien cauteleux (str. 39), lui faisant croquer la pomme qu’elle tend ensuite à son mary ; celui-ci, bien aveuglé et par amours, y croque à son tour (str. 42-43). L’auteur ponctue, tel un chroniqueur de cour : Ce fut pour nous male journée (str. 44). Vient ensuite la décision du Père, annonçant l’Incarnation et la Rédemption (str. 46-64) : il faut que déité se mesle [...] avec la char caducque et fresle (str. 61). Avec cette vérité : La femme fut cause de mort / Femme sera cause de vie (str. 56).
La suite (str. 65-97) témoigne d’une véritable fascination, et d’une insistance réelle, quasi-gynécologique, sur la corporéité de la virginité mariale, thème annoncé en mode mineur dès le début du poème85. Ce n’est pas tant cette forme d’impudeur, ou de grand naturel, qui étonne chez un auteur médiéval par rapport aux réalités corporelles, que le caractère répétitif et insistant avec lequel elle s’exprime. On parlerait de grivoiserie sacrée, s’il ne s’agissait pas plutôt d’une forme d’anti-grivoiserie hyper-sexualisée, qui neutralise tant la paillardise que, plus largement, la sexualité hors mariage, et prévient leur avènement. S’adressant à Notre-Dame, le poète lui rappelle : la décision de Dieu en ton ventre fist lict et couche / De toy vierge fut amoureux (str. 65). Arrive Gabriel : devers toy vierge il arriva / En te trouvant toute seulette (str. 66). La Vierge Marie, interloquée par l’arrivée de l’archange Gabriel, prend conseil auprès de ses trois amies Prudence, Virginité (ma doulce seur que j’ai gardée, str. 78) et Humilité. Effrayée, elle confie à Virginité : de toy perdre ay trop grant crainte (str. 79). Le personnage allégorique la rassure : le Créateur concevras sans toy corrompre (str. 83). À son tour, l’ange la rassure : ne doubte point / D’embrassement n’œuvre charnele /Du tout en tout lesse ce point / L’œuvre sera spirituelle (str. 86) ; et de préciser : du saint esprit grosse seras / demeurant pure en tous endrois / ne ton fruyt pas n’emportera / de chasteté ta vertu belle (str. 87-88). Et d’expliquer : Ainsy que perche le soleil / Le voire cler sans trou ne fente / En ton ventre par cas pareil / Le filz de Dieu fera descente (str. 89). Elle aura belle lignie mais, lui dit-il encore, ta pureté demeura saine (str. 91). Enfin, elle lui répond, selon le conseil d’Humilité : de Dieu suis serve et chamberière / De moy fera sa voulenté (str. 95) ; une formule qui subvertit les codes polissons (on a vu dans ce qui précède, et dès le Rondeau Bouton, dans quel contexte les chambrières sont placées par ces textes, et l’on sait que faire sa volonté d’une femme signifie avoir un rapport sexuel avec elle, le cas échéant la violer86). Ces éléments prennent d’autant plus de relief à nos yeux si nous songeons qu’ils sont énoncés par un mâle dans une société qui valorise la virginité féminine en tant que passeport social, une société où les hommes ne savent que trop, pour en jouer littérairement et socialement, ce que sa perte hors mariage implique comme déclassement et comme ségrégation pour les intéressées. La frayeur de Marie semble ici autant liée à la perte possible de sa virginité qu’à l’apparition surnaturelle de l’ange.
Vient ensuite une évocation de la Nativité, complète avec le chœur des anges, les trois rois, l’âne et le bœuf, les pastoureaux (str. 98-101). L’auteur conclut (str. 102-113) : il est normal qu’elle soit préférée à toutes par son Fils, qu’elle a allaité, et que tous mortelz la prient, en particulier ceux qui sont en peril de mer, ou en grand maladie, ou encore ceulz qui sont pris en Barbarie, et plus largement tous les pécheurs. Lui qui est noyez [...] en tout pechié et trebuchié entre les las de l’Ennemi, implore sa grâce et son intercession en vue du pardon divin qu’il requiert. Ce ne sont pas des paroles purement formelles, si l’auteur est bien le même que celui des textes que nous avons examinés précédemment : il y a une cohérence à la fois thématique mais aussi psychologique87, autour de la féminité qui est cause de plaisir naturel et de péché pour un homme gaillard – que ce soient les gouges, la femme du Dialogue sur l’île, ou les sept fillettes – , mais aussi espoir de rédemption pour l’au-delà – grâce à Marie dont l’hymen est intact. Marie, l’antithèse des femmes dont il a, peut-être, causé doublement la perte, en ce monde et dans l’autre.
Conclusions
Il n’est pas toujours évident d’interpréter les œuvres que nous venons de passer en revue. D’abord parce que l’attribution du corpus à un seul et même auteur reste hypothétique, ensuite parce que la chronologie des textes est très flottante, enfin parce que l’auteur prend un malin plaisir à cultiver les doubles sens grivois ou scabreux, rendant parfois sa position difficile à saisir. Mais c’est là précisément que réside sans doute une bonne part de son talent littéraire : la composition de textes plaisants. On pourrait certes développer l’analyse sur ce point, en se penchant sur le lexique, les réseaux sémantiques, les analogies, etc., ce qui n’était guère possible dans cette première approche.
Quant au fond, les visages de femmes sont très peu élaborés par Bouton, dont les textes renvoient plus au bas du corps qu’aux yeux et à la bouche. Ni description physique, ni portrait psychologique. Même les femmes exemplaires du Miroir sont réduites à l’anecdote accumulée. La liberté sexuelle des femmes est abordée, mais toujours négativement, que ce soit pour rappeler un cliché misogyne ou pour renforcer le déclassement moral et social de celles qui y recourent, plus contraintes d’ailleurs que volontaires, un aspect que Bouton passe entièrement sous silence.
Les registres grivois et courtois ne s’ignorent pas dans cette œuvre. De nombreuses allusions courtoises et chevaleresques sont utilisées et subverties en double sens sexuels ou en situations scabreuses dans les textes grivois ou ambigus (qu’il s’agisse du fait d’armes et de la prouesse, du jardin, du service des dames ou du service à la dame). La louange des dames de bien est au cœur du propos hypocrite de l’amant du Dialogue. Et la prostitution n’est pas absente de la louange des dames de bien proposée par le Miroir : Bouton y loue la chasteté, affirmant celle-ci bien plus présente chez les femmes que chez les hommes, car pour une trouvée aux bordeaulx / Hommes y vont à grant troupeaulx88. Liberté de ton remarquable dans un texte dédié à la princesse régnante, qui prouve que les dames courtoises, les vraies, ne sont pas censées feindre l’ignorance du monde où la grivoiserie se mue en sexualité théoriquement condamnée.
Sur le terrain de la querelle des femmes, Bouton adopte une position terriblement ambiguë89. Il revendique le service des dames dans son Miroir ; il y affirme leur supériorité morale. Dans son Dialogue, il laisse un personnage féminin dénoncer la domination masculine structurelle drapée dans la rhétorique du service des dames. Vise-t-il, comme une Christine de Pizan, à faire bouger les lignes ? Si c’est le cas, il bat vite en retraite dans ce même Dialogue où la femme ne souhaite être un homme que pour pouvoir accumuler les conquêtes et, de manière très farcesque, asservir son conjoint aux tâches domestiques, jugées dégradantes. Ce n’était qu’un morceau de monde à l’envers, un divertissement, et à la fin du jour les deux dialoguistes ont repris le cours normal de leur existence. Le Miroir lui-même se révèle assez peu transgressif : la supériorité des femmes y est affirmée sur le plan moral, mais les qualités morales et les figures exemplaires qui sont évoquées sont plutôt de nature à confirmer l’ordre établi, où les femmes n’agissent au mieux sur le devant de la scène qu’à titre subordonné et supplétif. Cela dit, ce miroir concernait les femmes de bien, l’auteur le dit explicitement, et non les autres femmes.
Car il n’y a socialement rien de commun entre la Roxanne d’Alexandre le Grand, les Sibylles, la princesse dédicataire du Miroir, d’une part, et d’autre part la femme et son amant dialoguant sur l’île, et encore moins les gouges et les sept dames dans leurs lieux de perdition. Si l’intersectionnalité est une clé de lecture évidente pour les gender studies, les visages de femmes évoqués par Bouton le révèlent de façon abrupte : dans cette société, la domination masculine répartit de manière très crue le genre féminin en deux catégories, d’une part les preudes femmes, d’autre part les diffamées, plaisantes pour les hommes mais perdues90. Des madeleines non repenties91.
Tableau 1 – Le corpus d’œuvres attribuées à Philippe Bouton
| Titre | Témoins | Indice d’auctorialité | Auteur de l’attribution à Philippe Bouton | Datation |
| Les Gouges | Paris, BnF, ms. fr 1721 ; Londres, BL, ms. Add. 28790 | Bouton et Bâtard de Bourgogne (paratexte) | Arthur Piaget | Ca 1454 |
| Poème sur la Toison d’Or | Bruxelles, KBR, ms. 11205 | anonyme | Jean de la Croix Bouton | 1454 ou peu après ; avant 1467 |
| Dialogue de l’homme et de la femme | Bruxelles, KBR, ms. 11205 | Bouton (jeu de mot) | Louis Mourin | avant 1467 |
| Rondeau Bouton | Vienne, ÖNB, ms. 3391 | Bouton (titre) | Arthur Piaget | ? |
| Miroir des dames | Bruxelles, KBR, ms. 10557 ; Dijon, BM, ms. 3463 | Bouton (jeux de mot) | Arthur Piaget | 1478-1482 |
| Oraison à Nostre-Dame | Vienne, ÖNB, ms. 3391 ; imprimé (1504) | anonyme | Françoise Fery-Hue | ? |
| L’An des sept dames | imprimé (1504) | anonyme (deux allusions au bouton et quatre à la rose) | Françoise Fery-Hue | 1503 |
| Régime pour longuement vivre | Vienne, ÖNB, ms. 3391 | Philippe Bouton (paratexte) ; Bouton (texte) | Arthur Piaget | 1507-1508 |
| Épitaphe | lame funéraire en laiton (Corberon), perdue | Philippe Bouton (je narratif) | Arthur Piaget | 1515 |