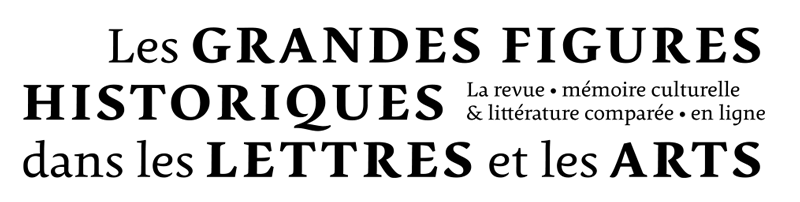Mais à quoi bon la mémoire des faits véritables, si ce n’est à servir d’exemple de bien ou du mal ?
Alfred de Vigny, « Réflexions sur la vérité dans l’art »
Selon Richard. T. Vann1, le fait de blâmer ou de louer des êtres morts qui ne partagent pas notre échelle de valeurs ne va pas de soi, tant s’en faut, dans la mesure où seuls des présupposés humanistes à valeur universelle et anhistorique, aujourd’hui largement mis en cause, pourraient autoriser les vivants à évaluer l’action des morts en termes moraux, comme le fait un Plutarque. Au total, l’image du procès de l’histoire qui constitue selon la tradition un point essentiel du discours historiographique et biographique – on en trouve des traces jusqu’à Michelet2 – apparaît aujourd’hui comme caduque et archaïque, en raison des changements épistémologiques qui se sont mis en place au cours du XIXe siècle et qui ont privilégié progressivement les déterminismes collectifs.
Les dictionnaires biographiques ont fleuri dans les années 1780, comme celui de l’abbé François-Xavier Feller, à l’« esprit éminemment moral et religieux »3, mais également à partir de l’Empire sous la direction de Louis-Gabriel Michaud en 18114 ou sous celle de Gabriel Peignot en 18135. Pendant le reste du siècle, la tendance se maintient sous la forme soit de rééditions soit de nouveaux projets6. Les recueils de Vies illustres ont vu, eux, un regain de publication pendant la Révolution et le Directoire7, après une vingtaine d’années pendant lesquelles elles ont été réservées aux Vies de saints et à la traduction/adaptation d’œuvres antiques. Organes de propagande signés par des pamphlétaires et des polygraphes, ces recueils témoignent des enjeux et des combats idéologiques qui pouvaient entourer une figure célèbre. Les deux genres constituent ainsi d’excellents révélateurs des débats et dans une moindre mesure des évolutions critiques qui ont pu s’installer pendant cette période. C’est, en effet, dans le terreau des crises majeures de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle qu’ils ont émergé8 et que se posent les questions de la fonction accordée à l’humain dans l’Histoire, de la cohérence de l’action comme force motrice, car la lisibilité qu’on attribue à une action, en particulier criminelle, est essentielle, dès lors qu’il s’agit de formuler un jugement sur le passé, comme l’indiquent certains des sous-titres qui évoquent explicitement les crimes et les vices comme motif au souvenir9.
Après les premières fièvres de l’esprit de parti évoquées par Charles Nodier10, et le développement en France d’une histoire plus professionnalisée, le jugement de l’histoire –auquel la génération des Guizot et des Michelet ne renonce pas – achoppe sur de nouveaux problèmes épistémologiques. Dans la mesure où le biographe, qui « a pour premier objet de reproduire l’individu tout entier […] et de le suivre jusque dans les recoins intimes de sa vie »11, se heurte à une compréhension toujours insuffisante et lacunaire des actions par manque de preuves et de documents, surtout pour les périodes anciennes et pour les aspects privés de l’existence, toute présentation cohérente des intentions devient, on le comprend, au mieux artificielle, au pire mensongère ; elle crée ses mythes « à travers lesquels les contemporains ont ainsi donné sens à leur présent. »12 On parle dans la critique contemporaine d’« intentional fallacy »13. Si l’expression est récente, elle recouvre des problèmes auxquels les historiens du XIXe siècle ont dû faire face et auxquels ils étaient conscients de faire face, et peut-être plus encore dans les formes les plus brèves des récits biographiques, celles où la nécessité de dégager une continuité de la personne se fait le plus sentir. Elle ne saurait donc être mieux choisie pour désigner l’effet de trompe-l’œil sur lequel s’appuie toute analyse des intentions.
Or face à l’aberration, souvent criminelle, la question à la fois de la lisibilité de l’action et des normes morales se pose avec plus d’acuité. Aussi voudrions-nous interroger les anciennes pratiques historiographiques afin de voir comment les grands criminels perturbent le bon fonctionnement de l’écriture historique dans son ancienne fonction de magistra vitae et de dénonciation des crimes. Par la période de transition que nous étudions ici, nous cherchons à mettre à jour les mécanismes d’écriture de ce type de Vies dans les dictionnaires biographiques et dans les recueils. Nous examinerons comment elles sont tributaires à la fois des sources anciennes qui sont les leurs, et de l’esprit de parti qui est régulièrement dénoncé de part et d’autre de l’échiquier politique14 et de l’émergence souvent timides de nouvelles pratiques historiographiques où l’exactitude et l’exhaustivité sont censées primer15. À ce titre, La Biographie universelle ancienne et moderne entre 1811 et 1843, dates de sa première édition et de sa refonte, est particulièrement éclairante d’une forme de commémoration qui, qu’on se trouve encore dans l’ancien régime d’historicité des grands hommes ou le nouveau qui fait entrer dans le panthéon du souvenir toute une nouvelle catégorie de gens célèbres, reste paradoxale et problématique.
Nous avons pu montrer comment le discours probabiliste des Lumières en particulier avait pour effet de minorer l’ampleur des scènes de violences ainsi que les crimes collectifs qui se sont produits sous prétexte qu’un tel comportement serait peu vraisemblable et sujet aux exagérations passionnées, à l’esprit de parti des acteurs ou des victimes16. Pour les grands criminels que l’histoire nous a légués, je pense notamment aux terribles empereurs des heures les plus sombres de l’histoire romaine, la donne semble sensiblement plus complexe. Certes, on peut retrouver fugitivement, sous la plume d’un Edward Gibbon, un des plus grands historiens de la période, des raisonnements qui témoignent de sa prédilection habituelle pour la mesure, gage de vérité : « Dion gives a much less odious character of Perennis, than other historians. His moderation is almost a pledge of his veracity. »17 Néanmoins, dans les portraits des empereurs les plus iniques, ceux sur qui l’opprobre de la postérité est tombé, ces remarques en faveur d’une certaine modération critique semblent plus minoritaires. Comme le suggère Villemain qui, contre Voltaire, retient l’hypothèse que Germanicus a été empoisonné sous l’instigation de Tibère, et qui accuse le philosophe, du fait de sa mesure critique, d’avoir « ce scepticisme qui devient quelquefois trop favorable aux méchants »18, la remise en question systématique des crimes des grands hommes perturbe la mission même du tribunal de l’histoire.
De ce fait, la question est moins « les détails rapportés sont-ils justes ? », même si l’interrogation surgit çà et là, que « comment rendre compte de ces détails ? » La bienséance moderne se trouve à ce propos souvent en peine pour exprimer l’original latin ou grec, comme le montrent les périphrases laborieuses que Gibbon emploie à propos de Commode : « The ancient historians have expatiated on these abandoned scenes of prostitution, which scorned every restraint of nature or modesty. »19 Une note en latin répond toutefois à la curiosité du lecteur averti. De façon similaire, dans la Biographie universelle, l’article « Tibère », qui suit par ailleurs fidèlement Suétone, se tait sur la pédophilie abjecte de l’empereur. L’auteur, Villemain, revendique une forme moderne de prétérition nécessaire (« Au milieu de ses infamies inexprimables pour une plume moderne »20), qu’on ne doit pas confondre toutefois avec une forme de remise en question des faits. Le terme d’infamie, réitéré à plusieurs reprises dans l’article, prend un aspect générique qui permet de couvrir toutes les actions et de marquer tout de même le jugement du rédacteur. En effet, l’enjeu de ces omissions est moins la crédibilité ou non des faits que les limites portées à la représentation même. Cette pratique diffère, notons-le, de la Nouvelle Biographie universelle de Hoefer qui, dès le sous-titre de l’ouvrage (« avec les renseignements bibliographiques et l’indication des sources à consulter »), met en avant comme spécificité son rapport critique aux sources dont l’ouvrage donne à voir l’ampleur et invite, dans l’avis des éditeurs le lecteur à s’y référer pour suppléer aux éventuelles omissions des notices. Elle traduit une autre forme de retrait qu’on pourrait qualifié de philologique car Léo Joubert, dans ce même ouvrage, dénonce la littérarisation du personnage et la cohérence construite a posteriori de son parcours criminel. Qu’on compare le même topos dans les deux articles sur Tibère, celui de Villemain et celui de Joubert :
Suétone nomme son professeur de rhétorique, Théodore de Gadare, qui, si l’on en croit ce chroniqueur médisant, devinant ses vices, l’appelait de la boue délayée avec du sang (πλòν αίματι πεϕφυϱμήνον). Quoi qu’on pense de ce pronostic, imaginé peut-être après coup, Tibère semble avoir répondu aux espérances de sa mère [.]21
Un Grec savant qui lui servait de précepteur avait coutume de dire de lui, que « c’était de la boue détrempée avec du sang ». Sous ce maître habile et si clairvoyant, Tibère apprit la langue grecque […].22
Les précisions que donne Joubert sur l’identité de Théodore de Gadane, la citation en grec, témoignent de ce souci critique qui est renforcé par la suggestion qu’il ne s’agit que d’un bon mot inventé, tandis que Villemain fait primer le registre moral et n’interroge ni l’anecdote, ni la citation qui est attribuée au rhéteur. Peut-on en conclure qu’il y a une évolution des pratiques ? Rien n’est moins sûr, ou du moins elle n’est pas généralisée dans l’ensemble des articles que nous avons pu comparer. Peut-être est-ce dû au fait que certains articles, comme ceux de Caligula ou de Commode dans la Nouvelle Biographie universelle, reprennent en fait L’Encyclopédie des gens du monde entamée en 1833 qui met l’accent, dans le discours préliminaire, sur un projet de vulgarisation et non d’érudition23.
Les jugements humanistes et moraux qui se déploient dans la Biographie universelle de Michaud au travers des articles centrés sur les figures antiques présupposent que le moderne condamne les mêmes faits que les anciens, et on peut effectivement constater la convergence des appréciations. Cependant, un décalage se dessine dans la capacité qu’a l’ancien ou le moderne à supporter les détails les plus crus. Le danger est la complaisance dans la représentation de la cruauté ou des débordements sexuels (Quatremère de Roissy précise à propos de Caligula qu’il « serait dégoûtant de faire l'énumération de tous les crimes et des toutes les folies de cet empereur »24 et reste volontairement en-deçà de Suétone), il est aussi dans le fait que le lecteur est susceptible de vouloir aggraver par son imagination l’effet dramatique du crime, comme l’exprime à son tour Villemain : « L’imagination, qui aime le dramatique dans l’histoire, se figure Tibère présidant au jugement de son complice […] s’assurant enfin le silence par un meurtre secret. »25 Bien que cette interprétation offre une cohérence supplémentaire au portrait, elle est rejetée comme une fausse conjecture. Pourtant c’est bien au nom d’une certaine continuité du comportement sur la durée, que le même Villemain reprend certaines des interprétations les plus noires à propos de Tibère, le « premier crime [étant] attesté par tant d’autres crimes. »26 De son côté, Quatremère de Roissy dans son article sur Commode fait mine brièvement d’évoquer des historiens qui auraient prêté au fils de Marc-Aurèle d’heureuses dispositions dans sa jeunesse, pour privilégier in fine l’anecdote selon laquelle il fit ordonner qu’on jetât dans un fourneau celui qui avait préparé un bain trop chaud27. Dans la Nouvelle Biographie, l’historien Joseph Naudet développe le même fait présenté sans discussion cette fois : « Dès l’âge de douze ans, il montra sa férocité »28. Dans un article pourtant assez court, l’anecdote est même agrémentée d’un fait secondaire : le mouton jeté à la place du coupable pour tromper la cruauté du jeune Commode. Le but est visiblement, encore une fois, de marquer les esprits, plutôt que de se livrer à des débats d’érudits. La permanence des topoï de la dénonciation (folie, dépravation, animalité, démesure) assure une lisibilité29 aux monstres de l’histoire, et cela même lorsque les auteurs font mine de préférer les prétéritions et les périphrases pour les évoquer.
Dans la tension qui se dessine entre l’efficacité recherchée des articles et le souci critique – qui point malgré tout dans le besoin de recueillir, interroger, comparer les innombrables documents30 – quelles sont donc les limites à apporter à la représentation, c’est-à-dire pour le dire autrement « jusqu’où peut-on aller dans le catalogue des iniquités sans mettre en cause l’autorité d’historien ? » Dans ce questionnement, les modernes sont fortement imprégnés de l’héritage antique, tant par les sources qui sont les leurs, que par les soucis formels qui les caractérisent. Plusieurs stratégies semblent, en effet, entrer en concurrence. Chaque stratégie semble liée à la fonction commémorative et exemplaire que l’on accorde à l’histoire et surtout à la biographie.
Plutarque dans la Vie d’Alexandre rappelle que son but propre est de faire la part du vice et de la vertu31, et que pour remplir cette mission les faits insignifiants en apparence sont plus parlants que les actions illustres. Ces quelques lignes ont été interprétées par la critique comme l’affirmation d’une spécificité du biographique, spécificité qui se construit autour d’un projet moral, sur lequel, on l’a vu les modernes s’accordent dans les dictionnaires biographiques. Le procès que dresse la postérité repose sur cet équilibre et sur cette mise en balance des actions, avec, toutefois, comme le rappelle Jacques Boulogne, une nette prédilection pour les bonnes actions et les manifestations de sagesse susceptibles32 d’offrir un modèle aux générations à venir, comme le confirme la Vie de Périclès : « Or, puisque notre âme a également reçu de la nature le désir d’apprendre et de contempler, ne doit-on pas à juste titre blâmer ceux qui en font un mauvais usage, qui écoutent et contemplent des réalités indignes de la moindre attention, alors qu’ils négligent le beau et l’utile ? »33 La critique s’adresse d’abord à ceux qui s’attachent à des pacotilles, mais au-delà de ce point de départ de circonstance, Plutarque développe une réflexion théorique qui justifie l’emploi de modèles positifs et qui, de fait, rend la représentation de contre-modèles fort problématique : « Nous devons donc rechercher ce qu’il y a de meilleur, non seulement pour le contempler, mais aussi pour nous nourrir de cette contemplation. »34 En particulier « les actions inspirées par la vertu […] suscitent, chez ceux qui les étudient, le désir passionné et ardent de les imiter. »35 Toutefois dans la « Vie de Démétrios », Plutarque met en avant l’importance de la « dissonance » et des « contraires » pour bien exercer « discernement », « l’intelligence » et « la raison » : « Les arts les plus parfaits de tous, la tempérance, la justice et la prudence, ne se contentent pas de juger du beau, du juste et de l’utile ; ils examinent aussi ce qui est nuisible, honteux et injuste […]. »36 Dans une conception de l’histoire où la représentation du passé se justifie par sa capacité à guider l’action future, la vertu doit se traduire en action et ne pas rester purement théorique. L’émulation, si elle est souhaitable, n’en demeure pas moins problématique, lorsqu’on l’étend à tous les domaines de l’action car « l’admiration que nous éprouvons devant une réalisation ne nous pousse pas forcément à désirer en faire autant. »37 L’excès de perfection freine aussi l’imitation. L’éloge peut réconcilier le beau, le vrai et le bien en offrant comme un parcours moral vers un idéal plus absolu que l’homme public cherchera à réaliser en prenant en compte aussi les erreurs ou les manquements de ses prédécesseurs, d’autant que, comme l’exprime John Marincola : « la renommée d’autrui se réfléchit brillamment des acteurs vers les auteurs et devient visible à travers leurs mots, comme dans un miroir. »38 L’historien tire son autorité même de sa capacité à renvoyer une image de cette gloire qui doit, également pour reprendre Condorcet dans ses Eloges « guérir de la présomption, en montrant, dans un même tableau, la grandeur et les fautes de l’homme de génie »39.
Mably, contemporain de Feller, dans De l’écriture de l’histoire (1775) ainsi que dans De la manière d’écrire l’histoire (1789), semble fidèle à cette vision très traditionnelle de l’histoire comme magistrature. Les adresses régulières au Prince de Parme dans De l’étude de l’histoire vont explicitement dans ce sens : un futur homme d’état doit avoir à l’esprit que ses actions seront reprises au tribunal de l’histoire, cette conscience le poussera à agir dans le respect du bien : « C’est un favorable augure pour les hommes qui doivent un jour vous obéir, si en lisant l’histoire de la Grèce, vous vous êtes intéressé à sa postérité. »40 Michelet est, comme le rappellent Jacques Boulogne et Jean Sirinelli41, un des derniers historiens du XIXe siècle à porter un jugement favorable sur Plutarque et dans sa thèse de 1818, il reprend à son compte son héritage ainsi que la fonction de la postérité comme magistrature : « Les méchants l’occuperont peu ; la mémoire qu’ils ont laissée est stérile comme leur vie. »42 Non seulement certains considèrent qu’il y a une Providence qui voue les crimes à l’échec43, mais plus encore, il y a stérilité parce que personne ne voudrait se servir d’un criminel comme modèle et chercherait à reproduire ses actions. Or, cet aspect de l’histoire est justement remis en cause lorsque les auteurs peignent des criminels.
Cependant face à cet éloge de la vertu et de la représentation des actions vertueuses dans l’héritage de Plutarque, on trouve sous la plume de Tacite l’expression d’un regret. Ce regret, au contraire de ce qu’affirment les tenants d’une commémoration heureuse, semble suggérer que c’est la peinture de la noirceur qui entraîne le plus aisément l'adhésion du public, aux dépens non seulement des belles actions, qui ne sont plus le signe du vrai mais de la flatterie, mais aussi d’une représentation équilibrée et nuancée des faits : « Mais les flatteries d’un auteur inspirent aisément de la répulsion, le dénigrement et l’envie sont accueillis d’une oreille complaisante ; eh oui ! l’adulation appelle le reproche déshonorant de servilité, la malignité a une fausse apparence d’indépendance. »44 Y aurait-il donc plus d’autorité à gagner à dénoncer le crime ? Peut-être, mais ce n’est qu’une autorité fallacieuse, parce qu’elle répond aux passions mêmes du public qui veut assouvir sa haine, comme le rappelle également Tacite au début des Annales : « L’Histoire de Tibère, de Gaius, de Claude et de Néron, faussée par la peur, au temps de leur puissance, fut, après leur chute, composée alors que les haines étaient toutes fraîches. »45 Le récit des crimes trouve une légitimité dans le seul fait qu’il corrige a posteriori les mensonges des tyrans et de leur propagande. Mais cette caution qu’offrirait la prétendue vérité du crime et de sa dénonciation est fragile car le blâme, en lui-même, n’échappe ni aux passions et aux excès, ni aux éventuelles complaisances, le successeur trouvant parfois de l’intérêt à ce qu’on noircisse celui qui l’a prédécédé pour justifier son propre pouvoir.
Par ailleurs la prétendue sanction de la Postérité a un poids tout relatif, comme le montrent les pensées que Tacite attribue à Othon à la veille de son usurpation criminelle. Le jugement des générations futures ne saurait le freiner dans son action. De ce fait, ces réflexions apparaissent comme un commentaire de l’entreprise de l’historien dans la mesure où l’énergie de l’homme d’action face à la mort semble l’emporter sur la moralité des actes par lesquels il reste dans le souvenir collectif : « La mort, égale pour tous selon la nature, ne diffère, devant la postérité, que par l’oubli ou la gloire ; et si l’innocent, et le coupable doivent avoir la même fin, c’est se montrer un homme de cœur que de mériter sa mort. »46 Othon devait agir, sans hésiter et on perçoit une certaine admiration de Tacite devant l’énergie de l’usurpateur bien que son action fût qualifiée de « crime » (I, XVIII, 1). La réprobation semble ainsi céder aux prestiges de la force.
Peut-on même parler dans certains cas de fascination que suscitent les objets du blâme ? Tacite se réclame, dans les Annales, d’une représentation impartiale des diverses interprétations qui ont entouré les actes de Tibère. L’historien dénonce l’hypocrisie même du successeur d’Auguste et sa dissimulation. L’insincérité caractérise les premières paroles publiques du nouvel empereur qui fait mine de respecter les formes attendues mais qui, de fait, en subvertit la teneur véritable : « Il y avait, en un tel discours, plus de souci des convenances que ce sincérité, et Tibère, même sur des choses qu’il ne cherchait pas à dissimuler, usait toujours, soit par nature, soit par habitude, de mots à double entente et obscurs. »47 En essentialisant ainsi certains traits fondamentaux de Tibère, Tacite offre par certains côté un portrait plus à charge que celui que dresse Suétone même. En effet, Suétone laisse place dans la première partie du portrait à des interprétations plus favorables48 des commencements du règne de l’empereur qui est défini par sa généalogie même comme un être double, capable d’exploits et de crimes (« Beaucoup de Claudius se signalèrent par de nombreux exploits, d’autres par de nombreux méfaits »49), tandis que tout pour Tacite se ramène aux manœuvres dissimulées du tyran et à son amour pour le mensonge. La promesse de dire la vérité dont se réclame l’auteur des Histoires implique de « parler de chacun sans amour et sans haine »50 mais cet engagement cache difficilement le malaise qui touche à la représentation historique, tant la noirceur domine, dans un « ouvrage empli de malheurs, ensanglanté de batailles, déchiré de révoltes et, au sein même de la paix, féroce […] »51. Le sujet accentue une certaine asymétrie dans la représentation que constate également Richard T. Vann à notre époque, asymétrie qui fait que l’éloge fait l’objet de soupçons, tandis que la remise en cause des figures les plus illustres semble faire taire plus aisément la critique52. Le souvenir historique se justifie, selon John Marincola, par sa capacité à offrir des explications et, de ce fait, à rendre compte de ce qui s’est passe53. De façon significative, Tacite met au second plan les péripéties et leur dénouement, en l’occurrence le récit des troubles, des guerres et des soulèvements au profit de l’explication : d’une certaine façon, c’est dans l’établissement de ce schéma explicatif que l’horreur trouve une justification supplémentaire54 parce qu’il y a là un mystère que le temps doit éclaircir. La cohérence des actes, la propension précoce au crime valent explication. Mais, du même coup, elle sape le dispositif même de la commémoration, dans la mesure où les criminels sont présentés avant tout comme des dirigeants qui n’ont pas su ou pu s’inspirer des grands exemples qui leur ont été donnés. C’est un signe avant-coureur décisif de leur perversité latente que l’historien donne à voir et que le lecteur est invité à contempler à son tour avant de la voir se confirmer dans toutes les actions subséquentes. Le motif mine l’image du tribunal de la postérité que convoquent les historiens pour justifier leur peinture du crime : le monstre, ce contre-exemple qu’on ne devrait pas suivre, se perpétue, il est le symptôme des temps troublés, où les repères du juste et de l’injuste se trouvent bouleversés. Les analogies récurrentes entre les criminels antiques et modernes réactualisent le topos.
Regardons, en effet, du côté des pamphlets de la Révolution française : ils ont pris la forme de Vies, d’histoires centrées sur une ou plusieurs personnages et ont exacerbé des combats idéologiques qui, on l’a vu, s’exprimaient dans dictionnaires biographiques55, soit pour revendiquer le devoir d’une fausse neutralité, comme dans les nombreuses rééditions de l’ouvrage de François-Xavier Feller, soit au contraire pour se défendre de toute accusation de partialité, comme dans l’ouvrage de Michaud. Si leur ton est à l’exagération, les auteurs de ces textes hybrides se sont souvent réclamés de l’histoire. Qu’on songe, au-delà même des histoires des seuls criminels, aux titres déclinés par le monarchiste Galart de Monjoie dans l’esprit de la Conjuration de Catilina de Salluste, à savoir l’Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre de 1796, l’Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, premier prince du sang, publié la même année, ou l’Histoire de Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne de Lorraine, reine de France, 1797. On pense également à une série de publications au caractère là encore commun, l’Histoire véridique et impartiale du procès de Charles Premier, Roi d'Angleterre, avec des anecdotes peu connues et intéressantes par l'auteur du Dictionnaire National56, 1791, l’ Histoire impartiale du procès de Louis XVI, ci-devant roi des français de Louis-François Jauffret, 1792-93, ou encore l’Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française, publié en l’an V, par Louis-Marie Prudhomme. Le titre renvoie à la volonté de corriger les représentations concurrentes en soulignant une impartialité qui, de fait, n’est pas toujours au rendez-vous.
Les parallèles que les auteurs ont dressés entre les crimes et les conspirations commis pendant la révolution et l’histoire romaine, prouvent à quel point les monstres romains font partie intégrante de leur rhétorique. On en comprend la raison quand on lit justement certaines notices biographiques de Feller qui donnent à certains empereurs criminels un caractère générique57 : ces dirigeants honnis par la postérité offrent un cadre commode et compréhensible pour toutes les personnes instruites. C’est donc à leur aune qu’on peut juger de l’action des contemporains en ces temps si troublés. Le rapprochement même a une valeur polémique.
Un autre topos pose le problème du mauvais usage des modèles et des contre-modèles laissés par la postérité. Ainsi le Robespierre de Montjoie est conçu comme l’envers du héros qui, ambitieux et grand, recherche la justice et met en place les conditions nécessaires à la vertu de tous58. Au contraire, la petitesse du révolutionnaire le rend incapable de comprendre les exemples qu’on lui donne à lire au collège, en raison de la « fausseté de son esprit et la noirceur de son âme » : « ou ses héros étaient des monstres, ou il ne savait tirer des actions qu’il admirait que des conséquences erronées et funestes. »59 Ce lieu de la mauvaise imitation ou de l’imitation mal comprise est un écho évident de Caracalla qui se prend pour Alexandre, de Commode et de Néron qui croient pouvoir imiter Hercule60. Le topos est en quelque sorte à double tranchant, puisque la mauvaise imitation confirme la perversité profonde de l’individu qui ne comprendrait pas le code de la commémoration héroïque, ni les sentiments d’émulation qu’elle doit entraîner. Mais en même temps, l’erreur même témoigne des dangers qu’il y a à fournir à la postérité des modèles. Il y a, de ce fait, un conflit, comme chez les Anciens, entre la volonté d’expliquer les crimes et le désir de justifier le catalogue des monstruosités par l’invocation de la postérité. Monjoie constate ce conflit dans le présent mais émet le vœu de le résoudre pour les générations suivantes qui doivent apprendre « à se préserver des pièges où nous avons donné »61. L’argument est suivi par des remarques qui rappellent Tacite, d’abord par les éclaircissements qu’il prétend apporter, ensuite par son impartialité supposée et de fait totalement fictive, comme nous avons pu le montrer plus haut.
Il est remarquable de constater que dans le flot de monstruosités que la Révolution se plaît à déverser sur le papier, se trouve à la fois la référence à la postérité qui rétablira la justice bafouée et qui préservera l’avenir des maux présents, et une interrogation plus sombre sur l’échec éventuel de cette entreprise. Comment dès lors justifier le catalogue des crimes, si la postérité ne saura rien en faire ? Le partisan du Directoire, Louis-Marie Prudhomme62, dans l’Histoire impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française, invective ces « cent bouches de la renommée », parce que « pas une seule ne s’est ouverte pour apostropher les bourreaux de l’espèce humaine »63, et rappelle tous les forfaits des grands tyrans, de Busiris, à Cyrus, en passant par Néron, pour montrer qu’à chaque fois le jugement de l’histoire est tombé trop tardivement. Sa justification est donc d’offrir un « déplorable répertoire de tous les attentats dont la perversité humaine est capable, quand elle peut tout […] »64, sans attendre, mais cet acte de justice est sapé par le fait même de ces révolutionnaires qui « avec l’intention de devenir meilleurs, […] se rendent plus méchants »65. Son interrogation sur le sens à apporter aux crimes dans un processus de mémoire et de réconciliation se fait plus précise et mérite d'être reproduite dans la mesure où le texte est peu connu :
Mais nous dira-t-on, pourquoi rappeler sans cesse des scènes de carnage ? pourquoi reproduire toujours les tableaux révoltants de tous ces cadavres amoncelés sur le sol de la France, trempé de sang humain ? Un répertoire de belles actions, de traits généreux serait plus consolant et plus utile : il servirait du moins à rapprocher les citoyens, à leur faire oublier des torts réciproques, au lieu de les aigrir, de les ulcérer… Nous répondrons, en disant que nous n’avons que trop appris pendant sept années d’expérience, à connaître le cœur humain. Assez longtemps les méchans ont porté la terreur dans l’âme des bons, il faut à notre tour, porter l’effroi dans l’esprit des méchans, mettre à nu leur âme cadavéreuse, leur montrer qu’on les connaît bien, qu’on a surpris leurs secrets, et que ce n’est qu’en les laissant exposés sur la roue des remords, qu’on parviendra à purger la France de leurs complices. Les bons citoyens n’ont pas attendu nos tableaux pour se rapprocher, mais ils se serreront davantage encor, en frissonnant d’horreur, au spectacle des monuments d’atrocité que nous leur ferons connaître dans tous les détails.66
L’écriture des crimes se justifie moins au nom des craintes qu’aurait le mauvais homme d’état de voir son nom flétri par la postérité, parce que celle-ci a joué un rôle de garde-fou insuffisant. Le contexte thermidorien de réaction à la Terreur67 explique que la dénonciation soit destinée au présent et non pas à l’avenir, d’où la topique du dévoilement qui caractérise le passage. Il s’agit de mettre en lumière les complots, la méchanceté cachée, afin que le criminel soit puni ici et maintenant ou qu’il puisse se réformer. Le désir d’exhaustivité se justifie par le fait que chaque détail contribue à ôter un à un tous les lambeaux de mensonges accumulés. Pour le dire autrement, il faut être exhaustif parce que la postérité offre une garantie trop faible et parce que la réalité de façade pourrait tromper les générations futures comme elle a trompé les générations présentes. Il y a une obsession du complot qu’analyse Joseph Zizek68. Elle détermine une narration qui se déclare explicative et qui pourtant privilégie une forme fragmentée, « vaguement reliée à la succession des gouvernements et aux prétendus abus qu'ils auraient orchestrés. »69 L’horreur crée une tension entre la discontinuité d’une narration conçue comme un registre et la nécessité revendiquée de fournir des explications. La répétition de faits analogues ne doit pas être écrasée, à l’inverse de ce que choisit de faire l’article de Quatremère de Roissy sur Caligula, mais soigneusement restituée parce qu’il faut préserver le nom des victimes, ne serait-ce que sous forme de listes, il faut également établir les responsabilités réelles, ce qui a pour conséquence que l'on doit distinguer l’action des peuples, « matières volcaniques, qu’une étincelle suffit à embrâser [sic] »70, des manipulateurs, les auteurs véritables mais cachés71, d’où là encore la nécessité d'être exhaustif afin de suivre « le fil de toutes les trames dans le dédale ténébreux de tous ces spéculateurs politiques »72, afin de prouver, l’idée fera son chemin, que le peuple est innocent, alors que les notables sont coupables73.
Cette obsession du complot se retrouve dans un autre ouvrage au titre évocateur publié également par Prudhomme mais écrit par Louise-Félicité Guinement de Keralio, Les Crimes des reines de France, depuis le couronnement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette74. L’ouvrage fait suite aux Crimes des Rois de France, publié en 1791 puis en 1792 par Louis Lavicomterie de Saint-Samson, également par le bureau de la Révolution de Paris. L’ouvrage de la républicaine Louise-Félicité Guinement de Keralio a pour but de montrer que les rois n’ont pas toujours eu l’énergie nécessaire pour commettre des crimes et que ce sont leurs épouses et leurs mères qui les y ont poussés. Cette critique des femmes mauvaises conseillères, qui apparaît ici sous la plume d’une femme, est un lieu commun des critiques portés contre les rois, même sous l’Ancien Régime. On met ainsi en cause leur virilité et leur capacité à diriger. Les reines qui se succèdent chronologiquement depuis les temps mérovingiens illustrent un fantasme politique qu'on trouve sous la plume de Jean Froissart notamment et dont on trouve la trace également dans les portraits de Tibère ou de Commode : malheur à l'état dont le dirigeant serait entouré de marmousets (Froissart), d’affranchis (Suétone) ou de femmes intrigantes. L’ordre naturel dans ce cas est subverti et la faiblesse qui alimente la faiblesse est un des plus grands vecteurs de cruauté qui existe : « Les peuples qui ne sont pas encore las d'avoir des rois, devoient du moins exiger d'eux qu'ils fussent athées, bâtards et eunuques »75, afin qu’ils échappent à l’influence occulte des prêtres, de la famille et des femmes. On est dans un monde à l’envers qui rappelle au lecteur un passage célèbre des Histoires de Tacite : « Tout se vendait, les affranchis étaient tout-puissants […]. »76 La féminisation du pouvoir est l’image moderne d’une société qui, selon Guinement de Keralio, a perdu ses hiérarchies naturelles, avec un renversement d’autant plus évident de la rhétorique absolutiste, qui promeut la figure du roi père de ses sujets, que la monarchie est accusée de privilégier l’intérêt privé d’une seule famille aux dépens de la nation. Dans l’antiquité, la féminisation se marque par la sexualité passive attribuée à un Néron qui devient « femme » de son affranchi Doryphore77. Le motif se combine dans l’antiquité avec une mise en spectacle honteuse des empereurs, selon un schéma, rappelé dans les Dictionnaires biographiques, qu’on trouve à la fois pour Néron et Commode. Les femmes criminelles ont, elles aussi, leur équivalent romain : Agrippine, les deux Faustines « qui souillèrent les deux plus beaux règnes des Annales de Rome. Antonin et Marc-Aurèle eussent été les souverains les plus accomplis de toute l’histoire, sans leur faiblesse pour leurs femmes. »78 Le but du parallèle est de mettre en évidence l’illégitimité de la fonction de reine qui fait sortir les femmes de leur rang naturel.
L’on verra dans le cours de cette histoire comment nos princesses en soutinrent le fatal éclat [i.e. du rang de reine]. On y verra comment la nature s’est jouée de nos institutions sociales, qui heurtent tous nos principes, comment elle a rendu le plus tranquille, le plus doux, le plus compatissant des deux sexes susceptible des appétits les plus violens, des passions les plus malfaisantes, des caprices les plus sanguinaires : et si la révolution de 1789 n’est pas venue plus vite, si la nation française ne s’est trouvée réduite aux abois plus tôt, la faute ne doit pas en être imputée à nos reines ; c’est que nos ressources furent encore plus inépuisables que leur mauvais génie n’eut de fécondité ; c’est que le mal, comme le bien, quand il est fait sans suite, n’opère qu’à la longue. Si nos souveraines avoient été dotées de la perversité réfléchie de Tibère, il a long-tems qu’on ne parleroit plus des François en Europe. Mais malgré la fertilité d’imagination des femmes ambitieuses, vindicatives et toutes-puissantes, la nature, en voulant bien leur accorder l’aptitude de commettre tous les forfaits, pour avertir les hommes de les faire rentrer à leur place, ne leur a pas fait heureusement le don de la prudence.79
La répétition et la succession des transgressions ont valeur de preuve et la nature y est érigée comme norme constante. La série des criminelles est formée d’abord par Basine reine de Thuringe, reine adultère. Sans transition, Guinement de Keralio passe à Clotilde « à qui les moines ont décerné les honneurs de l’apothéose »80 et qu’elle présente comme une femme intrigante, hypocrite, ambitieuse et surtout cruelle. Sa canonisation symbolise la fausseté et l’erreur sur lesquelles repose la royauté dès ses commencements : Frédégonde, Brunehaut, ces grandes rivales entraînent à leur suite la mort de 20 000 hommes et ce n’est que le début d’une longue liste. Le parcours permet de couvrir l’ensemble de l’histoire française, jusqu’à Marie-Antoinette, en passant par Catherine de Médicis. Si Blanche de Castille peut apparaître comme une exception, elle participe tout de même à l’illégitimité générale par les mauvais modèles, notamment hagiographiques, qu’elle a transmis à son fils :
On prétend qu’elle lui faisoit étudier l’histoire. Eh ! quels étoient les auteurs qui pouvoient la lui apprendre ? Les chroniques mensongères des couvens, les vies des saints, la légende dorée et autres écrits, uniques productions du génie françois et propres à augmenter l’ignorance des rois et celle des peuples ?81
Plus loin, l’image de la mère de Saint Louis se fissure encore davantage : la voilà assimilée à « la mère de Néron »82 ce qui par analogie ne manque pas de rapprocher Louis IX de l’empereur lui-même ! Aux Néron, Caligula, Domitien répondent les Agrippine, les Faustine, les Domitia : telle est la rhétorique récurrente de Louise-Félicité Guinement de Keralio tout au long des 460 pages que comporte l’ouvrage.
Mais l’avertissement de la postérité n’est crédible que parce que les Français ont vécu ce qui est décrit pour d’autres reines de France. La succession des reines criminelles tend vers un seul but, le couronnement de toute cette succession de crimes et d’abus : Marie-Antoinette83. Le texte renvoie à l’épisode de Varennes, elle en est l’instigatrice, c’est elle qui menace la France par ses complots. L’auteur adresse ces derniers mots à la reine qu’elle invective et menace :
Antoinette ! Tu peux seule te juger ; tu peux seule te dire à quel point la nation a le droit de te haïr. […] N’espère pas que les écrivains gardent un lâche silence sur les entreprises de tes agens et des tiennes […]. Le feu de la liberté, le saint amour de tous, brûle encore dans le cœur des écrivains ; leurs concitoyens les appellent, le sort de leur postérité les enflamme, et l’être qui dans son cœur a juré de vivre libre ou mourir, se joue de la colère des tyrans.84
Le rappel des crimes antérieurs se justifie non seulement parce qu’ils éclairent le présent mais parce qu’ils poussent à l’action. La tyrannie doit être renversée et celle qui ne peut qu’être coupable doit attendre le châtiment de la nation.
Le rappel de l’existence des grands criminels, la place qu’ils occupent dans le titre même des dictionnaires biographiques se justifie au même titre que les figures utiles et bienfaitrices, les artistes, les écrivains marquants et les grands hommes d’état. Ils donnent lieu à des stratégies contradictoires de commémoration des forfaits, de réhabilitation partielle, au nom de nouvelles lectures critiques, ou d’une essentialisation du mal au nom d’une construction téléologique du personnage. Peu commenté, le blâme est sans doute plus difficile à justifier que l’éloge. Les grands modèles négatifs fonctionnent-ils comme les grands modèles positifs dans une conception de l’histoire qui reste fidèle, malgré l’émergence d’une nouvelle histoire critique, à la magistra vitae ? Si la noirceur attire et convainc parce qu’elle semble rompre avec des éloges feints et flatteurs, elle suscite également de mauvaises lectures, une perversion, en somme, des grands modèles offerts à la postérité. La reproductibilité des crimes, leur cohérence permettent une typification commode du criminel à laquelle les dictionnaires et les recueils de vies participent. Le grand criminel répond à un type, d’où sa force rhétorique, lorsque l’évocation des grandes figures du passé a pour fonction d’inviter à l’action.