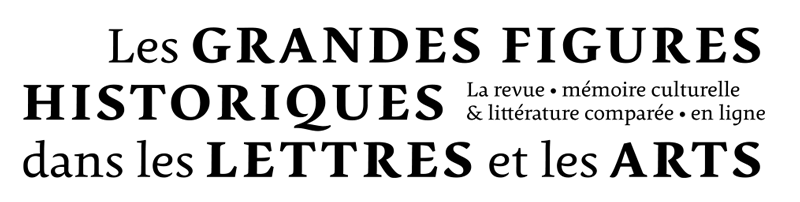Il paraît évident de considérer l’être humain comme le produit mais aussi comme le producteur d’une histoire qui le façonne. Si sa conscience individualise et unifie son point de vue sur le monde, rien n’indique qu’il soit pour autant le seul sujet animal à percevoir l’histoire de sa propre vie. L’animal peut se révéler le témoin conscient de son histoire, mais aussi de celle d’autres animaux : l’homme, par exemple.
Chez Bela Tarr le cheval paraît véritablement habité par une conscience du monde qui l’entoure, mais encore – le réalisateur l’annonce dès le départ – être plein, à sa façon, d’une histoire qui vient de se produire et dont on connaît le dernier épisode : l’effondrement de Friedrich Nietzsche, le 3 janvier 1889, sur la piazza Alberto à Turin. Le philosophe se serait jeté, en pleurant, au cou d’un cheval de fiacre épuisé et brutalisé par son cocher. Puis il aurait perdu connaissance. Après cet événement, il n’écrira plus. Déclaré fou, il restera enfermé jusqu’à la fin de ses jours. En 1930, le critique littéraire et anthropologue, Erich Friedrich Podach, publie une étude intitulée L’Effondrement de Nietzsche, dans laquelle, pour la première fois, il est fait référence aux conclusions d’un psychiatre turinois chargé d’examiner le philosophe : « Le désordre mental actuel est le premier dans la vie du malade […]. Le patient prétend être un homme illustre, ne cesse de réclamer des femmes. Diagnostic : faiblesse du cerveau. »1
Pour ne pas en finir avec Nietzsche
La légende nietzschéenne, qui prend assurément sa source bien en amont de cet épisode traumatique, trouve cependant dans cette crise sa plus vive inspiration. Le penseur illustre, aux idées bouleversantes rayonnant bien au-delà de ce XIXe finissant, et dont l’œuvre est archivée de son vivant, vit encore onze longues années, transporté parfois d’un hôpital à un autre (Iéna, Nuremberg…). Il semble mort pour la pensée, comme l’on pourrait le dire d’un soldat qui s’est sacrifié pour son pays. Seulement son corps, le corps qui a agi – ou, même, « marché » –, cette œuvre unique n’est plus le témoin que d’une autre vie qui a pourtant toujours été la sienne, sa vie d’homme.
Après Turin, le philosophe n’a pas disparu. L’homme a vécu ; il a persisté à se survivre. L’œuvre semble née de son inachèvement brutal et à jamais irrémédiable. Et les commentaires ont pris le relais de la pensée, tentant de la poursuivre, comme on poursuit une célébrité après son spectacle, son discours, sa prestation. La songerie, puissante volonté de donner vie, a inventé Nietzsche – jusque dans les abîmes de l’Histoire – revenant sans cesse à ce jour, à ce lieu, à ce cheval. Et pourtant, la vie de l’autre acteur de cette scène mythique importe peu.
En 1965, Gilles Deleuze ouvre ainsi le livre qu’il consacre au philosophe :
Le premier livre de Zarathoustra commence par le récit de trois métamorphoses : « Comment l’esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Le chameau est l’animal qui porte : il porte le poids des valeurs établies, les fardeaux de l’éducation, de la morale et de la culture. Il les porte dans le désert, et, là, se transforme en lion : le lion casse les statues, piétine les fardeaux, mène la critique de toutes les valeurs établies. Enfin il appartient au lion de devenir enfant, c’est-à-dire Jeu et nouveau commencement, créateur de nouvelles valeurs et de nouveaux principes d’évaluation. Selon Nietzsche ces trois métamorphoses signifient, entre autres choses, des moments de son œuvre, et aussi des stades de sa vie et de sa santé. Sans doute les coupures sont-elles toutes relatives : le lion est présent dans le chameau, l’enfant est dans le lion ; et dans l’enfant il y a l’issue tragique2.
« L’animal qui porte : il porte le poids des valeurs établies, les fardeaux de l’éducation, de la morale et de la culture. » Comment ne pas voir dans ce cheval à Turin l’incarnation de ce premier état, cette bête de somme, bâtée pour servir l’entreprise de l’homme ? Bête qui va, « à rebrousse-poil », rembobiner le film nietzschéen ou zarathoustrien et revenir à ce « stade » que l’homme et l’animal n’ont jamais quitté. Il s’agit alors de reprendre en conscience cette charge sisyphéenne, dans une existence obérée par le seul fait de vouloir persister à être. Est-ce là la première étape du renversement des valeurs d’une société qui sait se rendre plus cruelle encore que la vie ?
Le Cheval de Turin raconte, à la croisée des destins, l’autre suite des événements, ce qu’il advint du cocher et de sa fille, mais avant tout – et c’est la raison d’être et le « moteur » du film3 – ce qu’il en fut du cheval. Le récit est celui du retour des trois protagonistes oubliés, voire ignorés par l’histoire, dans une ferme reculée, et ce qu’ils vécurent les six jours qui suivirent cette journée d’hiver 1889.
Mais Nietzsche n’a pas totalement disparu du film. Les premières images donnent à voir, ou plutôt à entendre, le récit des derniers moments vécus par le philosophe avant sa chute, du logement qu’il quitte au six via Carlo Alberto à ses derniers mots, adressés à sa mère, de retour dans son appartement : « Mutter, ich bin dumm ! »4 ; seulement, tout comme Nietzsche ne reviendra pas à la vie intellectuelle qui fut la sienne, au philosophe le film ne fera plus allusion.
Du cheval nous ne savons rien
La voix off poursuit : « Du cheval nous ne savons rien. » Le cinéma de Béla Tarr va réparer le mépris de l’histoire. Mihály Víg entre alors en scène, avec le cheval et le cocher. Le compositeur et poète, complice de Béla Tarr depuis 1988, va, tout au long du film, accompagner les images d’une musique omniprésente, lancinante, inexorable, soutenue par des cordes mêlant notes tenues et d’autres répétées, mécaniques. La composition est parfois coupée, brièvement, comme si elle reprenait sa respiration. L’image brumeuse, ventée, souvent sombre, n’est pas la seule à donner le ton ; la musique imprime dès le départ à l’œuvre son caractère fatidique, prémonitoire.
Si le fondu enchaîné a introduit le « héros » à l’écran – le cheval –, la musique, elle, arrive presque ex abrupto. Elle doit avoir commencé avant, avoir même toujours été là. Le cadre montre l’animal de face, nous sommes proches de lui, le cocher ne tarde pas à apparaître derrière, plus haut, plus loin. Il faudra attendre pour que la caméra se dirige vers lui, un instant, et pour saisir finalement ce couple uni par cette tâche d’avancer contre une tempête, rendue visible par les feuilles et la poussière qui volent, la crinière du cheval et les cheveux du cocher qui s’agitent, mais qui reste inaudible. Il faudra attendre quatre minutes pour qu’enfin la bande son fasse entendre le pas lourd de la bête et les cliquetis de la charrue.
Il est temps de rentrer, tout comme Nietzsche, délaissé à son tour, après cette ouverture, cette marche inexorable qui semble contredire la notion même de voyage, de déplacement, tant le pays parcouru paraît s’être effacé au fur et à mesure sous l’effet de cette tempête silencieuse. Mais il fallait bien cela pour oublier Nietzsche. C’est un anti-périple, un cheminement à rebours. On comprend vite qu’il s’agit de s’en retourner chez soi. Ce mouvement est parallèle au retour de Nietzsche dans son appartement, vers un lieu identique, initial – alors que pour le philosophe devenu fou ni lui-même ni l’endroit ne sont plus les mêmes. Les dynamiques qui animent les acteurs de cette scène ne s’avèrent-elles pas antagonistes ?
En effet, le philosophe de l’éternel retour aurait pu, si la démence ne l’avait pas totalement envahi, se demander s’il est vraiment possible de revenir, tandis que la condition même de ce modeste cocher le conduit à se poser une autre question : est-il possible de partir ? De quitter ce monde qui anéantit peu à peu tout espoir de le vivre ? Et que lire dans l’œil de la bête pour connaître sa question, pour voir ce qu’elle perçoit, pour savoir ce qu’elle sait ? Pendant toute la durée de ce plan-séquence en travelling avant qui tantôt précède et tantôt accompagne cette course, le regard de l’animal est masqué par l’œillère, rappel de sa fonction et sa condition. Mais son regard n’est pas absent, il est approché, comme envisagé. Le film va-t-il dévoiler le point de vue qui se cache derrière ce morceau de cuir, cette deuxième paupière, cette seconde peau ?
Est-ce la douleur de l’épisode de Turin qui va se lire encore dans le regard, voire le corps du cheval de somme ? Est-ce celle d’avoir subi une fois encore, une fois de trop, la colère et les obtuses remontrances de son propriétaire ? Est-ce que ce cheval aurait déjà, lancé contre ce blizzard et cet épais brouillard, la prescience d’un événement dont il serait le prophète ?
L’homme est l’animal qui a porté à son paroxysme l’individualisme, se refusant d’admettre que la logique même de la nature fait prévaloir la sauvegarde de l’espèce sur celle de l’individu. Alors, face à ce cheval, le spectateur est tenté de se demander s’il a affaire à un représentant de l’espèce, celui d’une animalité générique mais excluant apparemment l’humain, ou bien à un individu, sujet et conscience du monde, dont l’animalité et la chevalité pourraient n’être que des aspects, des déterminants parmi d’autres. Ce cheval ne peut pas être réduit à un symbole, ou à « une séquelle malencontreuse de ce que dit d’abord le mot cheval, à savoir la chevalité elle-même ! »5
Ce n’est pas la première fois que Béla Tarr filme les animaux. Il s’agit même d’une figure récurrente de son cinéma. Songeons, entre autres, à cette baleine échouée sur un camion de cirque abandonné sur la place d’une ville hongroise dans Les Harmonies Werckmeister6. L’animal, seul, à l’épicentre d’un monde déchu, est là pour figurer un ordre naturel – c’est-à-dire n’en être plus que la figure – dont l’homme, dans sa quête absurde d’harmonie, s’est depuis longtemps détourné. On pense également à ce troupeau de vaches, dans Sátántangó7, que l’on suit de son apparition à sa disparition, dans le paysage désolé d’une campagne industrielle, sans ciel, au cœur de cette ferme collective que l’entreprise communiste a désertée. Même si quelques vaches retiennent brièvement l’attention de la caméra, cette dernière se laisse porter, au gré du rythme du groupe, par sa loi. En un plan séquence de plus de sept minutes, soutenu par des nappes sonores obscures et lointaines, parfois battues par le vent et ponctuées de meuglements, un élan social paraît avoir survécu.
Le décor du Cheval de Turin a les mêmes teintes : la tempête s’est levée, la ferme est à présent résumée à sa plus modeste expression, l’animal est seul et occupe le plus souvent tout le cadre. Il est encore debout, encore en vie, mais il paraît déterminé à quitter ce monde. Tout son corps exprime non pas un message qui aurait trait à l’existence, mais une souffrance à être, que l’humain peut, comme d’autres animaux et en tant qu’animal lui-même, ressentir. C’est ce qui déstabilise profondément le lecteur de Kafka, cette angoisse sourde et pourtant familière d’une individualité post-mythologique, détachée de toute transcendance, coupée de tout espoir. Le héros kafkaïen, être seul et désemparé, est – ou reste – animal8. Il continue malgré tout et par-dessus tout. Il est fait d’un langage corporel qui signifie, qui pense.
Le cheval est l’animal moteur par excellence. Mais, chez Béla Tarr, le cheval est un moyen de communication qui, de force motrice, devient force expressive, oracle malgré lui9. Cet animal si proche de l’homme, si intensément présent, ne perd jamais, par le travail soigné de l’image, sa force figurale, une signifiance animale, vitale. Il incarne aussi un savoir qu’il devait sans doute, jadis, partager avec les humains. Cette œuvre ouvre le champ d’un penser animal et cherche à retrouver la voie/voix d’une sagesse interrompue.
L’animal politique
Le cheval, bête de somme, semble refuser d’être assimilé à un animal « sans individualité ni personnalité, qui n’est plus qu’un produit infiniment renouvelable »10, comme l’industrie qui a pris un essor impressionnant en cette fin de siècle commence à les mettre au jour. L’animal n’est-il pas le souffre-douleur par excellence du Capital ? Un « animal politique » au sens où a pu l’entendre Rosa Luxemburg prenant pitié pour les buffles exploités sans répit, chargés à mort, et tués à la tâche, dans l’enceinte de la prison où elle était retenue prisonnière pour insulte au pouvoir, ce même pouvoir détruisant, de la même manière, les ouvriers qui l’alimentent de leurs vies11. Mais cette pitié est aussi et d’abord celle de Nietzsche pour cet animal singulier, pas « un » animal, pas « un » cheval, mais cet individu, dont le film relate quelques jours de la vie.
L’absurdité de ce monde, de cette grande entreprise dans laquelle tout est emporté par un intérêt supérieur, aussi invincible qu’absurde, le cheval n’est pas le premier à la ressentir, mais le seul à l’exprimer de tout son être. Il refuse d’avancer. Le cocher le fouette, en vain. Le vieux paysan fouette et fouette encore, mais il sait bien, pourtant, qu’il ne pourra pas le fouetter inlassablement. La scène primitive (ou définitive), celle de l’effondrement, est comme jouée à nouveau, autrement. Nietzsche n’est plus là, mais c’est une autre chute qui se profile, tout comme l’attitude du cheval rappelle à son tour celle d’autres animaux qui, soit ressentant un danger imminent soit se préparant à une mort certaine, restent prostrés, sans appétit, ou se mettent à l’écart. N’est-ce pas alors une seule et même condition, animale et humaine, « inanimale » plutôt qu’inhumaine, qui est vécue ? Béla Tarr, dans et par le corps du cheval, montre simplement le fait qu’il « n’est pas simple de vivre »12. C’est par la simplicité des plans, la rareté des actions qu’est exprimée cette évidence existentielle que l’homme s’évertue à nier. N’est-ce pas le plus dangereux des nihilismes, celui qui ne consiste pas à refuser les valeurs d’un monde antinaturel, mais à refuser de les voir, et de croire qu’elles ne sont pas les seules ?
Béla Tarr oscille entre un existentialisme sombre et un naturalisme qui exclurait tout pathétique. Il réalise un anti-mélo. Il ne s’agit pas de s’attarder sur une condition de l’être déjà si pesante, une somme si lourde. Le cocher et sa fille ont des rituels qui ne sont jamais ou ne sont plus des ritournelles rassurantes, fondatrices : la consommation de pommes de terre, l’entretien du cheval… Peu de mots, quelques gestes du quotidien, répétés tous les jours, pendant six jours. Se coucher, se lever, boire deux verres de palinka, aller chercher de l’eau au puits… Cela pourrait paraître ordinaire, voire rassurant, s’il n’y avait chaque fois l’apparition d’un détail différent, toujours plus inquiétant. Chaque jour, à travers ces signes avant-coureurs, le monde chemine plus avant vers sa déconstruction. Triste ironie de cette défection progressive que ce mélange de compréhension et d’effacement. La fatigue d’exister, de plus en plus sensible, celle qui unissait Nietzsche et le cheval, conduit à l’oubli. Mais cet oubli d’être a commencé depuis longtemps.
L’ennui, dans les films de Béla Tarr, n’est pas fui. Ce n’est pas non plus un sentiment que le spectateur doit refouler, au contraire, il doit en faire l’épreuve. L’ennui permet une rupture temporelle salvatrice ; il devient un outil esthétique et une arme politique. Martin Heidegger, dans les cours qu’il a donnés en 1929-1930 à l’Université de Fribourg, fait le rapprochement entre l’expérience de l’ennui profond, la tiefe Langeweile, et la stupeur de l’animal, ce qui l’absorbe, et l’envoûte, la Benommenheit13. Si, dans une formule restée célèbre, le philosophe a pu évoquer une conscience animale « pauvre en monde »14, il ne refuse cependant pas de considérer l’expérience animale comme digne d’intérêt. Il fait remarquer toutefois que « le règne animal exige de nous une manière tout à fait spécifique de nous transposer en lui »15. Cette expérience de l’ennui ouvre sur ce qu’il appelle un « profond devenir »16 :
Il faut donc apprendre à s’ennuyer davantage, à s’enfoncer encore [ …] Dans l’ennui profond, nous nous trouvons abandonné dans le vide. Le monde ne disparaît pas, mais il se montre dans son indifférence.17
N’est-ce pas cette quête qui anime Béla Tarr, celle du saisissement, ou du ravissement par le temps, que tout animal peut connaître, et que l’humain a tout bonnement oublié, ou renié18 ? Cet ennui-là est aussi affaire de climat. « Sommes-nous tels, demande Heidegger, qu’un ennui profond s’étend sans fin, comme un brouillard silencieux, dans les abysses du Dasein ? »19 Et l’ennui « tue »20, note Heidegger. C’est pourtant dans cette mort à soi que le temps naît : « l’élément qui envoûte n’est rien d’autre que l’horizon du temps »21.
Mais là où le réalisateur quitte le « chemin »22 du philosophe qu’il n’a d’ailleurs qu’à peine commencé à emprunter, c’est lorsqu’il ne déduit pas comme le fait Heidegger que « c’est là seulement où il y a le péril de l’épouvante qu’il y a la béatitude de l’étonnement – ce vif ravissement qui est le souffle de tout philosopher »23. Ni le cheval, ni le cocher et sa fille, ni le spectateur ne vivent d’autre péril que celui consistant à vivre. La Benommenheit n’est pas pour Béla Tarr un accaparement ni même une hébétude : c’est l’acuité d’une présence au monde, et, contrairement à ce qu’écrit Heidegger, l’animal a de cela la plus vive conscience. Le péril n’est pas dans cette sorte d’envoûtement animal, mais bien dans le monde lui-même. Et s’il existe un autre péril, c’est cette volonté acharnée d’évacuer le péril de vivre dans un au-delà, un horizon d’apocalypse surjouée.
Apocalypse, fin du monde, fin de l’Apocalypse ?
Dans cette représentation d’une fin du monde, que reste-t-il de l’apocalyptique chrétienne ou judaïque ? Un caractère prémonitoire peut certes se lire à travers divers signes ou symboles, le mutisme du cheval, mais aussi la lumière qui refuse de s’allumer, l’eau tarie, voire le cortège festif de ces gitans qui s’enfuit24… Mais où est passé le décor ? Que reste-t-il des révélations faites à Saint Jean l’Évangéliste dans le dernier livre du Nouveau Testament ? Pas un chevalier en vue, tout juste un cheval, bête de somme dont la charge n’est même plus supportable, et sur lequel seul le temps pèse, tragiquement25.
Dans une interview avec Lídia Mello, le réalisateur hongrois, interrogé sur la relation entre différence et répétition dans ses films, précise d’abord qu’il n’existe aucune répétition pure et simple, que chaque jour est vécu différemment26. Son cinéma semble chercher obstinément la synthèse existentielle d’un rapport au temps27. Cela se vérifie au quotidien dans Le Cheval de Turin, dans lequel chaque retour du jour ou de la nuit s’accompagne des mêmes tâches à accomplir, telles une ritournelle, où pourtant viennent s’adjoindre des éléments incongrus – des signes nouveaux qui, à l’instar d’un détail inattendu de telle peinture du Quattrocento28, se révèlent être l’un des éléments d’une vision « rapprochée », plus encore que d’un message, et qui semble complètement échapper aux protagonistes tout en annonçant leur véritable destin.
Béla Tarr poursuit son propos en rappelant que nous créons chaque jour des formes différentes qui nous rendent de plus en plus faibles. À la fin, annonce-t-il, nous n’aurons fait que disparaître. Pour lui, il ne s’agit pas d’une apocalypse, ni même d’une heure sublime qui rendrait au moins belle la fin. C’est simplement la mort : « ce film traite de l’inéluctabilité de la mort »29. Nous sommes là en présence d’une extinction, et celle de la lumière – première chose créée par Dieu – en est le signe. La lumière refuse à présent de s’allumer, nous sommes donc de retour à l’origine, le cycle est fini, nous sommes redevenus cette poussière qui, avec le brouillard, nimbe le film, lui donnant ce grain, celui des particules dont nous sommes faits et qui se défont à présent. C’est le dernier film du réalisateur, en forme de testament ; il éteint la lumière qui fait son art. Le réalisateur garde la mémoire, voire poursuit l’héritage des peintres qui, tout donnant à voir une scène convenue, biblique ou profane, voire quotidienne, expriment l’incommensurable et pensent ainsi leur art et leur époque dans un seul et même mouvement. Béla Tarr, de film en film, répète des plans, comme l’ouvrier qu’il a été plus jeune a reproduit constamment les mêmes tâches, mais dans cet ouvrage obstiné les différences viennent nourrir un autre projet, celui de rendre compte de la condition d’homme, cette re-création contribuant à la réalisation d’une seule œuvre.
Mais l’ensemble de l’œuvre délivre-t-il véritablement un message politique ? Rien n’est moins sûr. Ou plutôt, c’est de moins en moins le cas. En effet, ce cinéaste qui a toujours voulu montrer la douleur d’être homme, a commencé par filmer « les gens »30 au plus près. De gauche, mais contre le régime socialiste hongrois qui va le censurer, il est peu à peu devenu humaniste. Il ne faut pas entendre ce terme comme celui qui voit dans l’homme la mesure de toute chose, et qui « cherche à l’épanouir en prônant le développement des facultés proprement humaines »31 – même s’il avoue avoir, d’après ces valeurs, voulu sauver ce monde. Béla Tarr veut seulement prendre souci de l’homme, montrer sa dignité malgré son extrême fragilité. Selon ses propres termes, il s’est aperçu, en quelques décennies de carrière qui virent un autre effondrement, celui de « l’Est », qu’il était impossible de sauver l’homme, car son « mal » n’est pas social mais ontologique32. L’empathie, pour l’homme, mais d’abord – et la fin du texte initial et l’ordre d’apparition des personnages vont dans ce sens – pour l’animal, devient le véritable programme politique. Pas cette pitié, laissée à Turin, qui conduit à l’effondrement, au ravage de la compassion, mais, au contraire, la possibilité de s’y soustraire, un temps …
On peut se demander alors si, dans ce « film biblique sans Dieu »33, la catastrophe qui semble se profiler n’est pas déjà là, s’il ne s’agit pas de cette condition que les hommes et les bêtes vivent et que Nietzsche s’est épuisé à dénoncer, et si la vision n’est pas celle d’un autre temps, d’une autre temporalité. D’après Jacques Rancière, Béla Tarr rompt avec toute vision téléologique ou eschatologique du temps34. Il a vécu l’ère soviétique, la spectacularisation de l’histoire, le matérialisme historique réduit à un prêche déterministe, pas tout à fait étranger à celui des religions. Et si le mythe industriel, que le socialisme tout autant que le capitalisme a tenté de s’approprier, représentait la véritable apocalypse contre laquelle le vivant a déjà perdu ? Et si à l’inverse du progrès, ou en même temps que la dynamique qu’il impose, se jouait une régression qui nous ferait revenir du cosmos au chaos, ou à ce « chaosmos » annoncé par James Joyce ? Le retour chez soi, n’est-il pas l’immuable – plus encore que l’éternel – retour à la matérialité, à l’inorganique, à la terre et à la Terre ?
Le mythe même semble épuisé à force d’être vécu. Pourtant « la fin du monde dans Le Cheval de Turin se déroule mythiquement et narrativement », comme l’écrit Alberto Filipe Araújo35. Mais ne se déroule-t-elle pas ailleurs ? En douce, pourrait-on dire. Gilbert Durand relève que « le mythe, lorsqu’on essaie de le fixer, c’est un peu comme en physique quantique quand on essaie de fixer la particule microphysique, on perd son contenu dynamique. »36 On est en droit de se demander, immergé dans le monde du film, si Béla Tarr ne cherche pas à éviter l’aporie, tout simplement en ne s’engageant pas dans cette voie. Cette ambiance et ces êtres sont démystifiés, au sens propre d’abord : ils sont exclus du mythe. Le temps du mythe a été épuisé par celui de l’homme qui l’a bâti.
Est-ce là l’annonce de la fin de l’œuvre humaine ? L’homme est de la nature (il y est, il en est et en est fait), en créant il se crée, puis, se créant autre, de plus en plus obstinément, efficacement, industriellement, tel un « surmâle »37, il s’épuise dans cette course en avant, cette aliénation. Pour Karl Marx, les instruments de production de cette société ne peuvent représenter « un moyen d’épanouissement plus intense du processus de la vie pour la société des producteurs, mais un moyen d’exploitation, d’appauvrissement »38. Le philosophe qui tombe devant le cheval est d’abord épuisé par l’homme, par l’histoire humaine. Est-ce là l’expression d’un autre mythe, celui de la fin de l’Histoire et des grands récits ? Ou est-ce la fin d’une histoire ? Tout comme Nietzsche n’est pas mort à Turin, le film ne veut pas conclure.
Le XXe et le XXIe siècles apporteront d’autres formes d’effacement de l’homme, plus redoutablement efficientes encore. « La fin du monde », formule grandiloquente, anthropocentrique, est couramment employée aujourd’hui dans le style tragique et creux pour dénoncer une apocalypse écologique. Or, si un autre temps est attendu – et ce film consiste presque uniquement en une attente – il semble de plus en plus appartenir à l’animal. Le cheval, qui a su fuir Turin, ville fleuron d’une nouvelle Italie, industrielle, vient décentrer le regard, le « désanthropocentrer ». Dans cet épuisement généralisé, celui d’une culture, d’une civilisation, voire d’une espèce, l’homme semble œuvrer à son effacement. Mais s’il emporte avec lui une part du vivant, il n’a pas fait disparaître la vie, et l’animal toujours existe.
L’animal ne survit pas, il vit ailleurs, autrement. Le sens humain est dissout mais le sens animal perdure. C’est même lui qui, de manière prophétique, annonce la fin de l’homme. Il montre d’autres logiques, dévoile une autre temporalité, de laquelle l’homme (s’)est exclu. L’animal n’a pas la temporalité de l’homme. Il n’a pas la même mémoire39. L’animal se souvient, mais il se souvient d’autre chose. Grâce à sa présence, à sa façon d’être acteur, le temps n’est pas promis à une forme d’anéantissement ou de dissolution : il est réévalué. Le film ne fait pas le pari d’un devenir-animal, mais celui d’un avenir animal, qui sonne comme un retour au monde. Et si, dans cette apocalypse finissante, l’animal devenait l’avenir de l’homme ? « Deviens ce que tu es », écrit Nietzsche.
Fin du monde ? Non. Fin d’un monde, d’une « mondanité humaine ». Par-delà bien et mal est la conscience animale. Ce cheval n’est pas celui de l’apocalypse qui emporte le chevalier (trop humain) des ténèbres, mais celui du post-humain, voire du post-humanisme. Nietzsche s’effondre devant le cheval ; la pitié en est, dit-on, la raison. Le spectateur continue l’œuvre ultime du philosophe ; il éprouve de l’empathie pour le cheval du film. Et ce sentiment devient viral, en se venant à se porter, de proche en proche, sur les figures du vieil homme et de sa fille. Ce sentiment général, unique, « océanique »40, ouvre sur une réflexion plus large, sur le caractère pitoyable de la vie. L’homme est une bête de somme qui, paradoxalement, s’inflige un fardeau suffisamment lourd pour pouvoir l’oublier. Celui qui en prend conscience est anéanti : il peut, à force de lucidité, en devenir fou, clairvoyance qui fut sans doute fatale à Nietzsche. La véritable folie n’est pas d’être déraisonnable, mais de s’apercevoir que la raison ne saurait réussir à s’opposer à l’absurdité de la vie.
« De l’inconvénient d’être né » ne cesse de déplorer Emil Cioran – le voisin roumain – , de l’inconvénient d’être vivant, d’être bête. Seulement voilà, cet apitoiement, cette folie vertigineuse qui dissout le sens dans l’existence, qui voit l’absurdité des vies d’hommes agités, désireux autant de savoir que d’oublier, de donner sens autant que de se soustraire à la nécessité d’en trouver – à tout cela l’animal est étranger. Mais cette étrangeté représente-t-elle une échappée salutaire ? Ou n’est-elle qu’une confirmation supplémentaire, ultime, de la fatalité humaine ? Béla Tarr, exposant homme et bête à tous les temps et tous les âges, ne choisit pas, il revient au pays – c’est-à-dire au milieu – pour y attendre la seule fin qui absorbe, et donc réconcilie, tous les temps.
Par tous les temps
Le film propose une immersion dans ce que Jacques Rancière nomme « le temps des événements matériels purs »41, c’est-à-dire
le temps de la pure circulation des affects, temps sans horizon rédempteur, […] un continuum sensoriel qui enrobe, imprègne et détermine les êtres. Les plans-séquence, les lents mouvements de caméra, la partition expressionniste de l’espace, le laconisme des personnages et la léthargie de leurs mouvements n’ont d’autres fonctions que de faire sentir les infimes variations travaillant le monde sensible. Que le visible produise son propre effet au lieu d’être aliéné dans la logique des actions.42
Il est tentant alors de voir en Béla Tarr le cinéaste ultime de « l’image-temps »43. Mais si, chez Deleuze, le cinéma peut être envisagé comme l’œuvre du temps, celui d’une inéluctable quotidienneté, il est question d’un saisissement d’un temps « général » à même l’image. Dans Le Cheval de Turin, comme dans d’autres films du cinéaste hongrois, les temps se « chevauchent » : il y a celui de la répétition, celui du changement, et celui du déclin, qui semble tout emporter, mais aucun des trois, qui appartiennent au même monde, n’évolue de la même façon. Assiste-t-on à la réconciliation, ou tout simplement à la prise en compte de temporalités longtemps distinguées, voire opposées ? On songera ici au temps cyclique, asiatique par exemple, en contraste avec le temps linéaire, plus occidental. Mais aucun de ces temps n’est véritablement tout à fait saisissable. Leur passage ne cesse d’échapper aux acteurs comme aux spectateurs, comme les courants d’air qui parcourent le film. C’est une des raisons qui contribue à donner la sensation que ce film, dans lequel acteurs et spectateurs naviguent d’un moment au suivant, fait « apparaître hors de propos les règles habituelles et la logique du récit cinématographique »44.
Dans Le Cheval de Turin croît un sentiment étrange de confusion temporelle : nous savons qu’un passé récent, exceptionnel, qui s’annonce mythique, a eu lieu – l’introduction en a fait le récit essentiel – pourtant rien ne semble persister de l’événement. Le passé le plus proche, l’épisode de Turin (qui restera assurément dans la mémoire des exégètes de tout poil – mais ailleurs, dans un autre temps), est ici dilué dans un présent qui dure, ou plutôt un espace-temps complexe qui se présente longuement, indéfiniment : longueur des plans, quotidienneté, répétitions… Dans les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Gilbert Durand évoque un « futur présentifié, dominé par l’imagination »45, d’un style « révolutionnaire qui met fin idéalement à l’histoire »46. Plus encore, c’est à la vision d’un passé présentifié que nous convie le réalisateur. Le temps dure jusqu’à l’épuisement, comme si l’effondrement ne cessait d’avoir encore lieu. Et cette sensation de chute lente et permanente autorise l’épanchement d’un avenir imparable, sensible, et pourtant inimaginable, comme l’est la mort. Est-ce là la temporalité animale (et donc la conscience animale) qui est adoptée ? La prescience d’un péril imminent dont tant d’animaux sont, bien plus que l’homme, doués ?
Cependant cette temporalité est-elle totalement étrangère à l’homme ? L’homme ne l’aurait-il pas niée, fuie, puis oubliée comme l’animalité qui lui est pourtant consubstantielle ? « Nous ne sommes devant aucun cheval », nous pénétrons l’œil de la bête. « La fille rentre le cheval dans l’écurie, referme la porte en nous laissant à l’intérieur. Pénombre, silence, on entend le souffle du cheval. On est avec lui. Mieux encore : on est le cheval. »47 Et l’on ressent alors ce qui aurait pu sembler impossible, ce qui aurait pu ne même pas sembler, pas l’existence, pas l’étant, mais l’être là. Ce monde, ce pays – plus qu’un paysage –, qui de l’aveu du réalisateur est le personnage central, presque le sujet, c’est le milieu : celui qui, régi par ces multiples temporalités reste immuable même lorsque le vent cesse, celui qui fait et défait l’être – cheval, homme, femme …
Par-delà début et fin
Chez Béla Tar, ni au-delà, ni fin, de l’« après » peut-être, mais comme sentiment, pas de véritable retour mais des enchaînement de répétitions et de différences, de l’éternité, peut-être, mais qu’il est en ce cas question de retrouver, dans l’œil, puis l’être du cheval. L’éternité n’est pas alors ce qui n’a pas de fin, mais « ce qui n’a ni commencement ni fin » ; pour Béla Tarr c’est ce qui est.
Le réalisateur hongrois répète que son obsession, lorsqu’il filme, est avant tout celle de ne pas mentir. La parole de Nietzsche, et surtout son expérience, qui le mènera jusqu’à ce cheval à Turin, est toute entière contenue dans l’affirmation selon laquelle ne pas mentir ce n’est pas dire la vérité, mais s’en émanciper, pour retrouver le monde, pour redevenir, comme l’animal, le monde.
Le cheval de Béla Tarr fait penser à ce chat qui, regardant Derrida nu au sortir de la douche, inspire à ce dernier l’une de ses plus belles réflexions48. La manifestation animale est déjà l’expression d’une conscience logique du monde dont l’homme s’est peu à peu dépossédé. De manière similaire encore, Françoise Dastur rapporte une scène qu’elle a vécue en 1986 alors qu’elle assistait à une leçon de Jacques Derrida sur l’approche de l’animal par Martin Heidegger.
Au moment même où Derrida commençait à évoquer la question de l’animal et la manière peu satisfaisante, selon lui, dont Heidegger en parle dans son cours de 1929-1930, un lapin de garenne s’est approché de la fenêtre et demeurait immobile, proche de la vitre à la toucher, pendant de longues secondes, avec cet air profondément méditatif qu’ont les animaux au repos. Venait-il à notre insu illustrer à point nommé le propos derridien et même l’appuyer, puisque Derrida parlait alors en son nom de l’incapacité congénitale du discours philosophique à le penser ? Ou était-il venu poser pour nous dans son dos comme pour dire ironiquement : « Me voici, moi-même, toujours autre, insaisissable, imperméable à tous les discours, même et surtout à ceux qui s’adressent à moi et prétendent parler en mon nom, tout proche et pourtant démesurément loin, sur une autre scène où ce qui arrive ne se donne jamais à voir, où tout échappe toujours … ».49
Le lapin devient soudain l’expression corporelle de l’insaisissable animal. Il se révèle aussi, pour Dastur, l’invité inattendu, l’acteur inespéré de cette entreprise de déconstruction de l’approche heideggérienne de l’animal. Béla Tarr, s’inquiétant du sort du cheval de Turin, « donne corps » à l’animal (comme l’on dirait « donner la parole », voire « donner raison »). Il revient à ce moment multiple, impossible mais certes non pas impensable (c’est là toute l’œuvre de la fiction), où, à la fois, rien n’est encore dit – Derrida face au chat – et où plus rien n’est à dire – Nietzsche face au cheval.