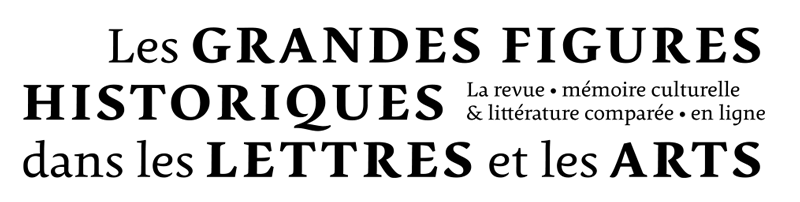Je regretterai toujours Tedmor et Saïde.1
Lamartine en Orient ? Il n’est donc pas resté à pleurer au bord du lac ? Les mille pages d’un périple à Malte, Beyrouth, Jérusalem, Damas et Constantinople nous prouvent le contraire.
Le poète quitte Mâcon le 14 juin 1832 avec sa femme et sa fille, pérégrine pendant plus d’une année au Proche-Orient et retrouve son château le 18 octobre 1833 avec Mme de Lamartine, mais sans Julia, morte de phtisie à Beyrouth le 7 décembre. C’est pour le couple une douleur telle que le récit insère, à la date fatale, deux lignes de points2. En amont et en aval de cette tragédie familiale, le texte est dense, éloquent, multicolore, nourri d’histoires et de sensations, traversé d’hommes, de chameaux, et surtout de chevaux.
Lamartine, propriétaire terrien, est quasiment né en selle, et, s’il est un écrivain qui connaît le cheval, c’est lui : il sait l’observer, le mener et, en bon paysan bourguignon, discuter pour l’acheter. Il maîtrise les rituels qui scandent l’équitation, tous les soins que l’on prodigue à l’animal pour qu’au petit matin il vous emporte dans le désert ou sur les sentiers de la montagne3. Le Voyage en Orient peut se lire comme une histoire d’amour entre un cavalier et ses montures, mais aussi, les rênes à la main, comme une histoire d’admiration entre un Français et l’Orient, ses villes, ses paysages, ses atmosphères. Plus encore, le cheval est pour Lamartine un moyen d’entrer dans la culture arabe, de la comprendre du dedans et non en observateur détaché, ou en touriste4. Enfin, le bédouin de Mâcon noue avec sa monture un lien vital, essentiel : il fait corps avec elle, et il sait la pleurer ; son récit est un tombeau, un chant funèbre pour quelques bêtes admirables.
Lamartine voyage entouré de toute une escorte. Le 8 octobre 1832, « à trois heures après-midi », il note : « Monté à cheval avec dix-huit chevaux de suite ou de bagages formant la caravane. »5 Il la détaille à la date du 29 octobre 1832, lors de son expédition à Jérusalem : « Parti à cinq heures du matin du désert de Saint-Jean, avec tous nos chevaux, escortes, Arabes d’Abougosh et quatre cavaliers envoyés par le gouverneur de Jérusalem. »6 Quand il part de Beyrouth (qu’il écrit Bayruth), il précise que « la caravane se compose de vingt-six chevaux, et huit ou dix Arabes à pied pour domestiques et escorte. »7 Dans la poussière, les cris, les hennissements, le choc des sabots sur la terre durcie, l’auteur des Méditations passe en grand seigneur.
La tradition veut qu’il se soit ruiné, mais outre que la dépense est aristocratique, elle était nécessaire pour traverser des régions peu sûres, entrer en contact avec les tribus locales et gagner « le respect et le prestige d’obéissance » des Arabes, qu’il explique ainsi :
Je ne doute pas que nous n’ayons dû une grande part de la déférence et de la crainte dont nous fûmes environnés, à la beauté des douze ou quinze chevaux arabes8 que nous montions ou qui nous suivaient. Un cheval en Arabie, c’est la fortune d’un homme : cela suppose tout, cela tient lieu de tout : ils prenaient une haute idée d’un Franc qui possédait tant de chevaux, aussi beaux que ceux de leur scheik et que les chevaux du pacha.9
C’est donc tout naturellement que le futur candidat à l’élection présidentielle de 1848, où il récoltera 0,45 % des suffrages, raconte qu’un cavalier arabe « saute à bas de son cheval et veut [lui] baiser la main »10, usage qui n’est pas du Mâconnais, ni de Bergues, où il est élu député au printemps de 1833, pendant un périple oriental qui ne manque pas de panache. Un laissez-passer d’Ibrahim-Pacha, maître de la Syrie, lui ouvre toutes les portes, et, même si l’on tient compte dans sa formulation d’une certaine emphase diplomatique11, fait de lui le protégé, l’« ami » des plus hautes autorités. Le résultat ne s’en fait pas attendre : « Le gouverneur porta cette lettre à son front après l’avoir lue et me la remit. »12 Il entre ici un mélange de narcissisme, de tradition et d’objectivité flatteuse qui se manifeste en filigrane de tout le récit. Chateaubriand voyageait en plus modeste équipage. Nerval habitera Le Caire en simple particulier. Flaubert et Du Camp barouderont en compères. Certes, la caravane est fort dispendieuse, mais quelle importance ? Dans une « Note post-scriptum » de 1849, l’écrivain réussira même à démontrer que son expédition « ne lui a rien coûté »13. Économiser, thésauriser, calculer sont des verbes bourgeois : Lamartine flambe et flamboie, et savoure sa splendeur. À peine arrivé à Beyrouth, il achète « six chevaux arabes de seconde race »14 pour les bagages, dont toute une bibliothèque15. L’animal, dans tout le Voyage, est une des figures du somptuaire : un luxe indispensable, métonymie du maître et métaphore de sa qualité.
L’hippophilie de Lamartine n’est donc pas seulement un trait de caractère que sa naissance ou son biotope rural auraient souligné, mais le signe en filigrane d’un portrait de l’artiste en cheval. Les courses et cavalcades à travers déserts et montagnes, l’empathie quasi amoureuse pour quelques montures d’élection, la sociologie équestre des peuples d’Orient qui se dessine au fil des épisodes : tout contribue à faire du Voyage en Orient une confession les rênes à la main, comme si le cheval qui emmène le poète à Jérusalem ou aux ruines de Balbek, l’emmenait en réalité vers lui-même, vers son Orient, tout un monde intérieur dont ni la vie littéraire, à Paris, ni les semailles et les moissons, dans ses terres, ni le combat politique, en France, n’avaient pu ouvrir les portes : « Le philosophe, l’homme politique, le poète doivent avoir beaucoup voyagé, écrit-il. Changer d’horizon moral, c’est changer de pensée. »16
L’homme qui se sent « inutile à [son] pays »17, après une carrière diplomatique de second couteau, a besoin de l’Orient pour faire sa mue. À l’âge de l’ambition, des salons et des ministères, il lui faut de grands espaces ; il devient le « voyageur en marche sans s’arrêter »18, avide de rencontres et de sensations neuves. En même temps, il parade : il a la prestance, la fierté du cavalier que tout une iconographie, de la peinture de bataille aux chevaux hyperboliques de Géricault, sans parler de la statuaire, a illustrée depuis plusieurs siècles. Ce Moi dressé sur ses étriers pour l’admiration des Bédouins ne l’empêche pas d’écrire qu’il « rêvait […] un voyage en Orient comme un grand acte de [sa] vie intérieure »19. La quête de Dieu et les applaudissements des hommes ne sont pas, pour Lamartine, incompatibles.
Le voyage est une aventure où l’homme fait l’apprentissage de sa grandeur, et rien n’exprime mieux celle-ci qu’un beau cheval. L’auteur des Méditations se fait donc à plusieurs reprises maquignon. À peine arrivé à Beyrouth, il achète, on l’a vu, « six chevaux arabes de seconde race » pour sa suite : « en deux jours, ils nous connaissent et nous flairent comme des chiens »20, ajoute-t-il. Avec Mme de Lamartine, ils font le tour de la ville :
[…] superbe cheval arabe de Madame Jorelle21 ; harnais de velours bleu plaqué d’argent ; poitrail de bosses du même métal sculpté, qui flottent en guirlandes et résonnent sur le poitrail de ce bel animal. M. Jorelle me vend un de ses chevaux pour ma femme ; je fais faire des selles et des brides arabes pour quatorze chevaux.22
Il a l’œil, il a l’argent, et il s’amuse plus qu’à Paris : « Nous marchions gaiement, essayant de temps en temps » la vitesse de nos chevaux contre celle des « chevaux arabes que montaient MM. Damiani23 et les fils du vice-consul de Sardaigne »24. En descendant, en pleine nuit, par un sentier difficile vers la plaine de Jéricho, il pratique une équitation qui tient de la haute voltige25 : l’aristocrate ne connaît pas la peur. Peu après – car c’est un roman d’aventures que ce Voyage – il voit surgir « une trentaine de cavaliers bédouins, montés sur des chevaux superbes »26. « Domptés par la terreur du nom d’Ibrahim », ceux-ci se montrent on ne peut plus hospitaliers, et la rencontre se clôt par un achat :
Je remarquai là un cheval admirable de forme et de vitesse, monté par le frère du scheik, et je chargeai mon drogman de me l’acheter à tout prix. Mais comme de pareilles offres ne peuvent se faire directement sans une espèce d’outrage à la délicatesse du propriétaire du cheval, il fallut plusieurs jours de négociations pour me rendre possesseur de ce bel animal, que je destinais à ma fille et que je lui donnai en effet.27
L’anecdote est emblématique de son voyage, car acheter un cheval, c’est entrer, en terre lointaine, dans un rituel de paroles, de gestes et d’attitudes qui rapproche deux étrangers. L’animal est le dénominateur commun entre deux cultures, et l’acheteur comme le vendeur reconnaissent en l’autre un connaisseur, un amateur, un amoureux des belles bêtes. La violence s’abolit, la « férocité et le brigandage »28 des Arabes sont remplacés par le dialogue et le commerce. Les « négociations » sont civilisatrices : elles obligent, de part et d’autre, à jouer le jeu de l’autre, à s’adapter à sa vision du monde. Discuter un prix, en pays arabe, est une forme de politesse : il y faut les formes, une mise en scène et en mots de « plusieurs jours » par traducteur interposé pour qu’enfin le désir de l’un coïncide avec l’intérêt de l’autre. Certes, les dés sont un peu pipés, car Lamartine jouit des plus hautes protections, et consentir à la vente peut passer pour un acte de flatterie ou d’obéissance vis-à-vis d’Ibrahim-Pacha. Les enjeux sont donc complexes, qui mêlent amour-propre et finances, diplomatie et esthétique (le cheval est « admirable de forme » : une œuvre d’art sur pattes). On ajoutera que le téléphone arabe fonctionne très bien dans le désert : les paroles de l’échange vont se démultiplier, et Lamartine n’hésitera pas à entreprendre d’autres « négociations » – un mot de paix, de connivence et de bonne intelligence.
Lors d’une mémorable visite à l’émir Beschir, prince des Druzes, le voyageur visite les écuries du palais. Il est à nouveau ébloui par le « cheval arabe », « superbe et gracieux animal »29 à qui il consacre une période de plus d’une page30 au terme de laquelle les mots lui manquent :
C’est une chose incroyable que la mobilité et la transparence de la physionomie de ces chevaux, quand on n’en a pas été témoin. Toutes leurs pensées se peignent dans leurs yeux et dans le mouvement convulsif de leurs joues, de leurs lèvres, de leurs naseaux, avec autant d’évidence, avec autant de caractère et de mobilité que les impressions de l’âme sur le visage d’un enfant.31
Il y a là ce que l’on pourrait appeler un déplacement de rhétorique : c’est pour l’animal que le poète des Méditations et des Harmonies déploie son éloquence avec une conviction aussi spectaculaire que communicative. Lamartine n’écrit pas le cheval arabe, il le chante. Il est pour lui un perpétuel objet de désir, une tentation, une folie ; dès qu’il l’a vu, il veut l’acheter, le posséder, le monter : « j’admirais surtout plusieurs juments sans prix, réservées pour l’émir lui-même. Je fis proposer par mon drogman, à l’écuyer, jusqu’à dix mille piastres d’une des plus jolies ; mais à aucun prix on ne décide un Arabe à se défaire d’une jument de premier sang, et je ne pus rien acheter cette fois. »32 Acheter des chevaux qu’il lui faudra ensuite faire venir en France du Levant par voie terrestre, l’entreprise est peu rationnelle, mais le poète-cavalier, ou le cavalier-poète, vit dans l’instant, dans l’état de grâce d’un dialogue avec la bête : « Notre langue surtout, écrit-il, les frappait et les étonnait vivement ; et le mouvement de leurs oreilles dressées et renversées en arrière, ou tendues en avant, témoignait de leur surprise et de leur inquiétude. »33 Il leur parle. Ils se comprennent. Le cheval arabe n’a pas besoin d’un drogman pour communiquer avec l’étranger, et réciproquement. La barrière de la langue disparaît, car l’animal « semble prendre intérêt à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit autour de lui ; sa physionomie s’anime comme celle d’un visage humain : quand l’étranger paraît et lui parle, il dresse ses oreilles, il relève ses lèvres, ride ses naseaux, tend sa tête au vent, et flaire l’inconnu qui le flatte. »34 Cette relation exclusive est l’un des thèmes récurrents du Voyage : nul besoin de discours ou de prosodie, la présence seule suffit à ébaucher une communication infra-verbale, immédiate et régénérante. S’il faut, pour entrer en contact avec les peuples du désert, respecter formes et traditions, le contact avec leurs chevaux fait l’économie de tout rituel. Lamartine entre dans l’âme de l’Orient par l’oreille de ses chevaux.
Certains de ceux-ci ont des noms. Nommer un animal, par essence anonyme, c’est partager avec lui un peu de notre humanité (la lui imposer ?). Par le nom nous le possédons, nous le faisons entrer dans la vie domestique. Le cheval, pour le voyageur, n’est plus une créature utile, que l’on remplace le cas échéant : il passe du statut d’objet – d’objet vivant – à celui de sujet. Dans le Voyage en Orient, Lamartine mentionne cinq chevaux d’exception : Liban, El Kantara, Scham, Tedmor et Saïde. Chacun a son histoire, son caractère, sa singularité.
Quel nom donner à un animal ? Entre l’hypocorisme par réduplication, l’emprunt culturel ou historique, la topique onomastique, le snobisme exotique, la tradition et l’invention, sans oublier les hasards nécessaires de la nomination, le champ phonique est vaste. Le nom, marque de l’humain, est la première étape du dressage. Il reconnaît, désigne, isole l’animal parmi ses congénères ; il lui donne un statut d’élection ; il reflète le maître sur la robe de l’équidé. Dans le Voyage en Orient, chaque cheval favori porte le nom d’un lieu : Liban, écrit Lamartine, « parce que je l’avais acheté dans ces montagnes », au nord de la Mer Morte ; El Kantara, « en mémoire du lieu et de la fontaine où je l’avais acheté »35 ; Tedmor « est le nom arabe de Palmyre » ; Scham « est le nom arabe de Damas » ; enfin Saïde est homonyme de Saïde, « l’antique Sidon », port au sud de Beyrouth36.
Chaque cheval est un lieu, comme si le toponyme était le point de départ de sa course ou sa destination. Chaque cheval est aussi le souvenir d’un lieu, la trace phonique d’une atmosphère, d’un événement, d’un personnage. Le nom invite donc à l’association d’idées, il réunit des épisodes du voyage, il marque une étape dans un itinéraire. L’écurie de Lamartine raconte ses expéditions37, mais aussi sa rêverie sur les villes et les paysages. Noms de pays : les chevaux, dirait-on pour parodier Proust. Il fait le projet fou de « ramener en Europe »38 Tedmor, Scham et Saïde, comme le promeneur ramène de la plage un coquillage. Il ne voit pas que le cheval appartient de tout son être sonore à un lieu, et qu’on ne ramène pas un pays dans ses bagages. Il en fera l’amère expérience. Dans une page datée de Constantinople, juillet 1833, il raconte la fin de son histoire d’amour avec ses pur-sang :
Mes chevaux arabes arrivent par l’Asie Mineure. Tedmor, le plus beau et le plus animé de tous, a péri à Magnésie, presque au terme de la route. Les saïs39 l’ont pleuré, et pleurent encore en me racontant sa fin. Il avait fait l’admiration de toutes les villes de la Caramanie où il avait passé. Les autres sont si maigres et si fatigués qu’il leur faudrait un mois de repos pour être en état de faire le voyage de la Turquie d’Europe et de l’Allemagne. Je vends les deux plus beaux à M. de Boutenief pour les haras de l’empereur de Russie, et les trois autres à différentes personnes de Constantinople. Je regretterai toujours Tedmor et Saïde.40
Il loue ensuite « cinq arabas41, attelés chacun de quatre chevaux, pour conduire, en vingt-cinq jours de marche, à Belgrade, ma femme et moi, M. de Capmas42, mes domestiques et nos bagages », ainsi que « six chevaux de selle pour nous, si les chemins ne permettent pas de se servir des arabas »43. Total : vingt-six chevaux, qui n’ont pas de nom. L’animal rentre dans l’anonymat du pragmatisme.
Mais le Voyage en Orient est aussi un tombeau : comme on place sur une tombe un buste du défunt, Lamartine compose pour ses chevaux préférés une description commémorative. Liban « était un jeune et superbe étalon, grand, fort, courageux, infatigable et sage, et à qui je n’ai jamais reconnu l’ombre d’un vice pendant quinze mois que je l’ai monté »44. Pour El Kantara, c’est un cavalier accompli qui parle :
Je le montai à l’instant même pour achever la journée : je n’ai jamais monté un animal aussi léger. On ne sentait ni le mouvement élastique de ses épaules, ni la réaction de son sabot sur le rocher, ni le plus léger poids de sa tête sur le mors. L’encolure courte et élancée, relevant ses pieds comme une gazelle, on croyait monter un oiseau dont les ailes auraient soutenu la marche insensible. Il courait aussi mieux qu’aucun cheval arabe avec qui je l’ai essayé. Son poil était gris perlé.45
Scham est d’un poil « fleur de pêcher. Il est d’une race dont le nom signifie roi du jarret. On me le cède pour quatre mille piastres. Je le monte pour l’essayer. Il est moins doux que les autres chevaux arabes. Il a un caractère sauvage et indompté, mais paraît infatigable. »46 Quant à Tedmor, le préféré des préféré, « ce magnifique animal vole comme une gazelle sur le terrain rocailleux du désert ; en un instant il a devancé les meilleurs coureurs de la caravane ; il est doux et intelligent comme le cygne, dont il a la blancheur et l’encolure. »47 Enfin, dans une lettre à sa cousine Alphonsine de Cessiat du 8 novembre 1832, Julia de Lamartine écrit : « Une petite jument bay que je monte s’appelle Sayide » (sic)48. On comprend que l’auteur du « Poète mourant »49, où « le cygne voit le ciel à son heure dernière », père de la petite fille qui mourra le 7 décembre, un mois après avoir évoqué sa jument, regrettera toujours Tedmor et Saïde, les chevaux du souvenir.
Le cheval est psychopompe, et c’est dans cette perspective qu’il faut lire le récit de la promenade que le poète fit avec sa fille, deux semaines avant sa mort, dans les montagnes du Liban : « Cette promenade est la dernière que je fis avec Julia. Elle montait pour la première fois un cheval du désert que je lui avais ramené de la mer Morte, et dont un domestique arabe tenait la bride. »50 La promenade est une longue ascension, dans un décor de collines, puis de montagnes. La description cultive une verticalité symbolique qui, à chaque pas, accroît, l’« ivresse » de la petite fille : « N’est-ce pas, me dit-elle, que c’est la plus longue, la plus belle et la plus délicieuse promenade que j’aie encore faite de ma vie ? – Hélas oui ! Et c’était la dernière ! »51 Cette « promenade » dont on ne revient pas est conçue comme une anabase, avec une exaltation apologétique qui rappelle le Génie du christianisme. Lamartine ne donne pas de nom au « cheval du désert », car ce serait le rattacher au monde humain : il a l’anonymat, non point des bêtes, mais des archétypes.
On le voit, dans le Voyage en Orient, le cheval est bien plus qu’une monture. Intercesseur entre l’Orient et l’Occident, intermédiaire entre la vie et la mort, il est aussi, avec Liban, intersigne :
[…] il avait sur le poitrail, dans la disposition accidentelle de son beau poil gris cendré, un de ces épis que les Arabes ont mis au nombre des signes funestes. J’en avais été prévenu en l’achetant, mais je l’avais acquis par ce raisonnement bien simple et à leur portée, qu’un signe funeste pour un mahométan était un signe favorable pour un chrétien. Ils n’avaient trouvé rien à répondre, et je montais Liban toutes les fois que j’avais à faire des journées de route plus longues ou plus mauvaises que les autres. Lorsque nous approchions d’une ville ou d’une tribu, et que l’on venait au-devant de la caravane, les Arabes ou les Turcs, frappés de la beauté et de la vigueur de Liban, commençaient par me faire compliment et par l’admirer avec l’œil de l’envie ; mais, après quelques moments d’admiration, le signe fatal, qui était cependant un peu couvert par le collier de soie et l’amulette suspendus au cou, que tout cheval porte toujours, venait à se découvrir ; et les Arabes, s’approchant de moi, changeaient de figure, prenaient l’air grave et affligé, et me faisaient signe de ne plus monter ce cheval.52
Le maquignon est aussi sophiste, et l’expérience lui donne raison : le « signe fatal » s’inverse en « signe favorable », le second tout aussi irrationnel que le premier. Le cheval est un champ de forces : celle de l’« amulette », celle du « signe », mais aussi celle des prédictions, car « par suite des innombrables superstitions arabes, il y a soixante et dix signes bons ou mauvais pour l’horoscope d’un cheval, et c’est une science que possèdent presque tous les hommes du désert »53. Avec Liban, nous entrons dans un mystère qui nous rappelle que l’animal a une vie parallèle, dans le folklore, dans les songes et dans les mythes. Le cheval, comme bien d’autres bêtes, vit au bord de l’imaginaire.
En témoigne la « visite à Lady Esther Stanhope », nièce de William Pitt, qui, après avoir séjourné « à Jérusalem, à Damas, à Alep, à Koms, à Balbek et à Palmyre »54, s’était fixé en pays druze, « dans une solitude presque inaccessible »55. Richissime et excentrique pour les uns, prophétesse pour les autres, lady Esther se distingue par « des idées religieuses exaltées, où l’illuminisme d’Europe se trouve confondu avec quelques croyances orientales et surtout avec les merveilles de l’astrologie »56. Lamartine réussit à lui rendre visite, et le Voyage en Orient rend compte de ces heures étranges où la dame, habillée à l’orientale, devise avec le poète : sept pages d’une conversation philosophico-métaphysique57 dans les arcanes de laquelle on n’entrera pas ici. Outre qu’elle fait des prédictions au voyageur en regardant la forme de son pied, elle lui montre une « jument baie » promise à un grand avenir :
Voyez si la nature n’a pas accompli en elle tout ce qui est écrit sur la jument qui doit porter le messie : – elle naîtra toute sellée. – Je vis en effet sur ce bel animal un jeu de la nature assez rare pour servir l’illusion d’une crédulité vulgaire chez des peuples à demi barbares ; – la jument avait au défaut des épaules une cavité si large et si profonde, et imitant si bien la forme d’une selle turque, qu’on pouvait dire avec vérité qu’elle était née toute sellée, et, aux étriers près, on pouvait en effet la monter sans éprouver le besoin d’une selle artificielle ; – cette jument, magnifique du reste, semblait accoutumée à l’admiration et au respect que lady Stanhope et ses esclaves lui témoignent, et pressentir la dignité de sa future mission ; jamais personne ne l’a montée, et deux palefreniers arabes la soignent et la surveillent constamment sans la perdre un seul instant de vue. Une autre jument blanche, et à mon avis infiniment plus belle, partage, avec la jument du messie, le respect et les soins de lady Stanhope : nul ne l’a montée non plus. Lady Esther ne me dit pas, mais me laissa entendre que, quoique la destinée de la jument blanche fût moins sainte, elle en avait une cependant mystérieuse et importante aussi ; et je crus comprendre que lady Stanhope la réservait pour la monter elle-même, le jour où elle ferait son entrée, à côté du messie, dans la Jérusalem reconquise.58
Lady Stanhope, qui pratique la « divination »59, donne ainsi au cheval un rôle dans un scénario surnaturel que Lamartine, qui fait preuve dans son récit d’un christianisme syncrétique et inspiré, rapporte sans ironie. Le Christ étant l’« homme des hommes »60, la jument serait donc le cheval des chevaux, créature terrestre et céleste appelée à jouer un rôle dans une deuxième Incarnation. C’est pour marcher sur les traces du Christ que Lamartine décide de courir le monde, « le livre des livres »61 ; c’est pour retrouver ces traces qu’il entreprend son voyage, vers « les rivages mêmes où [le Christ] en imprima le plus, sur les flots mêmes qui le portèrent, sur les collines où il s’asseyait, sur les pierres où il reposait son front »62. Lady Stanhope va plus loin dans la quête : à l’anamnèse commémorative du poète, elle répond par la prophétie d’une nouvelle Révélation. Un nouveau Nouveau Testament contera-t-il un jour le Verbe fait Chair dupliqué ? Lady Esther y prend sa place, à la droite du nouveau Sauveur.
Avec Liban, El Kantara, Scham, Tedmor et Saïde, avec la jument des juments que montera un jour le messie, nous sommes en présence de chevaux exceptionnels. Leur nombre est infime au regard de tous les équidés que croise Lamartine en Orient. Combien de bêtes ne sont qu’une fonction, juste une présence, à peine un élément du décor ? L’Orient se prête à merveille au pittoresque : scènes ou tableaux donnent à la narration son exotisme, sa couleur locale. Le spectacle le plus typique que puissent donner des chevaux, c’est le djerid, comme à l’arrivée de la caravane lamartinienne à Jaffa :
Après deux heures de marche, nous vîmes, de l’autre côté d’un fleuve qui nous restait à franchir, une trentaine de cavaliers revêtus des plus riches costumes et d’armes étincelantes, et montés sur des chevaux arabes de toute beauté, qui caracolaient sur la plage du fleuve. Ils lancèrent leurs chevaux jusque dans l’eau, en poussant des cris et en tirant des coups de pistolet pour nous saluer […] Ils se rangèrent autour de nous, et, courant çà et là sur le sable, ils nous donnèrent le spectacle de ces courses de djerid, où les cavaliers arabes déploient toute la vigueur de leurs chevaux et toute l’adresse de leurs bras.63
À la différence de la fantasia, si bien peinte par Delacroix à la même époque, qui, dans son exubérance, garde certaines règles, le djerid est informel : il permet à chaque cavalier de faire preuve de dextérité tout en faisant admirer son cheval. L’individu s’y singularise tout en jouant le jeu du groupe : le djerid est un beau désordre. « Courir le djerid » est un rite collectif, mais aussi une marque de bienvenue. Lamartine évoque à plusieurs reprises cette « espèce de tournoi »64 auquel il a assisté et failli participer. Il évoque par exemple, aux portes de Beyrouth, ses galops « sur les sables déserts qui dominent l’horizon bleu et immense de la mer syrienne »65, là où Arabes et Européens improvisent des djerid que l’on n’ose qualifier de fraternels, mais qui sont la preuve, comme le marchandage, d’un rapprochement entre les cultures : l’équitation est un langage universel, et deux hommes de chevaux, quelle que soit leur langue ou leur religion, se reconnaîtront toujours.
Ut pictura poesis : Fromentin, dans ses récits d’expéditions au Sahel66, décrira les oasis qu’il aura auparavant peintes sur les lieux mêmes. Il mettra la lumière en mots. Lamartine, lui, ébauche des gravures virtuelles. Voici, en pleine désolation, « un énorme figuier-sycomore » :
son tronc a quelquefois jusqu’à trente ou quarante pieds de tour, souvent beaucoup plus ; ses rameaux, qui commencent à s’ouvrir à quinze ou vingt pieds de terre, s’étendent horizontalement d’abord à une immense portée, puis les rameaux supérieurs se groupent en cônes moins élargis, et présentent de loin la forme de nos hêtres. L’ombre de ces arbres, que la Providence semble avoir jetés çà et là sur le sol brûlant du désert, s’étend à une grande distance du tronc, et il n’est pas rare de voir une soixantaine de chameaux, de chevaux et autant d’Arabes campés pendant la chaleur du jour sous l’abri d’un seul de ces arbres.67
La scène est statique, intemporelle. Elle contraste avec le mouvement perpétuel du cavalier, avec la fuite inexorable des jours dans le journal. Datée, pour la fixer dans la mémoire, du 5 octobre 1832, elle semble quelque vignette de la même essence ekphrastique que les panoramas, villages dans la montagne, scènes typiques et autres couchers de soleil qui font du Voyage en Orient un grand livre d’images à destination du public occidental, comme le fut l’Itinéraire de Chateaubriand. Le 20 octobre de la même année, après avoir décrit une jeune fille donc la vénusté flatte l’œil du séducteur, Lamartine écrit :
Je la grave dans mon souvenir pour la peindre plus tard, comme le type de la beauté et de l’amour purs, dans le poème où je veux consacrer mes impressions. Ce devait être un beau tableau à faire pour un peintre, s’il y en eût eu un parmi nous, que cette scène de voyage […].68
Le topos pictural circule ainsi dans tout le texte, et le cheval tient une place importante dans la galerie de tableaux à faire confiés à l’imagination du lecteur. À côté de l’évocation flamboyante de ses pur-sang, Lamartine n’oublie pas les humbles équidés du quotidien, « nos chevaux »69, dit-il, à distinguer des « mes chevaux »70, ceux que monte le maître. « Nos chevaux », ce sont les porteurs de tentes, de provisions et de bagages : le déterminant possessif traduit une différence dans le regard et dans l’affect. Le poète place ainsi, en arrière-plan de Tedmor et autres étalons, toute une écurie besogneuse qu’il faut nourrir, abreuver et laisser se reposer. Nous sommes encore au siècle du crottin, à une époque traversée, en Europe, de carrioles, de fiacres, de carrosses et autres voitures, et, en Orient, de caravanes. De l’animal utile à l’animal unique, le Voyage en Orient respecte la hiérarchie équine et, ce qui ne laisse pas de surprendre, accorde beaucoup moins d’importance au chameau.
Le court « Avertissement » qui ouvre le volume était pourtant prometteur. Lamartine y pratique l’excusatio traditionnelle de l’orateur en affirmant que « ces notes sont presque exclusivement pittoresques ; c’est le regard écrit, c’est le coup d’œil d’un passager assis sur son chameau ou sur le pont de son navire, qui voit fuir des paysages devant lui, et qui, pour s’en souvenir le lendemain, jette quelques coups de crayon sans couleur sur les pages de son journal. »71 Cette vision surplombante de l’Orient n’est qu’une fausse promesse, car c’est de l’échine des plus beaux étalons que le poète observera les déserts et les hommes. Le chameau, dans le Voyage, est pluriel, sans signes de distinction, sans nom ; il est l’un des multiples acteurs des caravanes. Lamartine, cependant, l’a observé, et c’est par petites touches qu’il compose son portrait. D’abord sensible aux « âpres et lugubres gémissements des chameaux, qui poussent des cris de douleur quand on leur fait plier les genoux pour recevoir leurs charges », il les montre ensuite, à Balbek, « dressant leur tête pensive et calme au-dessus des tronçons de colonnes et de chapiteaux éboulés » ou s’avançant « avec l’ondoiement d’une vague », avant de distinguer, parmi les milliers de camélidés qu’il croise, un « chameau couché, ruminant avec sa haute tête intelligente, dressée et tendue vers la porte de la tente »72. Ces fragments de portrait, en près de mille pages de texte, ne sont qu’une esquisse. À la différence de Loti ou de Lawrence d’Arabie, que le roulis du vaisseau du désert n’empêchera pas d’écrire des chefs-d’œuvre73, Lamartine compose le sien en selle, et l’on peut, en vérité, affirmer que l’auteur de Jocelyn et de Graziella n’avait pas d’affinités avec le porteur à deux bosses des mille mystères de l’Orient.
Le Voyage en Orient est un texte complet : journal de bord, peinture de mœurs, galerie de personnages, atlas du Levant et livre d’histoire, méditation et poème. Son titre complet est une incitation au dépaysement : « Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou Notes d’un voyageur ». On remplacerait volontiers le dernier mot par « cavalier ». À la différence des autres pièces qui, aux échecs, progressent par colonnes ou en diagonale, le cavalier avance par décalage ; de même, dans ce long récit, le voyageur dévie de son itinéraire narratif pour s’engager dans d’éloquentes considérations historiques, esthétiques ou métaphysiques. L’Orient de Lamartine est fait de dérives : anecdotes et ferveur religieuse, descriptions et considérations géopolitiques se succèdent, s’associent, fusionnent. Le cavalier, du haut de sa monture, est libre : libre de s’égarer pour mieux se retrouver, libre de lâcher la bride à son imagination, ou, au contraire, de tenir d’une main ferme les rênes de la rationalité. L’équitation est affaire de domination de soi, comme l’écriture. Le Voyage en Orient est un chant d’amour aux pays lointains, un hymne du deuil et de l’émerveillement. À six reprises, la prose y devient poésie, et l’ample paragraphe se transforme en strophe. Le cheval y est encore : « Adieu, mes beaux coursiers oisifs dans mes prairies »74, s’exclame Lamartine dans son « adieu à Marseille » du 28 mai 1832. Il en chevauchera d’autres, qui ne verront jamais « ses » prairies. Le Voyage a été écrit, dit-il, « au milieu des cris des matelots, des hennissements des chevaux »75. Prêtons l’oreille : nous les entendons encore.