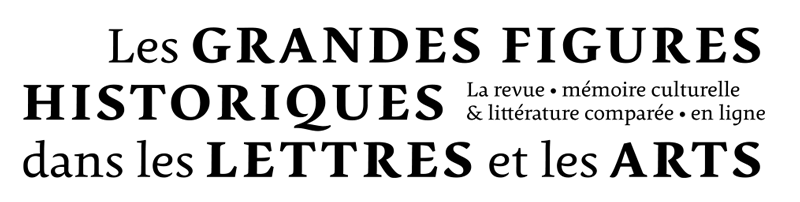Hans Henny Jahnn, auteur peu connu en France, a fait quelque bruit dans l’effervescence créatrice qui caractérise la littérature de langue allemande de l’entre-deux-guerres. Ses pièces de théâtre provocatrices ont fait l’objet de recensions élogieuses ou indignées ; il a composé des nouvelles, de longs romans d’une forme complexe et des pièces pour orgue, restauré d’anciens instruments et publié des partitions anciennes ; enfin, il a réalisé d’ambitieux dessins architecturaux, restés à l’état de projet faute de moyens financiers. Notre propos ne cherchera pas à rendre compte de l’ensemble de cette œuvre, ce qui serait proprement irréalisable, mais de rappeler que Jahnn, comme d’autres auteurs de la période, se caractérise par ce que Michel Espagne a appelé « la tentation de la totalité »1. Cela explique sans doute la place centrale qu’il accorde à l’animal : penser l’homme implique de penser d’autres espèces.
L’animal tient une place centrale dans l’œuvre jahnnienne, particulièrement dans Perrudja, son premier long roman, datant de 1929. On constatera à la lecture de cette œuvre que la plénitude de l’animal découle avant tout du fait qu’il vive dans l’instant, au contraire de l’homme qui se caractérise par une dimension historique désastreuse. Parmi les animaux, le cheval opère la jonction, ou plutôt orchestre la confrontation, entre ces deux rapports au temps. C’est pourquoi on s’intéressera plus particulièrement aux figures de chevaux célèbres auxquels cette œuvre voue un intérêt marqué.
L’animal comme contrepoids aux prétentions (sur)humaines
Pour commencer par un exemple particulièrement emblématique, la pièce Médée de Jahnn s’ouvre sur l’éloge lyrique d’une jeune jument, prononcé par les deux fils de Médée et Jason. Le spectateur perçoit rapidement que cet animal cristallise toutes les tensions : amour et rivalité entre les frères, rapports au père, trouble de la sexualité naissante – voilà l’écheveau d’émotions que suscite la jument. Comme si la charge symbolique n’était pas assez appuyée, l’animal, alors qu’il porte sur son dos le fils aîné, attire un étalon qui entreprend de le monter. Cet événement étant difficile à mettre en scène, Jahnn choisit de le relayer par un récit. C’est le cavalier de la jument qui le relate, de manière ambiguë :
Soudain
mes cuisses éprouvent une douleur sauvage, mon dos
se brisa violemment vers l’avant
et au-dessus de moi l’ombre d’une
tête de cheval convulsée, pleine d’écume.
Devine toi-même ce qui m’est arrivé,
moi-même je ne l’ai appris qu’en le devinant.
Entravé, ou plutôt étranglé, ma vie menacée,
je dus endurer le corps de cheval en émoi
jusqu’à ce qu’il ait accompli l’injonction de son sang.
Libéré, je me fis l’effet d’être détruit ; écrasé
jusqu’à en éclater, en une douleur muette,
je ressentais mes entrailles. Abasourdi
du cheval je me laissai sombrer.2
Ces propos ne permettent pas de dire si le locuteur a réellement été violé par l’étalon ou si c’est une impression née de la violence traumatisante de ce coït. Le texte suggère plutôt la première interprétation : alors que la jument est initialement la « cible » de l’étalon3, elle est pour finir « comptée pour rien, comme un âne au bord de la route »4. C’est le cavalier qui, apparemment, subit l’assaut – en tout cas c’est lui qui en souffre. Il se produit là une sorte de transfert, qui en entraîne d’ailleurs un autre, symétrique, puisque ce cavalier (aîné de Jason et Médée) éprouve désormais un désir obsessionnel, non pour l’étalon, mais pour celle qui le monte (la fille préférée de Créon).
De toute évidence, l’écriture de cette scène n’est pas motivée par le souci de respecter les sources. Elle est, au contraire, profondément caractéristique de Jahnn, qui associe l’animal à un discours sur la sexualité en tant qu’elle déborde toutes les limites que l’on tente de lui imposer. La tragédie Médée, comme l’ensemble des œuvres de cet auteur, s’attache à enfreindre avec méthode tous les tabous en la matière, représentant des rapports de désir entre individus de même sexe, de même famille ou d’espèces différentes. Régulièrement, Jahnn use de figures animales pour subvertir toute conception normative de la sexualité ; ainsi, dans le roman Perrudja, un bref passage évoque le tsar russe Pierre le Grand, dont Jahnn ne retient pas les prouesses militaires ou politiques mais deux caractéristiques passablement iconoclastes, sa virtuosité en matière de pets et la variété de ses partenaires sexuels :
[…] le tsar Pierre le Grand qui maîtrisait à volonté tous les degrés de l’éructation avec son gosier et son rectum. Qui indiquait par des gloussements et des coups de trompette si un repas était à son goût. Et qui par ce chant répugnant donnait en même temps le signal : Au lit ! Au lit ! Et qui, puant de la sorte, demandait : Qui va écarter ses jambes pour moi ? Une femme ? Un joli garçon ? Ou ma douce chienne chérie Finette ?5
Jahnn ne précisant jamais ses sources, on ignore laquelle a pu lui inspirer la chienne Finette. Toujours est-il qu’elle permet d’enrôler Pierre le Grand, en principe incarnation triomphante du pouvoir absolu, sous la bannière des fonctions corporelles sans entrave. On peut, bien sûr, faire une lecture moins positive de l’épisode, et conclure que le tsar, en donnant libre cours à tous ses désirs, donne la mesure de son despotisme. La même ambiguïté caractérise un autre passage, où Jahnn évoque une armée conquérante et destructive dont les soldats « chantaient les femmes », « chantaient les gitons », « chantaient la vulve de leurs juments »6 : faut-il louer leur ouverture d’esprit ou déplorer le nombre et la variété de leurs victimes ? Le style oraculaire cultivé par Jahnn ne permet pas de savoir s’il faut voir en ces soldats, comme en Pierre le Grand, des militants de la libération sexuelle ou d’indignes violeurs que même les animaux doivent redouter. Soulignons pour l’instant que, quelle que soit l’interprétation retenue, une lumière inédite est jetée sur ces conquérants.
Voici donc un célèbre roi déboulonné par son animal, ou plus exactement la réputation de ce roi est radicalement infléchie par le recours à une figure mineure, sa chienne. C’est aussi le sort d’Alexandre dans ce même roman Perrudja :
Bucéphale, l’étalon d’Alexandre. Cette longue chevauchée : Tyr, Arbela, Babylone, Suse, Persépolis, Ecbatane, Herat, Kaboul, Samarcande, vallée de l’Hindus. N’était-ce pas le cheval qui était le héros ? Pas le cavalier macédonien. Fallait-il encore une preuve ? … Pour que l’homme ne devînt pas orgueilleux, les dieux ont donné un signe. Tandis qu’Alexandre essayait impatiemment de le talonner, le cheval grattait avec ses sabots dans le sable du désert indien et extrayait trois pierres précieuses blanches, aussi grandes que des œufs d’autruche.7
Dans le récit héroïque que recompose Jahnn, le cheval n’est pas le prolongement corporel de la vertu conquérante mais celui qui remet le conquérant (et plus généralement l’homme) à sa place, « pour que l’homme ne devînt pas orgueilleux ». Peu après avoir exalté Bucéphale, Jahnn conclut son chapitre par une phrase énigmatique affirmant en majuscules qu’un autre roi d’Orient doit son pouvoir à sa monture :
DAREIOS, FILS D’HYSTASPE, A ACQUIS LE ROYAUME DES PERSES GRÂCE À LA VERTU DE SON ÉTALON ET GRÂCE AU MÉRITE DE SON PALEFRENIER OEBARE.8
Nous reviendrons sur ces phrases en forme d’amorce, que Jahnn développe au chapitre suivant de son roman ; il suffit pour l’instant de relever cette constante dans l’œuvre de Jahnn qui consiste à remettre l’animal au centre du discours. Il paraît donc logique que Perrudja, le personnage éponyme, soit relégué au second plan par son propre cheval. Celui-ci fait l’objet d’un véritable roman familial (contrairement au protagoniste dont l’origine reste mystérieuse) : l’œuvre relate en détail par quel enchaînement de péripéties un étalon remarquable, puis une jument non moins remarquable, arrivent dans les environs, puis comment leur union se réalise en dépit des obstacles. Il en résulte un poulain dont Perrudja devient propriétaire, et qui apparaît comme un protagoniste au sens plein. Son histoire éclipse celle de Perrudja durant les dix premiers chapitres du roman.
À ces considérations quantitatives s’ajoute le caractère exceptionnel des parties consacrées au cheval : après sa naissance, la vie de Perrudja verse dans l’idylle, ce qui tranche avec un roman extrêmement sombre. Les soins attentifs dont Perrudja entoure d’abord la jument gravide, puis son poulain, font du jeune homme une figure de père et d’amant tout à la fois ; il couche sur le foin pour ne pas laisser l’animal seul et lui prodigue ses soins.
Des heures durant on étrillait, brossait, peignait, tapotait, lavait, huilait son pelage. Les petites rides de la peau aux parties molles étaient massées, tiraillées, lissées, repassées.9
Par contraste avec la violence du coït dans Médée, les attouchements de Perrudja et de son cheval sont d’une grande délicatesse :
Le cheval de presque deux ans courbait sa tête au-dessus de l’homme couché, lui soufflait au visage, touchait de ses naseaux la bouche, sortait sa propre langue, léchait doucement les joues et les yeux fermés, passait par-dessus le corps inerte, s’étendait non loin de lui également dans la paille, attendait. Perrudja se glissait près de lui, se jetait sur l’animal, mordait légèrement le pelage velouté, abritait sa tête entre les cuisses et rêvait […].10
Toutefois, malgré la forte sexualisation de ces gestes, Jahnn, décevant peut-être les attentes de son public, ne suggère, dans ce roman, rien de plus : Perrudja et son cheval restent « désunis par l’hostilité des espèces »11. Dans l’autre long roman de Jahnn, Les cahiers de Gustav Anias Horn, on trouve de même une relation intime entre le protagoniste éponyme et sa jument Ilok qui s’arrête au seuil de l’union sexuelle. Et ce, en dépit des sollicitations de la jument :
[…] elle a posé doucement sa tête sur mon épaule, elle a tordu son dos, comme pour m’enlacer. Elle voulait s’enrouler comme un chat, et seuls les jambes et les os solides l’en empêchaient. Je connaissais déjà ce geste et savais ce qu’il signifiait. Je soulevai sa queue et vis un peu de liquide blanchâtre couler.12
Plutôt que d’assouvir lui-même les désirs d’Ilok, Gustav lui procure un étalon. De même, dans Perrudja, si le protagoniste jouit de la beauté de son animal et lui prodigue des soins fort intimes, il ne lui vient apparemment pas à l’esprit d’en faire un partenaire sexuel. Il est assez paradoxal que Jahnn ait choisi d’enfreindre ce tabou par le medium du théâtre, et non au sein de ses romans – faut-il conclure à un certain assagissement ? En tout cas l’insistance avec laquelle Jahnn sexualise les chevaux et particulièrement les juments13, si elle prend des formes plus ou moins provocatrices selon la période ou le genre, ne faiblit pas. Autre constante, sa conception de la sexualité animale s’affranchit des impératifs de la reproduction, puisque les chevaux adressent leur désir à des partenaires impropres à cette fonction (dans Perrudja, il est aussi question de la passion, plutôt malheureuse à vrai dire, qu’éprouve une femelle d’élan pour un taureau). En sens inverse, si les deux protagonistes (Perrudja et Gustav Anias Horn) ne répondent pas pleinement à ce désir, leur relation au cheval est fusionnelle, dépassant en intimité et en intensité toutes les relations qu’ils nouent avec des êtres humains, à une exception près. En ce qui concerne Perrudja, seul Hein, le frère de son éphémère épouse Signe, égale ou dépasse l’animal en tant que partenaire privilégié. Signe elle-même est loin d’entretenir un lien aussi étroit à Perrudja, sauf dans une série de nuits où tour à tour, l’un des trois personnages (Perrudja, Signe et Hein) est rejoint par les deux autres qui ont pris, symptomatiquement, une forme animale. Le doute plane sur ces passages apparemment oniriques – mais le rêve est commun aux trois personnages, et c’est l’un des passages où le roman verse dans le surnaturel. C’est le seul moment, en tout cas, où Perrudja consomme physiquement sa relation à Signe et Hein, comme si seule la forme animale permettait un plein épanouissement sexuel et une intimité profonde (du reste, le désir de Perrudja pour Signe naît, dans l’adolescence, d’une rencontre au cours de laquelle Signe monte brièvement le cheval du jeune garçon).
De fait, Jahnn affirme à plusieurs reprises qu’au contraire de l’animal, l’homme a le malheur d’être scindé par la fatale distinction entre corps et âme introduite par le monothéisme, ce qui interdit toute plénitude, tout bonheur véritable. Au contraire, l’animal vit dans une pleine coïncidence entre sa conscience et son corps, ce qui implique aussi qu’il vive dans l’instant. C’est ce que souligne un passage où Perrudja, au début du roman, jouit du spectacle d’animaux dépensant sans compter leur force14, puis est bouleversé par la vision d’un jeune taureau :
Un peu éloigné du troupeau, dans un fourré, il y avait un taureau pensif de deux ans. Blanc et rouge. Perrudja […] s’aperçut que la couleur rouge était d’abord du sang, déjà foncée, éclaircie seulement par quelques poils couleur de cuivre, pour s’assombrir ensuite en un brun noirâtre.
[…]
Il saisit la peau de l’animal qui tendit vers lui sa tête avec ses cornes dures, lui lécha les habits en apportant humblement la force de son existence à l’autre.
Rien qu’un taureau, destiné à l’abattage, à la reproduction, au profit de l’homme. C’est lui qui détient la plénitude de la couleur, la plénitude de la force, la plénitude de l’inconscience.
L’homme poursuivit sa montée en titubant.15
La vitalité de l’animal est-elle suffisante pour libérer l’homme de sa conscience malheureuse ? Le passage ci-dessus laisse supposer que l’animal « apporte la force de son existence » à l’homme qui, à ce contact, renoue avec l’intensité de la sensation immédiate, « la plénitude de la couleur ». Mais l’homme paraît plutôt condamné à admirer cette plénitude dont sa conscience s’est irrémédiablement coupée. Le deuxième volume du roman étant resté à l’état de projet, il est hasardeux de spéculer sur son issue ; toutefois, le projet esquissé par Jahnn ne manque pas d’intérêt. Selon le témoignage de Carl Mumm, l’auteur lui avait expliqué qu’à la fin, le protagoniste devait renoncer définitivement à son statut d’homme, dégoûté par son espèce et par les destructions massives qui la caractérisent. Pour fuir l’humanité, Perrudja use d’un anneau magique (cadeau des trolls) et fait le vœu de devenir un cheval, afin de vivre désormais aux côtés du sien. Le vœu est exaucé, le personnage se métamorphose effectivement en cheval, mais l’anneau, lui, reste à sa taille initiale et comprime le paturon : Perrudja, fou de douleur, se jette dans une crevasse. La morale de l’histoire est, selon Jahnn cité par ce proche, que l’homme ne peut faire qu’un animal estropié16.
Chevaux héroïques, ignoble instrumentalisation
L’animalité représente donc un paradis définitivement perdu. Mais il fait néanmoins preuve chez Jahnn d’une résistance aux actions humaines destructrices, résistance qui s’exprime de façon particulièrement nette dans les figures animales proprement historiques. Celles-ci font leur apparition dans le roman à travers les lectures du protagoniste. En effet, Perrudja, parce qu’il cherche un prénom pour son poulain, cherche des récits contenant des chevaux illustres. L’histoire fait alors irruption au sein de la scène intime et rurale du roman, et il est notable que cette apparition d’une dimension historique aille de pair avec un changement dans la représentation du cheval, qui se voit doté d’un sexe biologique. En effet, il s’avère que le poulain, jusque-là désigné par des termes relevant du genre grammatical neutre (das Pferd, das Ross, das Füllen, un terme archaïque pour désigner un poulain, ou encore das Pferdekind, l’enfant cheval), est une pouliche, comme l’indique une phrase détournée : Perrudja, tenté de le nommer Bucéphale en hommage au « héros de ces routes aventureuses », en est « empêché par la différence de sexe »17. Le protagoniste, qui poursuit ses recherches, bute contre ce problème récurrent :
La seule petite objection qu’il avait à faire, c’était que l’Histoire avait transmis les noms de nombreux étalons nobles mais qu’elle n’avait jugé digne d’immortaliser le nom de presque aucune jument. Les empereurs, les rois, les ducs et les princes s’étaient toujours fait représenter montés sur des étalons. Les représentations de Colleoni et de Gattamelata, ces chefs de mercenaires : des étalons. Il pensait encore aux géants dompteurs de chevaux du Monte Cavallo. Des étalons. Ou encore. À des étalons grecs à l’encolure inclinée et aux naseaux incisifs. Aux chevaux de la dynastie Han.18
Perrudja a du mal à trouver un prénom féminin parce que les prénoms retenus par l’histoire (qu’ils désignent des humains ou des animaux) sont majoritairement masculins. Si l’étalon domine les récits conservés pour la postérité, c’est qu’il correspond aux exigences du récit historique. Bien qu’appartenant à l’animalité, il se prête à une métaphorisation de la masculinité triomphante et, par conséquent, peut être mis au service de l’exaltation d’un conquérant.
On peut penser qu’aux yeux de Jahnn, une telle représentation va directement à l’encontre de l’animalité, conçue comme une vie dans l’instant, une dépense sans calcul. Associer l’étalon à la conquête du pouvoir est dès lors un dévoiement scandaleux, qui atteint des sommets de duplicité dans un épisode relaté assez longuement, celui de la façon dont Dareios (Darius) conquiert le trône de Perse. Après avoir renversé un usurpateur, sept conjurés, qui souhaitent tous être roi, conviennent d’en laisser le choix au dieu Ahuramazda, qui parlera par la bouche de leurs montures : ils prévoient d’amener celles-ci au point du jour à un endroit découvert, et « Celui dont le cheval commencerait le premier à hennir face au soleil serait le roi élu. »19 L’un des conjurés, Dareios, se met alors à harceler son palefrenier, Oebare, pour que celui-ci trouve un expédient qui lui garantisse le trône ; le palefrenier rassure son maître sans préciser ce qu’il compte faire. Le matin venu,
Oebare conduisit le cheval de Dareios en le tenant par les rênes. Le palefrenier tenait une main dissimulée dans les plis de son pantalon. Lorsqu’il jugea le moment propice, il sortit sa main de son pantalon et en effleura les naseaux de l’étalon. Celui-ci aspira l’air plusieurs fois à grands coups, puis leva la tête, fit la moue et se mit à hennir de joie et de désir, face au soleil levant, comme on le crut. Ainsi fut-il décidé que c’était le fils d’Hystaspe qui serait roi.
Oebare avait pu provoquer le hennissement parce qu’il avait auparavant, lorsqu’il était dans l’écurie, introduit sa main dans la vulve de la jument et qu’il avait, lorsqu’il était sur le lieu du rassemblement, tendu ses doigts mouillés de mucosités au mâle qui, en reconnaissant infailliblement l’odeur suave, avait voulu saluer de sa voix la bien-aimée invisible.20
La sexualité animale garde, comme toujours chez Jahnn, sa plénitude harmonieuse : les sécrétions de la jument dégagent une « odeur suave », et l’étalon, qui aspire l’air avec avidité, « à grands coups », fait des mouvements de tête et donne de la voix, est l’expression même de la « joie » liée au « désir ». Mais cette sexualité se voit ici instrumentalisée et dévoyée par l’ambition de son cavalier.
Cette ambition est présentée sous le jour le plus défavorable qui soit. Tout le récit consacré à Dareios baigne dans la duplicité, en commençant par un tyran, Cambyse, qui fait secrètement assassiner un prétendant au trône ; l’identité de celui-ci est ensuite usurpée par un homme qui s’approprie non seulement le trône mais aussi les épouses de Cambyse ; l’usurpateur est lui-même trahi par l’une des épouses en question qui, « en tâtant avec ses tendres doigts »21, remarque une particularité physique qui expose la supercherie ; l’usurpateur est alors renversé par les conjurés, mais ceux-ci se laissent berner par une nouvelle ruse (celle que Dareios obtient de son palefrenier). Le récit va d’une trahison à l’autre, et même un geste « tendre » (celui de l’épouse) peut être le bras armé d’une conspiration. À l’issue de ce catalogue de fourberies, une citation dont Jahnn ne précise pas la source érige le cynisme en principe politique :
« Tu mentiras là où tu dois mentir. Tous les deux ont le même but en vue : celui qui ment et celui qui dit la vérité. Car l’un ment là où il veut faire croire quelque chose à travers sa fourberie pour en tirer avantage ; l’autre dit la vérité afin d’en tirer avantage à travers la vérité et de captiver par là même d’autant plus les autres. […] »22
Le couronnement de Dareios représente non l’avènement d’un élu désigné par la voix même de la vérité, mais le résultat d’innombrables machinations sordides. On voit à quel point Dareios, comme Alexandre, est foncièrement un usurpateur aux yeux de Jahnn ; chacun doit son pouvoir « À LA VERTU DE SON ÉTALON », comme l’affirme l’inscription que l’on a déjà citée23.
Cela explique sans doute que, malgré l’intérêt qu’éveillent en lui les figures de Dareios et de son étalon, Jahnn, après un développement assez long, préfère se tourner vers un autre souverain sassanide, Khosrô, et sa monture. Khosrô en effet s’enorgueillit de posséder, non un étalon, mais une jument remarquable, dont différents auteurs ont fait une description si élogieuse que Perrudja décide de donner son nom (Shabdez, « couleur de nuit ») à la sienne :
On avait figuré le coursier dans ce village parce qu’il était le plus pur et le plus grand de taille. Que sa nature était la plus manifeste. Et qu’il tenait le galop le plus longtemps. Le roi des Indiens l’avait offert au roi [Khosrô]. Il n’urinait pas et ne laissait tomber aucun crottin tant qu’il portait une selle et une bride. Il ne s’ébrouait pas et n’écumait pas. Le tour de son sabot mesurait six empans.24
On remarque que, régulièrement, Jahnn use de désignations neutres pour les deux Shabdez (celle, historique, du roi Khosrô, et celle du personnage fictif Perrudja) ; dans le passage ci-dessus, les traducteurs ont choisi le terme de « coursier » pour restituer les termes Ross (cheval) et Tier (animal), tous deux neutres. En dépit de ces désignations neutres, le genre biologique de ces deux juments importe sans doute autant que l’espèce à laquelle elles appartiennent : la conjugaison de l’animalité et du féminin va à l’encontre de l’exaltation de conquêtes que Jahnn juge essentiellement destructrices. Cela explique qu’il fasse de Shabdez une jument (là où certaines sources voient en ce cheval un étalon). La jument échappe à l’instrumentalisation historique que l’étalon permet. Aussi Perrudja, malgré son intérêt pour Bucéphale, ou pour Rakhsh, l’étalon décrit par le poète Firdosi25, se passionne bien davantage pour Shabdez.
En corollaire, Jahnn marque bien plus d’intérêt pour Khosrô que pour Dareios en dépit de, ou en raison de, l’échec de Khosrô en tant que monarque. Plus exactement, là où de nombreux historiens voient en Khosrô un grand conquérant, Jahnn s’écarte de ces représentations, voyant en Dareios le fondateur de la dynastie sassanide et en Khosrô son fossoyeur, dernier de sa lignée, un roi faible et (Jahnn le suggère) efféminé, le précurseur et le double de Perrudja lui-même. Les récits consacrés à ces rois orientaux, rassemblés sous le titre « Roi sassanide », forment un ensemble déroutant, apparemment dénué de rapports avec le récit principal, qu’ils interrompent sur un prétexte assez mince (trouver un prénom pour le poulain de Perrudja) et qu’ils éclipsent sur de longues pages. Pourtant, ils finissent par entrer en résonance avec celui-ci26.
Dans ce sous-ensemble, Shabdez joue un rôle de premier plan. Comme pour Alexandre ou Dareios, la monture prend le pas sur son cavalier27. Figure animale qui vient contrebalancer l’histoire héroïque, Shabdez rappelle au roi ses limites. C’est pourquoi Jahnn, dans son récit, donne une importance centrale à la mort de Shabdez, à l’occasion de laquelle Khosrô, qui craint la maladie et la mort et voudrait se croire éternel, est ramené à la réalité par le corps de sa jument : « Shabdez est morte. Elle a déféqué en mourant. »28 Devant le cadavre, le roi a la préfiguration de sa propre mort, idée renforcée par des parallèles textuels : de même que le corps de Shabdez se décompose en substances ignobles et malodorantes, de même, à la fin de sa carrière,
Il fut transpercé d’une lance quelques heures après que son fils préféré eut été abattu. Comme son père. Et il commença à se putréfier comme l’avaient fait son fils et Fahrad et Shabdez.29
« Roi sassanide » s’achève alors par une phrase énigmatique : « L’âme de l’homme possède la vie éternelle. L’âme de l’animal se putréfie comme le corps de l’animal. Et peut être mangée comme le corps de l’animal. »30 On pourrait comprendre que ces phrases assignent à l’homme une place supérieure dans la hiérarchie des êtres, puisque son âme « possède la vie éternelle » ; il paraît pourtant difficile de soutenir que Jahnn mette l’homme au-dessus de l’animal. Bien au contraire, sur le plan corporel, l’animal vient rappeler à l’homme sa nature périssable, mettant les espèces à égalité ; sur le plan spirituel, l’animal possède un avantage éclatant, celui d’une âme qui ne se dissocie en rien du corps (ce pourquoi elle disparaît avec lui).
L’œuvre plus tardive de Jahnn, Les cahiers de Gustav Anias Horn, martèle également cette idée. Son protagoniste, tout en affirmant qu’il ne peut s’unir charnellement à sa jument, espère s’unir à elle dans la décomposition de leurs corps :
« Nous devons aller vers l’étalon, Ilok », dis-je, « tu as ta vie, j’ai la mienne. Mais nous voulons mourir ensemble. Pourrir, cela nous le pouvons ensemble. »31
Triomphe de l’animalité
Les passages que l’on a relevés soulignent l’obsession de la mort et du pourrissement qui marque toutes les œuvres de Jahnn. Cela n’empêche pas l’animal d’y être associé avant tout à la vie. À ce titre, on examinera un autre point de la légende dorée de Shabdez (l’originale, monture de Khosrô), ses représentations : en effet, avant d’évoquer l’animal lui-même, Jahnn s’étend sur la statue en ronde-bosse qui se trouve à Taq e-Bostan, et sur les descriptions qui en sont faites.
Figure 1.
Statue de Khosrô II (dit Khosrô Parvez), Taq-e Bostan (Iran), IVe siècle
© source : Wikimedia Commons
On s’étonnera peut-être de voir Jahnn s’intéresser à ce monument : il s’agit d’une représentation du roi à cheval et en armes, célébration de la force conquérante que Jahnn ne cesse de dénoncer. De fait, l’auteur ne s’étend pas le moins du monde sur le cavalier ni sur son accoutrement guerrier. C’est la monture qui l’intéresse. Les différents commentateurs qu’il cite dans son roman semblent eux aussi avoir été frappés par le cheval plutôt que par le roi.
Non loin de la montagne Bistoun et de la ville de Sarpoul, près de la rivière Qarazou qu’avait déjà vue Tacite, il y a, taillé dans le roc, un monument que les Arabes comptent parmi les merveilles du monde ; c’est de lui que le poète Amrou ben Bahr al-Djahiz a dit dans son livre des contrées : « Là, se trouve le portrait d’un coursier, peut-être la plus belle des représentations existantes. »32
Mis’ar b. al-Muhalhil dit : la représentation de Shabdez se trouve à une parasange de la ville de Karmisin. […] Cette représentation est l’image de [Khosrô] sur son coursier Shabdez. Il n’y a au monde aucune image qui lui ressemble.33
Ahmad b. Muhammed al-Hamadhani dit : La représentation de Shabdez fait partie des merveilles de Karmisin, et c’est d’ailleurs une des merveilles du monde.34
Visiblement, aux yeux de Jahnn, c’est le mérite incomparable de Shabdez (et non la gloire de Khosrô) qui lui a valu cette immortalité dans la pierre. Il ne laisse d’ailleurs paraître aucun doute quant à l’identification du cheval et de son cavalier, alors que les historiens n’y voient pas unanimement une représentation équestre de Khosrô.
De ces différentes descriptions que Jahnn cite, on retiendra que la statue est admirée par nombre de commentateurs en dépit du fait que ceux-ci, musulmans, ne devraient pas en principe admettre la représentation figurale. L’un d’eux (Ahmad b. Muhammed al-Hamadhani) va jusqu’à suggérer qu’elle est l’œuvre d’Allah, seul capable d’insuffler une telle vie dans la pierre35. Cette sculpture animale met en difficulté la pensée monothéiste et la séparation radicale que celle-ci opère entre âme et matière, conscience et inconscience, séparation que Jahnn juge si désastreuse pour l’humanité. La statue de Shabdez témoigne d’un stade pré-monothéiste, et échappe à cette bipartition. Elle est d’ailleurs entourée par celles d’une déesse et d’un dieu perses ; le dieu, Ahuramazda, celui-là même qui a présidé à l’élection de Dareios, a une réputation de jouisseur et d’amateur de beaux chevaux. Rien d’étonnant, dès lors, si la sculpture accorde une place aussi centrale à l’animal ; celui-ci est associé à une vitalité inconsciente ou préconsciente que le monothéisme, selon Jahnn, a vainement tenté d’étouffer, et la fascination qu’exerce sa représentation témoigne de la persistance de cette impulsion.
À l’appui de cette idée, Jahnn met l’accent sur des commentaires exprimant l’admiration face à une statue étonnamment vivante :
Celui qui la voit croit sans aucun doute qu’elle bouge.36
Certes, la jument elle-même meurt – ce qui plonge Khosrô dans le désespoir et annonce la fin de son règne ; la mort n’épargne pas non plus le roi, ni le sculpteur (auquel Jahnn s’intéresse également). Mais la sculpture, elle, continue de vivre. Shabdez revit dans les représentations qui ont été faites d’elle, qu’il s’agisse de cette sculpture, des textes qui célèbrent la beauté de celle-ci, ou des textes qui célèbrent l’animal lui-même – dont le célèbre poème perse « Khosrô et Shirin », de Nizami, qui a pour particularité de se centrer non sur le versant militaire ou politique du règne de Khosrô mais sur ses plaisirs, amoureux et autres.
Figure 2.
Première rencontre entre Khosrô et Shirin dans Khosrô et Shirin du poète persan Nizami (XIIe siècle).
Au premier plan, Shabdez, qui joue un rôle dans ce récit.
Manuscrit du XVIe siècle
© source : Wikimedia Commons
La beauté de l’animal, bien qu’elle s’éteigne avec lui, est néanmoins d’une intensité telle qu’elle confère une vie propre à la sculpture qui la représente.
La description de la statue par diverses œuvres verbales constitue une ekphrasis, figure de style qui permet à de nombreux auteurs d’articuler leurs principes esthétiques. La lecture très particulière que Jahnn fait de la statue équestre de Taq-e Bostan, vivante représentation (selon lui) de la jument Shabdez, véhicule non seulement ses principes poétiques mais aussi ses conceptions en matière d’histoire. La figure de Shabdez permet de défendre une autre conception du temps, et de développer une représentation qui fasse pièce à celles des historiens, trop centrées sur les conquêtes et les destructions. Cela se confirme à la fin du premier volume du roman (le seul achevé, le second étant resté à l’état de projets et fragments). Jahnn choisit de le conclure par une longue méditation, émanant d’abord de Signe mais prenant rapidement un caractère impersonnel et universel, où l’on revient aux rois d’Orient déjà rencontrés, apostrophés et pris à parti. Alexandre, surtout, a droit à un long développement :
Alexandre s’était arraché de la petite Macédoine vers le vaste monde. Il partit, passa en revue ses armées, passa sur les rives de l’Asie. Près du Granique, il versa beaucoup de sang, perse, grec, macédonien. Ceux des hommes qui restèrent en vie avaient de la semence dans leurs reins et ensemencèrent les ventres des femmes épouvantées. […] Les hommes, je les tue – mes ennemis. Les femmes enfantent. Voilà comment se fait mon pays. […] Je faisais le destin. Je tue les hommes. Mes guerriers fécondent les femmes. Elles crient ? Elles enfantent ! Je suis le vainqueur.37
Au sein d’un récit à la troisième personne, Alexandre, prenant apparemment la parole, égrène la liste des villes conquises – Tyr, Gaza, Babylone, Ninive, Suse, Persépolis… – en vertu du même modus operandi consistant (selon Jahnn) à s’approprier, par l’entremise de ses soldats, les femmes des vaincus : « Fécondez pour moi », exhorte-t-il ses troupes, « C’est ainsi que se fait mon empire. »38 Il compte fermement que, dans « sa quarantième année, des centaines de milliers d’Alexandre pourront l’entourer »39. Mais cette assurance se transforme en doute : « Ai-je vaincu ? […] Est-ce que mon héritage croît ? Non, non, non, non. Les femmes ont enfanté leurs fils à elles, pas les miens. »40 La tentative de « transforme[r] le viol en union »41 n’y change rien.
Je meurs. Qu’est-il resté de toi, Alexandre ? Ton nom. […] En vain ton meurtre. Les faibles femmes ont enfanté leurs enfants. Elles ont maintenu le pays pour leur descendance. Comme l’avaient fait les femmes avant elles, comme le feront les femmes après elles. On a abattu trente fois les hommes de Mésopotamie ; violé les femmes. Et les violentées ont finalement vaincu.42
« En vain ton meurtre » (Vergebens dein Mord), selon la formule lapidaire de Jahnn : la conquête est requalifiée en sordide « meurtre », qui plus est « vain ». La violence, loin d’assurer l’éternité au conquérant, se retourne bien au contraire contre lui ; non seulement les enfants nés des viols n’étendent pas son empire mais ils le rendent nul et non avenu. En ce sens, la fin du volume fait directement écho à l’épisode « Roi sassanide », car les soldats de Khosrô aussi passent par ces deux étapes, l’avancée triomphale durant laquelle ils rendent enceintes toutes les femmes conquises43, suivie par son revers inévitable : « Les fils des soldats luttèrent, adultes, contre les soldats. N’étaient-ils pas les fils de leur mère. »44 Ces échos textuels et ces parallèles historiques signalent la conception cyclique de l’histoire revendiquée par Jahnn :
Les violentées ont vaincu lorsque les Huns ont submergé la Chine, ont enfanté le nouvel empire de la dynastie des Sui-T’ang. Les violentées ont vaincu lorsque les Arabes ont subjugué les pays méditerranéens. Elles ont vaincu, ces violentées, lorsque les Mongols ont conquis l’empire Chin sous Gengis Khan et Agdaï Khan, le Turkestan occidental, la Perse, l’Inde, Lahore, la Russie, la Pologne, la Hongrie. Elles ont vaincu contre la poudre à canon que les Mongols avaient apporté avec eux de la Chine ; contre le carnage auquel tous les hommes ont succombé. Elles ont vaincu par la chair impuissante de leur bassin. Ont enfanté leurs enfants ; les enfants de leur tribu ; qui ne savaient rien de la semence de leur père. Ainsi, le monde n’est pas toujours en ruines parce qu’il y a des êtres sans héroïsme. […] Teglath-Phalasar, ton nom seulement. Sardon, ton nom seulement. Assarhaddon, ton nom seulement. Psammétik, ton nom seulement. Nékao, ton nom seulement. Cyaxare, ton nom seulement. Nabuchodonosor, ton nom seulement. Cyrus, ton nom seulement. Dareios, ton nom seulement.45
Il s’agit de plusieurs conquérants, certains célèbres, et certains étroitement associés à leurs étalons ; le critique Joachim Wohlleben les qualifie de centaures46. Mais en dépit de la représentation triomphante que les historiens ont laissée d’eux, le roman de Jahnn affirme qu’il ne reste de leur gloire passée qu’un nom – on peut penser que l’auteur a volontairement accumulé des noms peu connus de ses lecteurs, relativisant ainsi la notoriété des trois derniers, Nabuchodonosor, Cyrus et Dareios. Celui-ci a d’ailleurs (comme Khosrô) la préfiguration de sa propre disparition, et fait graver dans la pierre une inscription à destination des générations futures, priées de conserver et non d’effacer sa mémoire ; la longue évocation des conquérants historiques s’achève sur cette vaine prière, suivie des mots « Là où il sera nécessaire de mentir, mens »47 déjà rencontrés dans le cadre de l’accession de Dareios au trône. En opposition à l’histoire des conquêtes humaines (ici essentiellement masculines et destructives, mensongères et vaines), le roman s’achève sur cet éloge de « la chair impuissante de leur bassin », une chair animale et féminine, passive et cyclique, qui garantit le triomphe de la vie.
On le voit, la vision que Jahnn a du temps est fondamentalement circulaire, qu’il s’agisse du temps naturel (marqué par la succession des saisons et des générations) ou du temps historique (l’auteur établissant des parallèles étroits entre diverses périodes et figures historiques). Toutefois une distinction fondamentale s’instaure entre ces deux régimes. La cyclicité de l’histoire humaine est celle de destructions aussi épouvantables que vaines, découlant du désir de soumettre la matière à un principe spirituel réputé supérieur. Cette décision désastreuse est fort heureusement contrebalancée et réparée par la cyclicité naturelle et charnelle, raison pour laquelle l’historien et l’artiste sont tous deux incités à prêter attention au triomphe de la vie, non aux victoires de tel ou tel chef militaire.
Or l’animal, dans sa corporéité, permet de contrer vigoureusement toute vision désincarnée de l’histoire : « Sans la chair vivante de l’individu, l’abstraction la plus hardie et la plus spirituelle est un squelette »48, écrit Jahnn au sein du passage où diverses descriptions de la statue sont citées. Il y a, si l’on comprend Jahnn, deux façons de faire l’histoire. La mauvaise est « déterminée d’après les mouvements extérieurs »49 et, dans ce cas, verra en Khosrô un adversaire malheureux des chrétiens menés par Héraclius, ou un ignorant resté sourd à l’islam naissant. Dans « Roi sassanide », Jahnn évoque les récits triomphaux des chrétiens comme les récits prophétiques des musulmans, mais pour s’en dissocier. Les deux religions ont propagé sur ce roi des légendes qui confortent leur vision téléologique, aboutissant à leur propre triomphe. Khosrô se trouve alors englouti dans une conception de l’histoire comme manifestation éclatante de l’esprit divin – une « abstraction des plus spirituelles » assimilable à un « squelette ». La bonne méthode, en revanche, construit l’histoire à partir de la « chair vivante », et heureusement, il s’est trouvé des historiens pour suivre ce parti pris.
En 1228, l’encyclopédiste Yakout de Hamah acheva sa grande nomenclature et commença sa souvenance sur le dernier roi sassanide puissant par le nom de la jument préférée de ce dernier. Il décrivit l’endroit où se trouvait le monument qui en était précisément le témoignage vivant (bien qu’en pierre), sans la présence duquel on ne connaîtrait l’histoire de cet homme […] qu’à travers un voile.50
L’intérêt de cet encyclopédiste pour la jument et pour sa statue le place, aux yeux de Jahnn, du côté du « témoignage vivant » (par opposition à l’esprit mortifère). En donnant une telle place au nom de Shabdez, Yakout de Hamah fait œuvre de vie, de même que le sculpteur dont l’œuvre est non moins vivante « bien qu’en pierre ». De toute évidence, c’est là l’ambition que Jahnn nourrit pour son propre roman, et la figure animale est au centre de cette revendication.