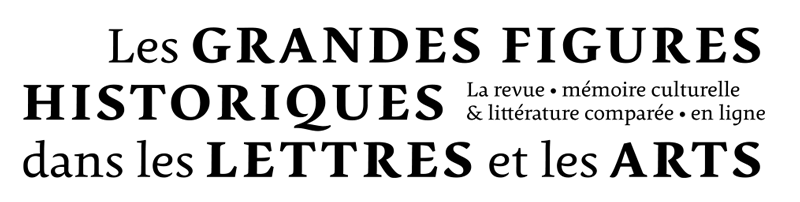Que le hasard joue un rôle moteur dans les œuvres traitant des grands conflits du XXe siècle n’a rien pour surprendre. Pour des individus dont la vie civile a été disloquée par les bombardements ou la déportation, l’existence ne semble pas régie par des chaînes causales mais par d’inconcevables ruptures, et la survie apparaît comme le fruit du pur hasard. Mais cette expérience peut suggérer une stratégie interprétative inverse : réfutant l’idée même de hasard, certains individus croient fermement que leur existence a été déterminée par une puissance supérieure. On s’intéressera à cette question à travers deux auteurs, Claude Simon et Hanna Krall, qui n’ont cessé de revenir à la période de la guerre. Le premier a vécu la Débâcle, un noyau autobiographique qui ensemence ses écrits ; la seconde, journaliste polonaise ayant survécu, enfant, au génocide juif, a créé ses œuvres à partir des témoignages d’autres rescapés. L’analyse portera sur deux romans, L’acacia de Claude Simon (1989) et Le roi de cœur de Hanna Krall (2006), où la certitude d’un destin à accomplir dirige les choix d’un personnage féminin, tandis que les bouleversements historiques s’expriment à travers une construction narrative discontinue. On se demandera dès lors si les œuvres s’associent aux conceptions du personnage ou s’en dissocient : structurées par un schéma téléologique apparent, mais désarticulées par le montage, elles paraissent écartelées entre prédestination et arbitraire.
Les chapitres impairs de L’acacia et le modèle formel de la tragédie
Au premier chapitre du roman L’acacia de Claude Simon, le lecteur suit un personnage féminin qui cherche son chemin dans les routes défoncées et le paysage en ruine produits par la Grande Guerre, traînant à sa suite deux autres femmes et un garçon. Les marques d’imprécision abondent, notamment l’indéfini « quelque »1 ainsi que le suffixe « -âtre » cher à Simon2. Tout indique le caractère arbitraire de leur cheminement. Or Simon le désigne par un oxymore, « implacable errance » (A, I.14), qui exprime la tension entre l’indétermination du parcours spatial et l’« inflexible détermination » (A, I.12 ; A, I.24) qui meut la protagoniste. Celle-ci inscrit ostensiblement son cheminement dans un registre qui apparaît comme la négation de l’arbitraire, celui de la tragédie : « Elle ne se plaignait pas, ne récriminait pas. On aurait dit qu’elle accueillait l’inconfort […] avec une sorte de tragique satisfaction » (A, I.15).
Indépendamment du chagrin qu’éprouve vraisemblablement cette veuve de guerre, on peut postuler que sa « tragique satisfaction » émane avant tout de la conscience d’incarner un rôle de choix. Nouvelle Andromaque, elle affiche son deuil par un « voile de crêpe noir » et un costume qui « avait en dépit de sa modestie – ou peut-être en raison même de son austérité que démentait la qualité du tissu, de la coupe, des accessoires – quelque chose d’ostentatoire, de théâtral […] » (A, I.13) ; le propos revient plusieurs fois sur cette tenue « théâtrale et ténébreuse » (A, I.16), « sombrement tragique » (A, I.22). La veuve choisit d’incarner le rôle principal d’une tragédie classique où l’importance dramaturgique du personnage implique son importance sociale, tandis que les confidents lui sont inférieurs sur ces deux plans. Comme une héroïne racinienne, donc, elle traîne à sa suite ses belles-sœurs d’origine très modeste, cantonnées dans des fonctions subalternes. On voit l’une d’elle lui essuyer ses chaussures boueuses, « penchée comme une servante » (A, I.11), et si ce rapport n’exclut pas l’affection, il n’en demeure pas moins strictement hiérarchisé : « Comme si elles lui avaient tenu lieu de servantes ou, au mieux, de dames de compagnie, embrassant pourtant chacune d’elles […], leur parlant avec cette douceur et cette patience légèrement contrariée, comme on le fait avec des personnes de condition inférieure, des parents pauvres […] » (A, I.15). Les belles-sœurs interchangeables, personnages ancillaires, n’expriment aucune volonté propre et n’existent que pour servir la veuve et sa quête : « En fait, elle ne formulait pas elle-même les questions, usant des deux femmes mal habillées comme des sortes d’interprètes, comme si elle-même n’avait pas parlé la même langue ou comme si quelque rite lui interdisait de s’adresser directement à des inconnus » (A, I.16). Par-delà l’orgueil de la veuve attachée à la supériorité de sa caste, on voit qu’elle conforme soigneusement son existence à un « rite », plus précisément les canons du théâtre classique. De sorte que, lorsqu’enfin elle se recueille sur une tombe, la narration suggère que cette tombe ne renferme pas nécessairement la dépouille de son mari, mais qu’elle remplit un rôle nécessaire de clôture :
Et à la fin elle trouva. Ou plutôt elle trouva une fin – ou du moins quelque chose qu’elle pouvait considérer (ou que son épuisement, le degré de fatigue qu’elle avait atteint, lui commandait de considérer) comme pouvant mettre fin à ce qui lui faisait courir depuis dix jours les chemins défoncés […]. (A, I.24)
Dramaturge autant que personnage, la veuve satisfait instinctivement à l’exigence aristotélicienne d’une fin. Mais on y retrouve cette tension persistante entre adéquation formelle et inadéquation matérielle, car le texte suggère que le corps du personnage commence à fléchir et « lui command[e] de considérer » comme recevable une tombe on ne peut plus incertaine, indiquée par « quelqu’un qui avait eu pitié d’elle […] ou peut-être avait simplement voulu s’en débarrasser » (A, I.25). Sur cette tombe, « en allemand et sur une plaque métallique, puis en français sur une planchette plus récemment apposée, était simplement écrit que se trouvaient les corps de deux officiers français non identifiés » (ibid.). L’un de ces corps anonymes, comme un comédien, endosse le rôle d’Hector, et la veuve de se diriger « tout droit » (A, I.24) vers la tombe pour y prier : l’évidence des gestes exclut le doute, comme s’il revenait à cette femme de hisser un réel désintégré à la hauteur des exigences de la tragédie.
Par la suite, le roman remonte à la jeunesse de ce personnage, pour montrer que cette conception prédéterminée de l’existence ne s’est pas formée au moment de son veuvage, mais bien en amont : « Elle n’était pas pressée. Comme si […] elle se savait destinée à quelque chose d’à la fois magnifique, rapide et atroce qui viendrait en son temps » (A, V.113), ou « C’était comme si elle avait su à l’avance […] » (A, V.116). Ou encore :
Et pendant tout ce temps elle continuait de ne rien attendre, pas plus qu’un voyageur n’attend le train dont il sait qu’il doit partir à l’heure fixée par l’indicateur des chemins de fer […], comme si, sans même qu’elle se le formulât, sans qu’elle s’en fît même une idée, même imprécise, quelque chose l’attendait qui ressemblerait à une lévitation, quelque apothéose où elle se tiendrait, transfigurée et pâmée, portée sur un nuage soutenu par des angelots et d’où elle serait précipitée ensuite avec violence dans le néant. (A, V.118-119)
Son existence ne lui apparaît pas comme le fruit du hasard mais, au contraire, aussi « fixée » qu’un horaire ferroviaire, assurée de « venir en son temps ». C’est ce caractère fixe qui élève les événements de sa vie au rang d’une « destinée ».
La narration postule que telle est, en tout cas, la façon dont elle-même perçoit son parcours, revenant avec insistance sur ce point, mais sans que l’instance narrative indique si elle s’associe à cette lecture ou s’en dissocie. La question est d’autant plus complexe que le personnage, comme le lecteur le comprend progressivement, représente la mère de Simon, et que l’écrivain a fait usage des archives familiales (photographies, lettres) pour reconstituer ses années de jeunesse. Ce faisant, Simon propose-t-il sa propre interprétation de la biographie de sa mère ? Prétend-il restituer la façon dont elle-même envisageait son existence ? La construction du roman est, sur ce point, à interroger. En choisissant de l’ouvrir sur cette quête déterminée dans un paysage indéterminé, Simon fait peser la tension entre ces deux polarités sur l’intégralité de l’œuvre. En revanche, la construction des chapitres suggère que la narration exclut le hasard au profit de la cause finale : le chapitre I représente cette femme cherchant la tombe de son mari, après quoi le chapitre V revient en arrière pour relater sa jeunesse, sa rencontre d’un officier, sa vie maritale avant la guerre. Le parti pris de débuter l’histoire au point de son veuvage pour remonter ensuite aux actes précédents semble inscrire sa biographie dans un schéma téléologique. Il en va de même pour son défunt mari (représentant, on l’aura compris, le père de Simon) : le chapitre III relate sa mort au front durant les premiers jours de la Première Guerre mondiale avant de retracer son origine familiale et son parcours, comme si cet ensemble complexe de circonstances l’avait mené inexorablement à mourir aux champs d’honneur. C’est ce qu’indique une phrase qui, tout à la fois, conclut le récit de sa mort et inaugure celui de sa vie : « Ainsi venait de prendre fin une aventure commencée vingt-cinq ou trente ans plus tôt […] » (A, III.62). Toutes les années de formation de cet homme (relatées à partir de ce point dans tout le détail que Simon affectionne) sont placées sous le signe de sa mort. Pour citer Pascal Mougin, « la régie narrative s’exhibe ici sur le mode balzacien – fait rare – pour lancer une biographie rétrospectivement vectorisée en destin, tendue vers « l’échéance, le point d’arrivée de ces vingt années » ».3 Comme le souligne le critique, par sa rareté même, une telle intervention de l’instance narrative donne un poids considérable à ce bilan et érige la biographie en destin.
Pourtant, à l’égard de cette biographie particulière, l’ironie narrative est palpable et porte précisément sur son orientation téléologique : le protagoniste est tout entier déterminé par une éducation qui le voue à mourir, car en devenant officier, il est invité, avec ses pairs, à envisager les batailles, « victoires aussi bien que défaites », comme « la seule façon convenable d’exister ou de mourir » (A, III.54), et à ne pas admettre « que l’on pût exercer quelque commandement que ce fût autrement que debout, de préférence dans un endroit dégagé, jumelles en main et bien en vue […] » (ibid.). L’efficacité tactique reste tout à fait secondaire au regard de la beauté du geste, et l’officier est soigneusement formé, non à déterminer sur le champ de bataille la meilleure stratégie, mais à y présenter une cible de choix :
la seule chose qu’on lui demanderait en échange […] serait non pas tant de se battre, non pas tant même de mourir que de le faire d’une certaine façon, c’est-à-dire (de même que l’acrobate ou la danseuse étoile revêtus de collants rapiécés transpirent et se désarticulent en coulisse […] en vue du bref et fugitif instant d’équilibre instable, l’apothéose orchestrale ou le roulement de tambour pendant lesquels ils s’immobiliseront […], souriants, gracieux, éphémères et impondérables sous les tonnerres d’applaudissements) seulement de se tenir vingt ans plus tard debout, bien en vue, les galons de son képi étincelant au soleil, ses inutiles jumelles à la main, patientant jusqu’à ce qu’un morceau de métal lui fasse éclater la cervelle. (A, III.76)
En vertu d’un topos théâtral omniprésent chez Simon (et qui fait dire à de nombreux critiques que ses œuvres ont des accents baroques4), les officiers ne sont tenus ni de gagner, ni de « se battre », mais de mourir dans les formes. On relèvera les échos verbaux (« jumelles à la main », « bien en vue ») entre le passage cité plus haut, exprimant la façon dont les officiers envisagent leur existence dans le train qui les emmène au front (A, III.54), et celui-ci, relatant la mort de cet officier particulier, comme s’il s’était consciencieusement tenu à son texte. Formé à un rôle et se confondant avec lui au point d’être longuement comparé à un « acrobate » ou une « danseuse étoile » au sommet de leur art, l’officier est engagé dans une performance hautement maîtrisée, vide de sens et mortelle.
Cela suggère que l’adhésion à un rôle ne relève pas de la prédestination mais d’une illusion destructrice. Alors que l’œuvre suggère bel et bien une lecture téléologique, elle la mine par son ironie : si les protagonistes s’envisagent à la lumière d’un destin (mort aux champs d’honneur, veuvage tragique), la narration prend soin d’indiquer que ce destin est littéralement le fruit d’un « accident » (A, III.68), la chute de cheval d’un jeune homme d’origine très modeste, travaillant d’arrache-pied à son ascension sociale et qui, ne pouvant plus envisager de préparer Polytechnique, se tourne à défaut vers la carrière militaire (ce qui l’amène à faire un beau mariage, un héritier et une fin glorieuse). Cette chute malencontreuse est représentée en ces termes :
[…] l’événement qui devait décider de la suite de sa vie, jusqu’à le placer quelque vingt ans plus tard par une journée d’août, à la lisière d’un bois, sur la trajectoire d’une balle qui viendrait lui fracasser le crâne. (A, III.67)
En consacrant un roman aux biographies croisées de ses parents, Simon interroge avec insistance le caractère à la fois accidentel et décisif de ces événements, faisant s’affronter deux conceptions de l’existence, le hasard aveugle et la surdétermination téléologique. L’ironie avec laquelle l’écrivain traite du parcours de son père peut nous incliner à considérer la deuxième conception comme illusoire.
Surdétermination de l’aléa dans Le roi de cœur
Plus systématiquement encore que Claude Simon, Hanna Krall5 a bâti son œuvre à partir d’archives, interrogeant les survivants, citant correspondances et documents divers, décrivant leurs photographies et inventoriant leurs possessions matérielles. Il en résulte un ensemble de biographies qui ont généralement le format de nouvelles, rassemblées dans des recueils soigneusement construits. Bien que Le roi de cœur tranche, par sa longueur, sur cet ensemble de récits, il présente la même alliance caractéristique entre un projet biographique et une forme discontinue, soigneusement construite.
Le modèle que convoque Hanna Krall dans Le roi de cœur n’est pas celui de la tragédie, mais Izolda, la protagoniste, n’en conçoit pas moins sa vie comme déterminée par une logique implacable : comme pour le protagoniste féminin de L’acacia, tout dans l’existence d’Izolda est orienté vers, et par, son mari. Le roman, divisé en vignettes plus ou moins longues, assorties de titres, s’ouvre sur leur rencontre :
LES LACETS
Elle achète des lacets pour des chaussures d’homme.
[…] Elle […] a emprunté une paire de chaussures parce qu’une bombe a détruit l’immeuble de la rue Ogrodow, et elle n’a plus accès ni à son armoire ni même à son appartement.
Avec les chaussures empruntées, elle s’arrête chez son amie Basia Maliniak. Juste le temps d’enfiler les lacets.6
La « bombe » renvoie aux bombardements massifs infligés par l’Allemagne nazie aux populations civiles durant l’assaut sur la Pologne, en septembre 1939. Mais l’Histoire joue ici une fonction ancillaire, car l’effet principal des bombardements, aux yeux d’Izolda, est de l’amener chez son amie Basia, où elle rencontre un jeune homme, Shayek, qu’elle épouse bientôt. En vertu de ce schéma inaugural, les événements que vit Izolda n’entrent en ligne de compte qu’en tant qu’ils affectent, ou pourraient affecter, son mari. Prise dans une rafle (sans doute à l’été 1942), elle s’inquiète avant tout de la réaction qu’aura ce dernier ; y ayant échappé de justesse, elle parvient à quitter le ghetto, mais n’a de cesse d’y retourner pour faire sortir Shayek. Peu après, l’insurrection du ghetto et sa terrible répression dans les flammes (entre janvier et mai 1943) l’effraient surtout en tant qu’elles pourraient compromettre la survie de son mari. Une fois qu’il est arrêté, elle redouble d’énergie pour lui envoyer des colis, prenant les plus grands risques dans l’espoir de le sortir du camp. Elle est persuadée que telle est sa destinée, une conviction renforcée par ses visites à une amie adepte de cartomancie qui, dans les moments de doute, la rassure sur la survie de son « roi de cœur ».
Ces cartes étalées sont, pour Izolda, les signes dans lesquels sa destinée se révèle, et le roman semble lui donner raison par le choix du titre ; dans le même temps, le lecteur peut y voir une configuration arbitraire, interprétée selon des règles non moins arbitraires. Cette tension entre deux lectures antagonistes se manifeste dans de nombreux passages. Ainsi Krall interrompt régulièrement le récit par des plages d’hypothèses en série :
Si elle n’avait pas traîné dans la rue dans cet accoutrement absurde, on ne l’aurait pas prise pour une prostituée.
[…]
Si elle n’était pas allée chez le concierge (pour le prévenir que la mondaine risquait d’enquêter sur elle), elle n’aurait pas été au courant de la visite du facteur.
Ni de la lettre.
Elle n’aurait pas su que son mari demandait de la nourriture. Qu’il lui avait laissé sa nouvelle adresse : Mauthausen, baraque AKZ.
Bref, les choses de la vie ont une façon bien curieuse de se lier entre elles. (RC, 827)
Par ces enchaînements d’hypothèses non actualisées, Izolda identifie des carrefours où son existence aurait pu prendre une direction tout autre ; elle y voit la confirmation du bien-fondé de ses décisions et du lien « curieux », mais à ses yeux, organique, entre « les choses de la vie ». De même que la veuve dans le roman de Simon, elle considère la fin de l’histoire comme finalité. Le lecteur peut au contraire y voir le rôle du hasard aveugle, de sorte qu’une même forme (l’accumulation d’hypothèses) peut exprimer aussi bien la conviction du personnage que le scepticisme de l’instance narrative.
La même tension se manifeste lorsqu’Izolda est déportée à Auschwitz et reconnaît sur une codétenue un pull multicolore autrefois tricoté par Basia : elle n’en conclut pas que Basia est morte et que ses propres chances de survie sont faibles mais, plutôt, que Basia lui adresse un « signe », puisque c’est chez Basia qu’elle a connu Shayek (RC, 107-108). Tout au long de la guerre, alors qu’elle connaît le ghetto puis la clandestinité, la prison, le travail forcé, la Gestapo et plusieurs camps, son existence reste orientée par son mari. Plus d’une fois, elle prend une décision dangereuse, comme aborder le docteur Mengele à Auschwitz afin d’être choisie pour un transport, parce que cela la rapprocherait de Mauthausen où Shayek a été transféré. Cela lui réussit : elle quitte Auschwitz pour un camp secondaire, Guben, où sa vie n’est pas menacée. Elle veut pourtant veut s’en évader pour éviter d’être coupée de son mari par l’avancée de l’armée russe. Son amie Janka Tempelhof, qui tente de la raisonner, finit par y renoncer :
Janka devient songeuse, puis elle déclare : c’est ton daimonion. Il t’envoie sur la route, alors vas-y. Il faut écouter la voix de son daimonion.
(À dire vrai, elle n’a pas la moindre idée de qui est ce « daimonion », mais elle a honte de demander. Elle conclut que ça doit être quelqu’un d’important, que même Janka Tempelhof n’ose pas contredire.)
(RC, 116)
Par la suite, Izolda adopte ce terme de « daimonion » qui conforte sa certitude d’avoir suivi une inspiration supérieure, une voie qui lui serait propre et l’aurait sauvée quand ses proches, pourtant moins exposés, ont péri :
S’il n’y avait pas eu Vienne, elle serait restée à Varsovie. Elle aurait été morte durant l’insurrection, dans une cave, avec sa mère.
Si elle ne s’était pas évadée de Guben, elle aurait suivi le convoi avec d’autres femmes.
Elle serait arrivée à Bergen-Belsen.
En pleine épidémie de typhus.
Elle serait morte du typhus, avec Janka Tempelhof.
Dieu a sans doute décidé qu’elle devait survivre à la guerre.
Ou peut-être pas. Il a décidé qu’elle devait mourir, mais elle s’est opposée de toutes ses forces à sa volonté. C’est pour cela qu’elle a survécu. Dieu n’y est pour rien. Tout le mérite lui revient. À elle – uniquement.
(RC, 116-117)
Régulièrement, le récit effectue ce type de bilan qui suggère à quel point la survie d’Izolda est le fruit du hasard, et à quel point celle-ci y voit, au contraire, la confirmation d’une détermination hors du commun. Que sa survie soit due à Dieu ou à son seul « mérite », Izolda est persuadée d’avoir accompli sa destinée ; à la fin de sa vie, se désignant comme « la grande spécialiste de la survie » (RC, 174), elle esquisse intérieurement quelques conseils destinés à sa famille, mettant sur le même plan les questions pragmatiques (« il faut se décolorer les cheveux », RC, 175) et métaphysiques (« il faut écouter la voix de son daimonion », ibid.).
Que Shayek ait survécu (en cachant sa judéité) cautionne rétrospectivement, aux yeux d’Izolda, tous les choix stratégiques qu’elle a faits. Longtemps après la guerre, alors que son mari se demande douloureusement pourquoi, seul de sa famille, il a survécu, Izolda n’éprouve aucun doute sur la question : c’est « grâce à elle » (RC, 161). La lecture qu’elle fait de leur existence est structurée par une causalité évidente.
En corollaire, elle conçoit cette existence sur le mode d’une œuvre cinématographique stéréotypée. La première fois que ce modèle est convoqué, il est vrai qu’il s’agit avant tout d’une stratégie pour convaincre un officier soviétique de lui laisser franchir un pont :
Explique-moi, lui dit-elle avec un sourire charmeur, pourquoi la vie n’est pas comme dans un film ?
Et ce serait comment dans un film ? Le capitaine trempe son blini dans une gamelle remplie de beurre fondu en attendant sa réponse.
Dans un film, je t’aurais raconté mon histoire ; profondément ému, tu aurais demandé au garde de me laisser traverser le pont.
Oui, ce serait un beau film… Le capitaine cesse de manger. Il devient pensif, le blini à la main, un filet de beurre jaune coulant dans sa manche. Je vais te raconter un vrai film. Le front russe passait près de mon village… cinq kilomètres à tout casser. J’ai voulu faire mes adieux à ma femme, à ma mère, mais le commandant a refusé : tu n’iras nulle part, la guerre n’est pas terminée. Et quand la guerre fut enfin terminée, devine quoi. Le capitaine se penche vers elle par-dessus la table, comme s’il voulait lui confier un énorme secret. Il n’y avait plus de village. Plus de mère, plus de femme, plus de village. C’est difficile à comprendre, non ? Alors toi non plus tu n’iras nulle part. Je n’ai pas dit au revoir, tu ne diras pas bonjour. Il n’y aura pas de film. (RC, 139-140)
Ce capitaine oppose le « vrai film » marqué par la négation (« ne plus », « ne pas ») au « beau film » modalisé par le conditionnel (« ce serait un beau film »). Dans son discours, l’annulation du passé entraîne l’annulation de l’avenir en des structures symétriques : « Il n’y avait plus […] Il n’y aura pas […] », « Je n’ai pas dit […] tu ne diras pas […] » – dès lors, il vit dans l’instant présent, dégustant son blini au beurre et entreprenant de coucher avec Izolda. L’alcool a toutefois raison de ce projet, et il échoue autant à arrêter Izolda qu’à modifier sa conception de l’existence : dès le lendemain, elle franchit le pont (avec la complicité d’un garde soviétique puis, du côté américain, d’un juif de New York), et elle persiste à envisager sa vie sous un jour cinématographique. En effet, après la guerre, comparant ce qu’elle a vécu avec de nombreux récits de survivants, « Elle acquiert la certitude que sa vie serait un excellent sujet pour un livre. Ou mieux encore pour un film » (RC, 163). Son rôle serait joué de préférence par Elizabeth Taylor (ibid.), à laquelle on dit qu’elle ressemble (RC, 121).
Choix narratifs et écarts
L’œuvre que lit le lecteur doit son existence à cette conviction : Izolda, jugeant qu’un roman est la première étape en vue d’une future adaptation cinématographique, sollicite successivement trois écrivains. Le premier se dérobe, le second « ne s’intéresse qu’à sa propre histoire, pas à celle des autres » (RC, 165), le troisième est « une femme polonaise » qui accepte d’écrire : « Mais le livre qui en découle ne satisfait pas ses attentes. Il n’y a pas assez de sentiment. Pas assez d’amour, de solitude et de larmes. Et pas assez de cœur non plus. Ni de mots. Bref, tout y manque. Tout. » (RC, 165) Ce troisième écrivain non identifié est Hanna Krall. Celle-ci, au terme d’une série d’entretiens avec une rescapée8, a rédigé un texte qui a gravement déçu l’intéressée, avant de reprendre et développer le propos dans Le roi de cœur, qui n’a sans doute pas mieux répondu aux attentes de son instigatrice, et qui se fait l’écho de sa frustration. L’œuvre souligne donc le fossé qui sépare les conceptions de la protagoniste de celles de l’auteur, en matière de biographie. Plus exactement, cette biographie avance sur une ligne de crête : la narration ne se dissocie jamais explicitement des conceptions de la protagoniste, celles-ci étant relatées par le biais du style indirect libre – un mode dont de nombreux critiques ont souligné l’ambiguïté9. Ce régime de double énonciation (narrateur et personnage parlant d’une seule voix), de même que la construction du roman (sélection et agencement des péripéties en fonction d’un point névralgique, Shayek), suggèrent que la narration adopte le point de vue d’Izolda. Et cependant celle-ci n’a pas directement la parole ; le style indirect libre maintient le filtre d’une narration hétérodiégétique. Il en va de même dans L’acacia, qui adopte fréquemment la focalisation interne mais donne rarement et brièvement la parole aux protagonistes – ce qui en fait une exception parmi les œuvres de Simon, où il est fréquent que les protagonistes prennent en charge de longues plages narratives à la première personne. Le parti pris du style indirect libre, dans L’acacia, implique par contraste que leurs conceptions apparaissent à travers un écran qui ne se fasse pas oublier, qui maintienne une forme de distance critique envers elles. Cela est d’autant plus étonnant que les chapitres pairs de L’acacia répondent à un projet autobiographique ; alors qu’il relate des événements cruciaux de sa propre existence, et sans passer par un nom fictionnel (comme il l’a fait dans des œuvres antérieures), Simon maintient cette distance entre instance narratrice et protagoniste, rédigeant une curieuse autobiographie à la troisième personne.
Cela nous amène à revenir sur l’alternance des chapitres impairs et pairs dans L’acacia, les impairs étant consacrés à l’officier et (surtout) à la femme de bonne famille qu’il a épousée, les pairs à leur fils (c’est-à-dire Claude Simon lui-même). Les biographies des parents, on le voit, encadrent voire encerclent celle du fils, que tout pousse à s’engager dans la voie prédéterminée par ses géniteurs : tôt enfermé dans l’uniforme10, tôt rattrapé par la guerre, il voit (comme son père avant lui) sa brigade décimée aux premiers jours des combats. Après avoir erré au hasard, il se retrouve à suivre un colonel qui comme le père préfère la beauté du geste et le brillant de l’uniforme à toute considération tactique. Alors que les cavaliers menacés par les avions allemands apprennent vite à maculer leurs casques d’une boue ignoble (au besoin en urinant sur la terre)11, le colonel arbore, y compris dans la débâcle, un extérieur rutilant : « coiffé non de boue mais d’acier étincelant, et sur les manches du manteau […] les cinq galons d’or étincelant aussi » (A, II.35), « les bottes aussi étincelantes que si elles venaient d’être cirées, les éperons étincelants, le soleil étincelant sur les cinq galons d’or au revers de la manche […] » (A, IV.101). À la récurrence de l’adjectif « étincelant » et des « galons », qui fait, du colonel des segments de 1939-1940, un double du père mort en 1914, Simon représente l’armée française comme incapable de se libérer de ses costumes et de ses rôles prédéterminés – ce qui vaut au colonel d’être appelé « l’espèce d’anachronisme équestre brandissant son sabre »12. Dès lors, tout semble vouer le jeune cavalier à la même mort que son père13. De fait, allongé dans le train une fois mobilisé, il a l’impression d’apercevoir, dans une « perspective télescopique », « les vingt-six années qui maintenant allaient selon toute probabilité trouver une fin » (A, VI.160-161), se voyant « gisant comme dans une boîte à l’intérieur d’un compartiment de chemin de fer » (A, VI.166). Cette orientation téléologique est renforcée par la construction narrative, non seulement parce que les chapitres pairs, relatant son existence, sont encadrés comme on l’a dit par ceux qui retracent celles de ses parents, mais parce que toutes trois obéissent au même parti pris : on rencontre d’abord ce fils au point le plus dangereux de son existence (l’hiver atroce, puis les terribles retraites de 1940, respectivement aux chapitres II et IV) avant de revenir sur son existence antérieure (chapitres VI et VIII), comme si tout l’avait mené au-devant de la mort.
Or ce fils, contrairement à toute attente, ne meurt pas dans les combats. Il échappe à l’embuscade où tombent ses camarades, puis à la rafale qui fauche son colonel ; fait prisonnier, il endure une captivité sordide, s’évade de manière non moins sordide et, survivant à peine, redécouvre les fonctions primaires de l’existence, ce qui a le mérite de le débarrasser de toute posture et de toute théâtralité. Le roman suggère ainsi que la conception téléologique de l’existence qui semble orienter son père, sa mère et son colonel est un piège dont le personnage réussirait à s’extirper14. Le hasard, dans toute sa cruauté, aurait au moins le mérite de le libérer de l’enfermement tragique. En sens inverse, le schéma d’une destinée tragique, pour accablant qu’il soit, fournirait à certains personnages un écran masquant l’insupportable arbitraire du monde ; il leur permettrait (pour citer Rosset) de « Débrouiller le désordre apparent, faire apparaître des relations constituantes et douées d’intelligibilité, […] assurant ainsi à l’humanité et à soi-même l’octroi d’un mieux-être par rapport au malheur attaché à l’errance dans l’inintelligibilité […] »15. Mais dans l’un et l’autre cas, le modèle formel de la tragédie relève de l’illusion à dépasser.
De même, le roman de Krall creuse l’écart avec le « beau film » dont rêve Izolda16. Elle a, certes, retrouvé Shayek ; traversant la Pologne, l’Allemagne et l’Autriche en ruines, empruntant (telle Ulysse) diverses identités et stratagèmes, interrogeant inlassablement les survivants des camps, elle parvient enfin à retrouver sa trace et le rejoint dans un camp annexe de Mauthausen, réalisant contre toute attente le topos qu’elle esquissait pour l’officier soviétique :
Son mari vient vers elle. Il l’enlace – doucement, avec attention…
Elle attend.
Dans un instant, je vais ressentir une joie immense, se dit-elle. Je serai sûrement comblée de bonheur.
Elle ne ressent pas de joie.
Elle n’est pas comblée de bonheur.
Elle ne ressent rien, absolument rien.
C’est parce que je porte les gants, pense-t-elle.
Elle retire les gants derrière le dos de son mari et les jette par terre. Elle le caresse doucement. Il est chaud. Est-ce tout ? Elle sent monter en elle de l’amertume. Ce n’est pas juste : elle a retrouvé son mari et elle n’est même pas heureuse. (RC, 144)
La fin cinématographique tant attendue la laisse vide d’émotion. Et surtout, ce n’est pas la fin, puisque son existence, et l’œuvre, se poursuivent après-guerre, de façon à déjouer cruellement ses attentes : Shayek, abîmé dans le deuil, se ferme toujours plus à sa femme ; un matin, elle le trouve parti. Ce qui orientait son existence s’avère nul et non avenu. Si Krall faisait débuter son récit par la rencontre amoureuse, elle ne l’interrompt pas au moment des retrouvailles mais le prolonge de manière à révéler le fossé qui sépare désormais Izolda de son mari.
Cette cruauté est renforcée par le montage narratif : Krall, qui segmente son récit en vignettes de longueur irrégulière, perturbe la linéarité chronologique par de fréquents zigzags dans le temps. Dans de nombreuses plages, le récit confronte la façon dont Izolda s’est imaginé l’après-guerre et ce qui s’est, entre temps, réalisé. Prenant là encore modèle sur deux films, Rose-Marie (où un couple se retrouve en dépit de tout ce qui les sépare) et, surtout, That Hamilton Woman17, où une femme (Lady Hamilton, incarnée par Vivien Leigh) estime que sa vie se résume à sa passion pour un homme (l’amiral Nelson), Izolda s’imagine dans un fauteuil, « vieillie mais toujours belle », entourée de livres et de musique, racontant une « histoire incroyable que sa petite-fille assise à ses pieds écoutera le souffle coupé » (RC, 20). Or comme le montrent ces plages (dont le titre commence toujours par « LE FAUTEUIL » pour rappeler l’inspiration cinématographique d’Izolda), « Son projet pour la vieillesse s’avère irréel » (RC, 37) : la vue et l’audition d’Izolda ne lui permettent plus ni livres ni musique, et elle n’a pas de langue en commun avec sa petite-fille israélienne – ce qui représente un échec plus sérieux encore. À l’un des moments les plus critiques de son existence, dans une prison de Vienne d’où elle ne sort que pour être torturée par la Gestapo, Izolda parle avec une codétenue française et communiste nommée Nicole, qui a été arrêtée avec son amoureux, mais accepte l’idée de le voir fusillé ou de l’être elle-même. Izolda se jure alors, si elle survit à la guerre, que ses enfants n’auront pas à mourir pour une patrie ou une cause. Or sa fille, devenue adulte, décide de vivre en Israël. Izolda tente de l’en dissuader :
Mais c’est un pays en guerre, explique-t-elle à sa fille.
C’est mon pays, dit la fille.
Ton mari sera enrôlé dans l’armée.
Tant pis. C’est son armée et son pays.
Mais il peut mourir ! Ne comprends-tu pas qu’il risque de se faire tuer ?
Eh bien, il se fera tuer. Il sacrifiera sa vie pour son pays.
[…] Elle se rappelle sa conversation avec Nicole – sur ses futurs enfants qui n’iront plus à la mort pour rien. J’ai dû le prononcer au mauvais moment, pense-t-elle avec effroi. (RC, 159-160)
En dépit de ses arguments, « L’une après l’autre, ses deux filles partent s’installer en Israël » (RC, 160), pays où non seulement les gendres d’Izolda mais ses petites-filles doivent accomplir un dangereux service militaire. Lorsque Shayek la quitte, Izolda part rejoindre filles et petites-filles dans ce pays qui, loin de représenter une terre promise, scelle l’échec de tout ce qu’elle espérait réaliser.
Ainsi, dans L’acacia comme dans Le roi de cœur, en n’achevant pas la biographie au point vers lequel celle-ci semblait se diriger, les auteurs marquent leur scepticisme envers toute conception prédéterminée de l’existence. Tout particulièrement, le lien organique que le personnage féminin croit entretenir avec son mari, le lien qui oriente son existence tout entière, se révèle illusoire. C’est un débat que Simon a déjà orchestré dans La route des Flandres – à ceci près que dans ce roman, c’est une femme (Corinne) qui affirme l’arbitraire du lien alors que l’homme (Georges) refuse d’admettre que « la première venue »18 aurait fait l’affaire. Au-delà du désir qu’il éprouve pour Corinne, Georges est convaincu du fait qu’elle a orienté son existence et celle de ses compagnons, estimant que la probable infidélité de Corinne a mené son mari à un probable suicide durant la Débâcle. Ayant survécu à une embuscade, à une période d’errance à la suite du mari, le capitaine de Reixach, à la rafale qui a fauché le capitaine, à un transport cauchemardesque vers un camp, à la faim et aux travaux forcés, George n’a de cesse de retrouver Corinne et de chercher obstinément dans le corps même de celle-ci la clef de ces événements ; la narration associe étroitement l’obsession sexuelle et les mésaventures militaires au point que celles-ci semblent avoir pour origine le personnage féminin même. Le roman est ainsi parcouru par une conversation de sourds entre Georges, qui ne cesse d’affirmer à Corinne qu’elle représente bien l’objet et le terme de sa quête19, et Corinne qui récuse absolument ce lien privilégié20, jusqu’à ce que Georges finisse par douter21. Il importe de souligner que la tension entre détermination et indétermination, destinée et hasard, n’est pas genrée ; ni Simon, ni Krall ne représentent les femmes comme particulièrement aveugles ou sentimentales. Le problème se pose pour toute biographie qui implique une période chaotique, privée de repères : il s’agit de trouver un modèle formel par lequel recouvrer l’intelligibilité de l’existence.
Parallèle historique et représentation de l’histoire
(Les histoires racontées par ceux qui ont survécu ont un début, un milieu et une fin. Elles se terminent par un fait qui aujourd’hui encore les surprend : ils sont en vie.
Leurs enfants et leurs petits-enfants aussi essaient de raconter, mais ce sont des histoires sans milieu et sans début. Elles se terminent là où elles devraient commencer.
À vrai dire – il ne s’agit pas de véritables histoires. […])22
Dans un recueil de nouvelles, Krall interrompt son récit par une réflexion formelle qui répartit les histoires qu’on lui rapporte en deux catégories : celles qui « ont un début, un milieu et une fin » et celles qui, en l’absence de ces délimitations et articulations nettes, ne sont « pas de véritables histoires ». Le problème de la seconde catégorie est qu’elle échoue à se constituer en récit, le problème de la première est qu’elle confère à la survie un rôle qui la surdétermine, sur le plan formel (elle clôture le récit) et existentiel (elle suggère une forme de providence là où règne le hasard). Ce problème ne cesse de se poser douloureusement dans les récits de survivants, que ce soit ceux d’Amery, Levi ou Kertész, dont l’un des personnages qualifie sa propre survie d’« accident industriel unique en son genre »23 et refuse qu’on la raconte, de crainte que l’exception ne fausse la représentation. Comme eux, Simon et Krall, qui composent leurs œuvres à partir de matériaux biographiques et autobiographiques, doivent trouver une forme sans tomber dans l’illusion providentielle. Et ce, en dépit des attentes de ceux, enfants et petits-enfants, qui viennent trouver Krall avec ces fragments dans l’espoir qu’elle puisse leur en livrer la clef24. Ainsi leurs œuvres se construisent avec, et contre, les conceptions téléologiques des protagonistes.
L’un des choix formels opérés par Krall est représenté par ces plages narratives qu’on hésite à qualifier de prolepses ou d’analepses : il s’agit d’imaginer et/ou de raconter la vieillesse au sein de la période de la guerre (ce qui relève de la prolepse), et simultanément de confronter la vieillesse véritable à ce qu’Izolda s’imaginait dans le passé (ce qui relève de l’analepse). La complexité de ces regards croisés exprime bien la difficulté de représenter une existence. De même, le lecteur de Simon progresse dans plusieurs sens à la fois – en amont, parce que les chapitres I (errance d’une veuve de guerre) et II (errance d’une brigade de cavaliers en 1940) sont suivis d’un retour en arrière (chapitres V et VII pour la veuve, chapitres IV, VI et VIII pour son fils), de même que la mort de l’officier, au chapitre III, est suivie par sa biographie complète ; en aval, parce que ces plages biographiques sont entièrement orientées vers la fin attendue. Si l’on ajoute qu’un dispositif en miroir associe étroitement deux générations, la destinée des parents paraissant prédéterminer celle du fils, la destinée du fils répéter celle des parents, il devient difficile de dire si ces biographies sont orientées vers le passé ou vers l’avenir.
Cela caractérise toute œuvre cyclique (l’avenir étant aussi le retour du passé) et toute œuvre fondée sur un traumatisme (le passé persistant à hanter le présent25). La cyclicité, suggérée par des parallèles narratifs discrets dans Le roi de cœur26, est encore plus visible dans L’acacia. Dans Le roi de cœur, Shayek et Izolda reviennent vivre en Pologne, mais en cachant leur identité juive (y compris à leurs filles, élevées en catholiques). En un passage aux parallélismes marqués (RC, 150sqq), Izolda fait successivement retoucher le numéro qu’on lui a tatoué à Auschwitz (il faut faire disparaître la partie qui l’identifie comme juive) et la photographie de son beau-père (il faut faire disparaître sa barbe). Il leur est impossible de parler ouvertement de crainte d’être entendus par leurs voisins à l’affût derrière des cloisons trop minces – exactement comme durant la guerre. Bien après le départ de l’occupant nazi, le danger persiste. De fait, au bout de plusieurs années, Izolda et son mari sont identifiés comme juifs, privés de la citoyenneté polonaise et exilés. L’événement, non daté dans le texte, correspond sans doute à l’année 1968, marquée par une vague d’antisémitisme intense durant laquelle le gouvernement, sous couvert de lutter contre le « sionisme », traqua et expulsa les juifs de la fonction publique (non sans intimidations et violences), voire du pays. Des Polonais juifs ayant survécu au nazisme se voient alors malmenés et chassés par les autorités de leur propre pays. Krall n’explicite pas ce parallélisme, certainement parce qu’il lui paraît évident – il structure d’ailleurs La jolie Madame Seidenman d’Andrzej Szczypiorski, qui associe étroitement (dans un même bâtiment) deux périodes de la vie d’Irma Seidenman, celle où des inconnus se sont spontanément associés pour la sauver de la Gestapo et celle où elle a été violemment expulsée par ses propres compatriotes.
En outre, chez Szczypiorski comme chez Krall, le récit fait un passage par Israël27 qui montre que ce pays ne permet nullement aux juifs d’échapper à leur histoire. Lorsqu’Izolda part y vivre alors qu’elle ne parle pas l’hébreu, sa situation n’est pas sans rappeler celle qu’ont connue ses beaux-parents durant la guerre, âgés et faibles, obligés de se terrer en raison de leur physique et de leur « accent épouvantable » qui trahit immédiatement leur judéité. Certes, le danger, en Israël, n’est pas d’être déporté par les autorités, mais l’existence y est menacée par des attentats récurrents : le roman suggère ainsi que l’histoire se répète, d’autant qu’Izolda voit en ses quatre petites-filles le reflet de ses quatre belles-sœurs perdues28.
En fin de compte, si son existence est déterminée par quelque chose, ce n’est pas par un destin personnel et exceptionnel, mais par la difficulté commune aux juifs de vivre à quelque époque et dans quelque pays que ce soit. De même, dans le roman de Simon, la confrontation des époques fait prédominer le collectif sur l’individuel. La mobilisation en vue de la guerre représente le moment où le protagoniste des chapitres pairs perçoit l’inanité des « impostures » par lesquelles il a voulu « se dissimuler à lui-même son inexistence » (A, VIII.221), et il est symptomatique qu’immédiatement après cette prise de conscience, il se rappelle avoir vu, depuis un quai de gare à Berlin, une foule anonyme de familles manifestement promises à la déportation29. Pris dans un mouvement collectif, l’individu doit renoncer à l’« imposture » d’une destinée individuelle, reconnaître son insignifiance et, partant, son « inexistence ». Durant ses déplacements, lui et ses camarades parcourent un terrain saturé de références historiques, et de manière insistante, L’acacia suggère que les conflits se répètent sur le même terrain et selon le même mode opératoire : le nord-est voit périodiquement les troupes françaises affronter un déferlement de « Prussiens ». La Grande Guerre marche sur les traces des guerres révolutionnaires – leurs morts sont associés en une commémoration dérisoire « sur le plateau de Valmy » (A, III.47) –, la campagne de 1939-1940 marche sur celles de la guerre franco-prussienne de 1870 – les cavaliers découvrent durant leurs déplacements les mornes lieux que recouvrent les noms historiques de Sedan, de Bazeilles (A, VIII.250).
Dès lors, si le sentiment d’une destinée individuelle est illusoire, peut-on considérer que la collectivité, en revanche, connaît un sort prédéterminé – le destin quittant la sphère individuelle, mais pour mieux investir celle de peuples entiers ? La biographie (ou l’autobiographie) revêtirait alors un caractère non pas exceptionnel mais, au contraire, représentatif ; elle aurait pour fonction de rendre visible un destin collectif. La répétitivité des récits suggère assurément que l’Histoire bégaie. Pour savoir si, aux yeux de Simon et Krall, la responsabilité en incombe aux hommes ou à une puissance impersonnelle – que ce soit le destin, la nature, ou l’Histoire30 –, une étude bien plus longue serait nécessaire. On se contentera de souligner ici que ni Simon ni Krall n’adhèrent à l’idée d’une destinée nationale : on a vu avec quel scepticisme Krall traite de l’émigration en Israël, et avec quelle ironie Simon représente les officiers français, emprisonnés dans des rôles complaisants. Les parallèles narratifs fournissent un modèle intéressant pour représenter l’Histoire, mais ils ne soustraient pas les protagonistes à l’arbitraire et l’insignifiance de l’existence. Au contraire, ces protagonistes sont emportés, pour citer Simon, « comme des fétus ou de simples détritus à la surface d’une eau trouble » (A, VI.153) par une violence cataclysmique à la récurrence certes prévisible, mais qui les frappe de manière aveugle et indifférente ; les cavaliers des segments de 1939-1940 sont même accablés par la « somptueuse indifférence » qu’oppose le monde à leurs actes « dérisoires, anecdotiques »31.
Les parallèles narratifs simoniens, en définitive, suggèrent que la seule constante de cet univers indifférent et arbitraire est une mort non moins indifférente et arbitraire. Krall, de même, use du montage pour suggérer l’arbitraire de l’existence, notamment dans l’une de ses premières œuvres narratives, Prendre le bon Dieu de vitesse. Il s’agit d’un récit apparemment décousu formé d’entretiens avec Marek Edelman, l’un des rares survivants de l’insurrection du ghetto de Varsovie (en 1942), puis de l’insurrection de Varsovie (un an plus tard). Edelman rapporte ses souvenirs (la grande rafle du ghetto, l’insurrection), mais résume aussi de nombreuses autres existences, tandis que Krall interroge certains de ses proches ou collaborateurs, s’intéressant à la vie d’Edelman après la guerre, à Radom, dans le service de chirurgie cardiaque où il a exercé. Ces considérations médicales (sur les cas rencontrés, les patients en état critique opérés par Edelman et ses confrères) envahissent l’œuvre, apparaissant comme une digression vis-à-vis du sujet principal, avant de révéler une pertinence imprévue. Edelman représente en effet son travail comme une course de vitesse contre le bon Dieu :
Le bon Dieu est prêt à souffler la chandelle ; moi, je dois vite protéger la flamme, en profitant d’un de Ses moments d’inattention. Qu’elle brûle un peu plus longtemps qu’Il ne le souhaite.
C’est important, car Il n’est pas vraiment juste. En plus, c’est excitant, car si ça marche, on Lui a brûlé la politesse…32
De cette activité de chirurgien découle le titre de l’œuvre, Prendre le bon Dieu de vitesse, suggérant que l’existence est régie par une force cruelle et arbitraire (« Il n’est pas vraiment juste », accuse Edelman) avec laquelle le médecin doit ruser.
C’est en cela que les deux périodes (dans le ghetto, dans le service de cardiologie) s’avèrent liées. Edelman rappelle, d’abord, que dans le ghetto il occupait un emploi fictif à l’hôpital, dont la porte donnait sur l’Umschlagplatz où les juifs étaient chargés dans des wagons (PBDV, 14). Posté devant l’hôpital, Edelman pouvait ainsi repérer les membres de la résistance et les faire sortir du convoi ; il n’avait toutefois le droit de sauver qu’une seule personne. Depuis cette porte, il estime avoir vu quatre cent mille personnes aller à la mort (PBDV, 16 et 103). Dans sa vie d’après-guerre, en regardant les salles de l’hôpital depuis l’extérieur, il est frappé par un parallèle :
[…] la plupart des malades étaient condamnés. Ma tâche consistait à en sauver le plus possible. Un jour […] je me suis rendu compte que c’était la même tâche que sur l’Umschlagplatz. Là-bas aussi, je me tenais sous le porche et je sortais des individus d’une foule de condamnés. (PBDV, 102)
On pourrait penser qu’à travers ce rapprochement entre deux périodes de sa vie, Edelman entrevoit quelque chose comme un destin (« sauver le plus possible » de « condamnés »). Mais ce serait inverser le sens de sa pensée : au contraire, il insiste sur le bilan dérisoire de son action, puisqu’une infime proportion de personnes a été sauvée – qui plus est, pour un temps seulement, puisque leur mort reste inéluctable. Ainsi, dans le ghetto, l’infirmière en chef, Mme Tenenbaum, qui a obtenu un précieux « ticket de vie » (ce qui lui permet d’échapper à la déportation, du moins pour un temps), le confie à sa fille avant de se suicider, un sacrifice qui peut paraître vain puisque sa fille, peu après, est déportée et tuée. « Mais avant, elle a eu quelque mois de bonheur » (PBDV, 59), affirme Edelman. De même, le médecin lutte contre un ennemi qui finit par l’emporter :
Bien entendu, toute vie s’achève, et c’est toujours pareil. Mais il s’agit de différer le verdict, de huit, dix ou quinze ans. Ce n’est pas négligeable. Quand la fille de Mme Tenenbaum a survécu trois mois, grâce au ticket, je pensais que c’était beaucoup. Durant ces trois mois, elle a eu le temps de connaître l’amour. Quant aux petites filles que nous avons guéries ici de sténoses ou d’affections de l’aorte, elles ont eu le temps de grandir, d’aimer, d’avoir des enfants, c’est-à-dire qu’elles ont réussi bien plus que la fille de Mme Tenenbaum. (PBDV, 103)
Différer la mort est, aux yeux d’Edelman, une victoire à la fois dérisoire et capitale. Il y revient dans un passage que Krall a stratégiquement placé en conclusion du livre, et qui associe à nouveau le travail du médecin et du résistant :
C’est seulement après toutes ces heures de tension, mais aussi de bonheur – bien après – que tu réalises ce que cela représente : un sur quatre cent mille.
1 : 400 000.
Tout à fait dérisoire.
Mais puisqu’une vie représente cent pour cent pour chacun, peut-être que ça a tout de même un sens. (PBDV, 138-139)
Conclusion
L’acacia et Le roi de cœur se caractérisent par une rigueur documentaire évidente, et les auteurs s’imposent de ne rien inventer33, ce qui ne les empêche pas d’y assumer des choix hautement personnels : l’écriture de biographies véhicule leur conception de l’existence humaine. Les œuvres des survivants que sont Krall et Simon engagent un dialogue discret, mais continu, avec le problème du hasard. Tous deux manifestent une forme de fascination (non dénuée de respect) envers un personnage animé par une certitude dont eux-mêmes se distancient ; il en résulte une biographie tendue entre deux interprétations, exprimant à la fois la lecture téléologique que le protagoniste fait de son existence et les réserves que cette lecture ne manque pas de susciter. Celles-ci ne s’expriment pas directement, mais à travers des choix formels que le lecteur doit élucider : le style indirect libre qui maintient une forme de distance vis-à-vis des pensées du personnage, le montage narratif qui opère des rapprochements entre différentes plages temporelles. La construction narrative, qui semble dans un premier temps conforter l’interprétation téléologique du protagoniste, révèle en définitive une conception de l’Histoire certes répétitive et, de ce fait, prévisible, mais absolument arbitraire à l’échelle individuelle. Si l’impression qui en résulte est extrêmement sombre, et s’il faut absolument éviter de surinterpréter l’anomalie que constitue la survie, celle-ci, pour citer Marek Edelman, a « peut-être […] tout de même un sens ». Entre le contresens du destin, et le hasard comme négation radicale du sens, ces biographies se développent dans l’espace qu’ouvre modestement ce « peut-être tout de même ».