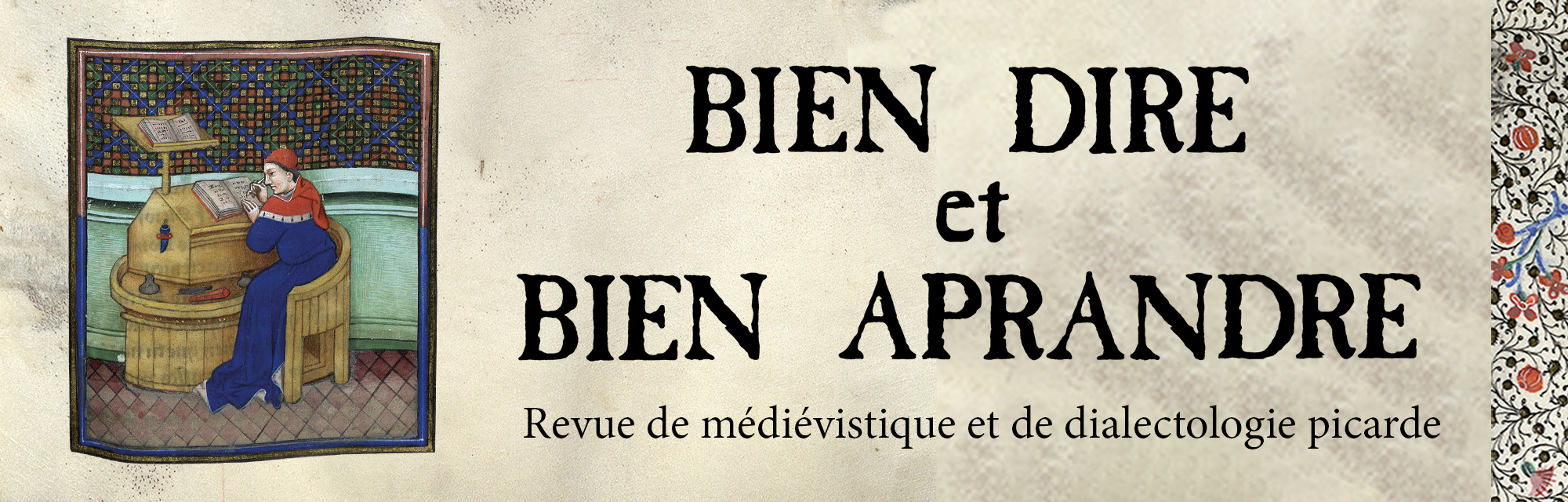Depuis les travaux de Noëlle Laborderie sur Florent et Octavien1 on connaît bien dans le domaine français un certain nombre de prolongements de la geste d’Othevien jusqu’aux mises en prose très tardives et aux continuations centrées autour d’autres membres de sa lignée comme Florence de Rome par exemple2. Plus significatives encore néanmoins semblent bien être les réécritures en moyen anglais : deux versions abrégées du xive ont connu un grand succès, suffisant pour que d’autres textes s’en fassent l’écho aux xive et xve siècles, notre propos sera donc, sinon de résoudre définitivement des questions d’attribution ou de primauté, de dégager les spécificités les plus remarquables.
Le Roman d’Othevien ou la chanson, puisque ces qualifications se rencontrent indifféremment au début et à la fin de l’œuvre, sans grande surprise du reste, comme le soulignait un très récent article de François Suard3, n’a été transmis que par un manuscrit unique de la Bodleian library d’Oxford, l’Hatton 100, qui date de la fin du xiiie ou du début du xive siècles et a été rédigé par un scribe anglo-normand4.
Il sera désormais question d’Octavian5 puisque les deux réécritures en moyen anglais portent ce titre. En Angleterre la popularité de l’histoire d’Octavian est attestée par des références dans d’autres œuvres en moyen anglais, ainsi dans Richard Coer de Lion, l’auteur déclare ne pas lire de roman
Off Pertenope, ne of Ypodamon,
Off Alisander, ne of Charlemanyn,
Off Arthour, ne off Sere Gawayn,
Nor off Sere Laucelet de Lake,
Off Betts, ne gy, ne Sere Vrake,
Ne off Wry, ne of Octavyan [...]6
l’énumération se poursuit quelque peu.
Dans le Troy Book7, Octavian est mentionné dans une liste similaire de héros au début du xve siècle. Enfin, dans le Speculum vitae, daté de la seconde moitié du xive siècle, il est fait référence à Octavian pour dénoncer le veyn spekyng – entendre les ‘propos vains, futiles’ – des ménestrels et des jongleurs :
ƥat make spekyn in many a place
Of Octavian and isambrace
And of many oper gestes
And namely whan pei come to festes8.
Octavian était en outre le sujet d’une tapisserie d’Arras qui a fait partie des collections d’Henry V et se trouve mentionnée dans l’inventaire établi pour Henry VI9. Enfin, dans le glossaire des Contes de Canterbury de Chaucer, rédigé par Thomas Tyrwhitt10, sous l’entrée Octavien, on lit ceci : « I do not suppose that Augustus is meant, but rather the fabulous emperor, who is the subject of a Romance entitled Octavian imperator11 »
Certes la moisson reste modeste et si toutes ces références ne s’avèrent pas positives, elles montrent que le personnage était bien connu, malgré ce titre singulier au demeurant puisque cet empereur « fabuleux » Octavian est de surcroît un faux héros qui n’apparaît guère dans toutes ces versions qu’à deux reprises : au début de l’œuvre pour décider du bannissement et a priori de la mort de sa femme et des jumeaux et à la fin où, fait prisonnier lors d’une terrible bataille contre les Sarrasins avec Dagobert et Florent(yn), une série de reconnaissances permet à la famille tout entière de se réunir.
Deux versions presque contemporaines l’une de l’autre12 ont la particularité de provenir du Roman d’Othevien. Là n’est pas le lieu d’établir un stemma mais le texte anglo-normand est désormais considéré soit comme la source directe à partir de laquelle ont été constituées deux versions autonomes, soit la source d’un texte intermédiaire qui en aurait été essentiellement la traduction en moyen anglais, perdu comme cela a pu être le cas d’une éventuelle source latine primitive13 ou d’une chanson de geste très ancienne du xiie, et aurait constitué de ce fait un jalon supplémentaire entre notre Roman d’Othevien et ces réécritures. Les versions en moyen anglais différent l’une de l’autre aussi bien par le dialecte utilisé, les vers employés que par un certain nombre de détails dans la narration, chacune ressemble davantage au Roman d’Othevien qu’à l’autre.
Deux manuscrits conservent la version septentrionale, composée dans les Midlands, peut-être le Yorkshire : le premier, détenu par la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Lincoln14, a été copié ca. 1440 ; il comporte 1629 vers avec des lacunes, dont un folio manquant et un autre déchiré. Le second, copié entre 1475 et 1500, est complet mais hélas moins soigné et fiable que le premier ; il se trouve à la bibliothèque de l’Université de Cambridge15 et comporte 1731 vers16 ; la laisse est de douze vers. Il convient aussi de rajouter un imprimé très fragmentaire, daté du début du xvie siècle, de l’édition de Wynkyn de Worde, conservé à San Marino (Californie)17 qui ne nous préoccupe pas ici.
D’aucuns ont voulu découvrir comme auteur de la version méridionale Thomas Chestre, thèse désormais délaissée18. Un seul manuscrit de la British Library en atteste19 ; il peut être daté du second quart ou du milieu du xive. Cette version, même si elle le fait moins que les versions nordiques, suit l’original de très près, souvent mot à mot20 ; elle compte 1962 vers, en laisses de six. C’est cette version, évidemment plus complète qui a la faveur des spécialistes. À titre d’exemple, nous nous permettrons de pointer un certain nombre de modifications par rapport au Roman d’Othevien. La simplification, l’omission de détails ou d’épisodes non essentiels à l’action, l’abrègement très caractéristique des passages d’introspection sont une constante chez les auteurs de romans en moyen anglais à partir de sources françaises du fait même d’un changement d’auditoire.
Le simple examen du nombre de vers implique que nos versions, tant méridionale que septentrionale, n’ont conservé qu’un tiers environ de la matière originelle21. Les omissions concernent les détails relatifs à Dagobert et à son mariage, la prière de l’impératrice pour échapper à son sort, les réactions de peur devant la lionne, l’énumération des alliés du sultan et le développement de l’histoire d’amour du géant pour la fille de celui-ci. Plus intéressantes sont donc les modifications qui montrent un souci d’efficacité de la composition en fusionnant par exemple deux épisodes consacrés au récit de la vie de l’impératrice à Jérusalem et à l’éducation de son fils, de fait redondants dans le Roman d’Othevien22. Dans Octavian, Florent est fait chevalier avant d’affronter le géant et épouse la fille du sultan lors de son retour à Paris23 : ainsi deux scènes d’adoubement puis d’armement sont concentrées et de même deux scènes de fêtes. Certaines modifications peuvent être l’indice d’une composition de mémoire ou par transmission orale24. Mais le fait que dans Octavian l’empereur épouse la fille de Dagobert25 peut être un indice de la prise en compte de l’appartenance à une geste ; de même la maîtrise par Clément, le père adoptif, de la langue sarrasine lui permet non seulement de traverser le camp ennemi pour en ramener le cheval extraordinaire du sultan mais aussi de convertir sa fille, effort de vraisemblance accru et accent mis sur l’importance de la vraie religion. Des erreurs sont évidentes ; certains mots ont été mal lus, dont le plus remarquable est le terme qui désigne l’amant supposé de l’impératrice ou encore l’auteur oublie que le chevalier qui avait sauvé Florent lors de son enlèvement par le singe est mort26. L’affadissement le plus gênant est de montrer Florent marchander le prix du poulain qu’il convoite, en soutenant que c’est là un mauvais achat27 alors que, dans le Roman d’Othevien, l’acquisition au-delà du prix demandé est un indice supplémentaire de la noblesse innée de Florent28.
Les ajouts relèvent en revanche de très probables emprunts à différentes sources connues du scribe, très répandues alors et dont certaines – nous le verrons – ont pu être influencées par le Roman d’Othevien. Ainsi est ajouté un rêve de l’impératrice, avant sa disgrâce, qui se voit attaquée par des léopards et des lions29. Le fait que la lionne ne saurait s’en prendre à quelqu’un de sang royal est absent du Roman d’Othevien mais s’observe dans Beves of Hamtoun où la fille du roi Ermin, Josian, n’est pas blessée par un couple de lions rencontrés dans une grotte parce qu’elle était à la fois princesse royale et vierge :
Josian into ƥcave yan shete
And ƥe twoo lyouns at hur feete,
Grennand on hur with much graune,
But ƥey ne myƺst do hur no shaune,
For ƥe kind of lyouns, y-voys,
A kynges douƺter, ƥat maide is
Kinges douƺter, quene and maide both
ƥe lyouns myƺt do her noo wroth30.
Pour la même raison Torrent est épargné aux vers 283-28431 ; ce motif est devenu tellement proverbial qu’il sera tourné en dérision par Shakespeare quand Falstaff déclara que le lion – lui-même – ne touchera pas un prince royal, en l’occurrence Hal, le futur Henry V32.
Par contamination, il est possible que l’impératrice qui n’a pas de nom dans le Roman d’Othevien devienne Florence sous l’influence de l’héroïne éponyme – la Bone florence de Rome – plutôt qu’à cause de son fils. Le pape s’appelle par confusion Clément.
Octavian est probablement le roman par lequel les thèmes et les motifs ont pu se retrouver en outre dans d’autres romans moyen anglais comme Sir Isumbras, Sir Tryamour33, Sir Eglamour ou Sir Torrent de Portyngale. Nous examinerons brièvement les motifs plus largement répandus et que le Roman d’Othevien et, par lui, les versions d’Octavian reprennent avec souvent des variantes.
En effet nous retrouvons des variantes des thèmes d’Eustache, de Constance, de Florence et de Griselda. L’enlèvement des enfants provient du thème de Placidas qui, converti et baptisé avec sa famille, devient Eustache. C’est un réinvestissement très large de l’histoire de Job. Entre autres malheurs, les deux enfants de Placidas vont être ravis, l’un par un lion et l’autre par un léopard ; la famille ne sera réunie que pour être mise à mort par le feu, à Rome, pour avoir sacrifié aux dieux païens. Dans Sir Isumbras, qui date d’avant 1320, le héros s’est vu laissé le choix par un ange envoyé par Dieu de souffrir dans sa jeunesse ou dans son vieil âge, parce qu’il avait oublié qu’il devait tout à Dieu. C’est une version sécularisée de la légende de saint Eustache avec donc les mêmes personnages. Quand les péchés d’Isumbras auront été pardonnés, au bout de 14 ans, des animaux fabuleux, montés par des chevaliers, l’aideront à tuer les païens et à se révéler à ses fils comme leur père.
Les enfants enlevés sont toujours de sexe masculin et le plus souvent des jumeaux. Cependant, dans Sir Eglamour, ca. 1350, il n’y a qu’un fils, Degrebelle, conçu en secret pendant que le héros devait accomplir toute une série d’épreuves dont la difficulté était croissante et dont l’objectif était bien sûr de le voir mourir. La licorne du roman précédent est ici remplacée par un griffon qui se saisit de l’enfant alors qu’il est condamné avec sa mère à un trépas certain, dérivant sur les flots. Il le sauve et le conduit en Israël où le roi l’adopte comme son fils et son héritier. Le griffon, présent dans le Roman d’Othevien, réapparaît dans Sir Torrent de Portyngale où il enlève l’enfant pendant que le héros combat au loin. La bête devient le fidèle compagnon de celui-ci et lui donne même son nom : Antony Fice Greffoun. Ce texte dérive directement de Sir Isumbras. Dans Octavian, le griffon enlève Octavian mais il est tué par la lionne qui, après s’en être saisie, le dévore et peut ainsi nourrir l’enfant34. Dans la version septentrionale, la lionne combat pour son maître ; dans celles du sud, elle tue deux marins qui venaient faire provision d’eau sur l’île où elle avait été déposée et, dans une scène qui ne se veut pas parodique, elle joue ensuite avec Octavian près des restes humains, ce qui déclenche la reconnaissance de la mère restée sur le bateau ! Lorsque l’impératrice débarque, toutefois l’auteur nous indique que Dieu et la Vierge sont intervenus pour que la lionne prenne conscience de sa royauté. C’est bien sûr une reprise du lion reconnaissant de saint Jérôme, la lionne ici accompagne mère et fils en Terre sainte, y devient un membre à part entière de la maisonnée, un animal parfaitement domestique.
Ses qualités ne font que se développer et elle acquiert finalement celles d’un chevalier de roman – la noblesse, la fidélité, le courage – celles d’Octavian lui-même, manifestées dans la bataille finale contre les Sarrasins à ses côtés35. Une autre lionne fidèle apparaît aussi dans la ballade Sir Aldingar36. La fidélité de la lionne rappelle celle du chien qui sait manifester sa sauvagerie à bon escient dans Sir Tryamour où la reine Margaret est envoyée en exil par son époux, Ardus, suite aux calomnies de l’intendant Marrok qu’elle a repoussé alors qu’il tentait de la séduire. Le chien de Sir Roger qui l’a recueillie avec son fils, Truelove, les accompagne ; c’est lui qui ensevelit son maître tué par traîtrise lors d’une embuscade par Marrok ; il veille sur la tombe de son maître durant 7 ou 15 ans37, jusqu’au jour où il va tuer devant la cour d’Ardus le félon, révélant ainsi sa traîtrise et au roi son aveuglement. Le léopard de la légende d’Eustache, repris dans Sir Isumbras, est la seconde bête ravisseuse dans Sir Torrent de Portyngale où les jumeaux enfantés par Desonelle sont l’un ravi par un griffon – et sauvé par Saint Antoine – et le second sauvé par le roi de Jérusalem. Dans la version méridionale d’Octavian une guenon fait pendant à la lionne.
Ainsi que Marie-Madeleine Castellani nous l’a rappelé dans sa communication38, le singe, ou la guenon donc, symbolise l’absurdité et l’arrogance en voulant imiter le comportement rationnel d’hommes et de femmes. Dans le cas de Florent, enlevé par cet animal, ce dernier préfigure son environnement humble, le milieu bourgeois et annonce le comique de certaines scènes : la noblesse de Florent sera constatée d’abord grâce aux animaux, le faucon ou l’épervier qui l’attire alors qu’il est censé faire son apprentissage de boucher avec deux bœufs qu’il cède en définitive pour l’obtenir, et le jeune destrier qu’il paye plus cher en manifestant une autre qualité représentative de la noblesse, la largesse. Là où Clément s’arrête à des considérations financières triviales et bat Florent pour avoir dilapidé les ressources financières familiales, son épouse Glawyn39 comprend qu’il n’est pas le fils de son mari lors de la seconde transaction et l’empêche alors de le battre de nouveau.
Le thème de Constance est présent dans plus de vingt versions littéraires : il désigne une reine calomniée ou persécutée. Il est récurrent dans ces différents romans. Dans le Roman d’Othevien, c’est la belle-mère de l’impératrice qui insiste sur le fait qu’elle n’a pu enfanter des jumeaux sans avoir été adultère et son fils la croit, commuant simplement la sentence du bûcher en exil immédiat et définitif. Dans les versions septentrionales d’Octavian, le père de l’impératrice est d’avis de la brûler tout de suite. La mère de l’empereur se suicide à la fin, dans l’indifférence générale, en se tranchant la gorge. Dans l’autre version, le sort promis à l’impératrice est celui de la belle-mère qui est brûlée sur un bûcher à l’extrême fin du roman alors que dans le Roman d’Othevien, elle est simplement morte avant le retour de la famille réunie. La belle-mère jalouse provient sans doute du cycle des Enfants du Cygne, représenté par le lai breton Emaré40 où, comme dans Sir Eglamour d’Artois, Emaré est condamnée à mourir sur les flots pour avoir repoussé les avances de son propre père. Recueillie à Galys, devenue Egaré – soit ‘celle qui est hors-la-loi’, le roi la remarque et l’épouse au grand déplaisir de sa mère. Pendant qu’il va combattre les Sarrasins, en son absence son épouse met au monde un fils, Segramour, dont la reine mère lui fait croire que c’est un démon en interceptant la lettre lui annonçant la nouvelle. La réponse du roi est également subtilisée et Emaré est rejetée à la mer avec son enfant. Dans les Enfants du Cygne41, la belle-mère allait plus loin encore en substituant des animaux aux enfants.
L’accusation d’infidélité est une constante aggravée le plus souvent par la médiocre condition sociale de l’amant supposé : un lépreux, un nain, un boiteux, un cuisinier ; il n’y a que dans Erle of Tolous qu’il s’agit d’un jeune chevalier. La mort du jeune homme introduit dans le lit de la reine par la belle-mère provient de la légende d’Alboinus, premier roi des Lombards.
Les thèmes de Griselda et de Florence recoupent ces caractéristiques en dépeignant la patience et les vertus morales d’une jeune femme calomniée à tort42 envoyée dans un bois et qui passe de longues années exilée. William de Malmesbury43 rapporte l’histoire de Gunnhilde, sœur du roi Hardicanute, qui règne de 1040 à 1042, d’une beauté stupéfiante, épouse de l’empereur Henri d’Allemagne, qui fut accusée d’adultère, lavée de cette calomnie par un champion, gardien de son oiseau domestique, un sansonnet apprivoisé, et qui choisit d’entrer dans les ordres plutôt que de partager de nouveau son lit avec Henri, l’époux soupçonneux. Matthew Paris44 est encore plus précis dans les détails des difficultés éprouvées par l’impératrice à trouver quelqu’un susceptible de défendre son honneur.
Au terme de ce rapide parcours plusieurs conclusions s’imposent. Si indéniablement la geste d’Othevien s’est développée dans le domaine français et commence à être de mieux en mieux connue, dans la littérature anglaise, elle a à la fois réinvesti un certain nombre de thèmes bien attestés pour en procurer des variantes parfois originales mais elle a surtout influencé directement des romans qui ont connu à leur tour une grande renommée. Une fois encore, les aléas des transcriptions et la survie difficile des textes en des temps troublés – avant la Réforme, le xve siècle a connu nombre d’épisodes de guerre civile, notamment entre les partisans d’Henry VI et ceux d’Edouard IV – ne peuvent permettre de se faire une idée totalement fiable de leur notoriété réelle. Il faut saluer à cet égard le remarquable travail d’édition, pour les textes en moyen anglais, de l’Université de Kalamazoo qui permet désormais d’avoir accès à des textes non seulement sûrs mais replacés dans leur contexte particulier. Les conditions de transmission, la réception dans la seconde moitié du xive et durant le xve siècle n’a pas permis de mise en prose comme dans le domaine français – ce sera le cas dans d’autres langues – mais, malgré un resserrement de la narration, des intrigues, des épisodes, nous avons pu pointer un certain nombre de variantes significatives dans les réécritures qui montrent une volonté d’appropriation de matériaux par les scribes anglais.
La dimension comique de personnages comme Clément ou d’épisodes remarqués tel celui de l’armement de Florent figurent – nous le voyons dans le présent volume – au nombre des développements originaux. Les différents thèmes envisagés, principalement Eustache et Constance, ne sont ainsi ni un carcan ni un frein à la création mais ont permis des réflexions en miroir de la société du temps, de ses préoccupations religieuses et sociales. Il n’est pas anodin que ces types aient été établis d’ailleurs à partir de contes de Chaucer qui mentionne Octavian dans Le Livre de la duchesse. L’Université de Lille peut se réjouir d’avoir su réunir les différents maillons qui conduisent à mieux connaître une véritable geste laissée largement dans l’ombre jusqu’ici.