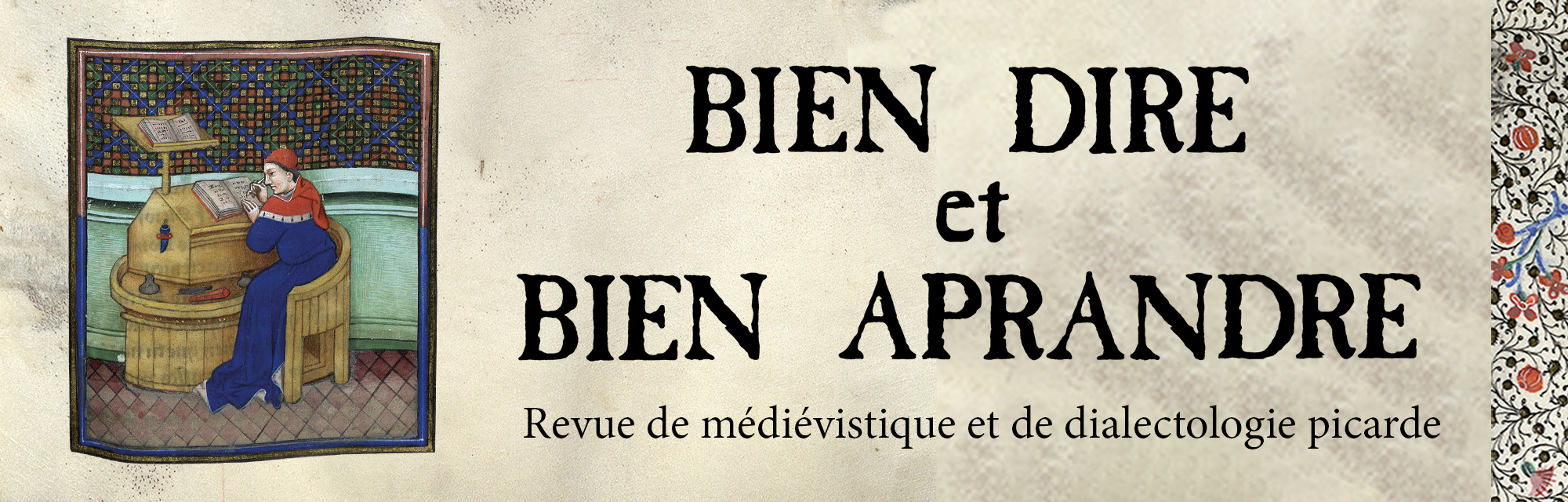Parmi les trois sens considérés comme mineurs depuis l’Antiquité, seul l’odorat semble avoir retenu l’intérêt des prosateurs du xve siècle. Nous pourrons en juger en dressant l’inventaire des diverses notations sensorielles qui rythment les romans de chevalerie issus de la cour de Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon. Le témoin de prédilection de cette étude sera Le livre des haulx fais et vaillances de l’empereur Othovyen et de ses deux filz et de cheulx quy d’eulx descendirent1, une prose inédite de grande ampleur qui sera confrontée à d’autres romans du xve siècle circulant à la cour de Bourgogne à cette époque (l’Histoire des Seigneurs de Gavre, Paris et Vienne, Apollonius de Tyr, l’Alexandre en prose de Wauquelin), au nombre desquels on compte plus spécifiquement plusieurs mises en prose2 réalisées à l’initiative de deux seigneurs bibliophiles, Jean de Wavrin3 et Jean de Créquy4 (l’Histoire de Gérard de Nevers, le Roman de Florimont en prose, Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amours, Gilles de Chin)5.
***
L’exploration du corpus romanesque bourguignon du xve siècle révèle sans guère de surprise la place dominante réservée aux sens de la vue et de l’ouïe, sollicités en particulier dans la description des scènes de bataille6 ; les récits des combats mobilisent en effet souvent des adresses conventionnelles – du type La euissiez vous veu, La euissyés peu oÿr – qui amplifient la tonalité épique et la cruauté des combats par le recours à la figure macrostructurale de l’hypotypose. En témoigne cet exemple particulièrement significatif tiré d’Othovyen :
La euissyés peu oÿr mainte trompette bondyr et sonner et de l’autre partye, payens et Sarazins demenoyent grant bruit de timbbres, de tambours et de leurs corps d’olyfant que toute la contree en retentyssoit, et estoient desja tout prest, rengiés et serrés pour combatre, et venoient urlant et glatissant que hydes estoit de oÿr le bruit qu’ilz demenoient7.
Par contraste, deux des trois sens « interdits », le goût et le toucher, occupent une place pour le moins discrète et sont très nettement sous-exploités. Les proses bourguignonnes ont ainsi en commun de se désintéresser du sens du goût. À titre d’exemple, on ne relève dans les 278 chapitres d’Othovyen que trois maigres occurrences du verbe gouster, utilisé comme équivalent de mangier (avec lequel il entre en doublet synonymique) pour qualifier l’alimentation des bêtes comme celle des humains :
et trouverent une cage en laquelle ilz misrent leur esprevier, sy apporterent du pain esmyet aveuc du let, mais oncques l’oisel n’en volt mengier ne gouster […] puis prinrent leur oisel et le misrent hors de la cage et lui donnerent du pain et du lait, mais oncques n’en volt gouster8.
mais tant advint que en celle forest trouvasmez ung tressaint ermitte, lequel nous donna de son pain d’orge et des pommes sauvagez, mais oncques la noble pucelle n’en volt gouster ne mengier, ains plouroit tousjours9.
Seul le Livre des amours du Chastellain de Coucy et de la Dame de Fayel comporte des notations gustatives fines et précises. À l’issue de cette mise en prose, dans le célèbre épisode conclusif qui reprend la légende du cœur mangé10, l’auteur décrit avec force ironie le plaisir que prend la Dame du Fayel à manger le cœur de son ami, préparé avec soin par le cuisinier de son époux :
dedens l’escuielle de la dame le cuer de son amy estoit dehachié tant menuement et sy bien asavouré de chucre et de sinamomme que jamais la dame, a son semblant ne a son goust, elle n’avoit mengié milleure viande. La dame moult volentiers et en grant apetit menga celle viande, et dist que oncques en sa vye ne menga de milleur mes ne plus savoureux11.
Pour ce qui concerne le sens du toucher, la moisson n’est guère plus abondante. Dans Othovyen, le verbe taster est employé en contexte épique au sens de ‘toucher, frapper qq’un’ ; c’est ainsi qu’après un beau coup asséné à son adversaire sarrasin, le jeune Florent s’exclame, dans une pointe verbale proche des gabs épiques : Payen, [...] je cuide que je vous ay tasté12 ! Ailleurs, le verbe taster peut prendre également le sens de ‘toucher, tâter une partie du corps’, comme lorsque le traître Conrart reçoit d’Othovyen Fils un terrible coup qui lui emporte la moitié du visage :
sy descendy le cop tout au lonc du visage de Conrart tellement que le néés et les levres et une partye de l’une des joes abaty tout jus par tele maniere que tout a plain les dens de Conrart furent descouvert. […] Conrars recula et leva la main et tasta vers son visage qu’il senty tout deffiguré. Alors Octovyen luy dist : « Conrart, ja n’est besoing que plus tu y mette[s] la main, car tu [ne] le saroyes tant escourre que une aultre foys tu le feisses cheoir. Ja poes tu voir ton néz et tes levres quy gisent par terre ; pour tant, n’y tastes plus13 ! »
Enfin, taster est utilisé dans notre corpus dans le sens spécialisé de ‘toucher, palper qq’un à des fins d’investigation médicale’ ; c’est le cas par exemple dans Apollonius de Tyr, où, à deux reprises, la jeune Tharsie fait l’objet d’examens médicaux :
Lors la tasta et mania par grant subtiveté et s’esbahy, car, en tastant les vaines, les oreilles, le nez et en mettant sa main au devant de la bouche, il sentoit qu’elle allenoit et avoit esperit qui estoit moult foible et perchut que la vie estrivoit a la mort14.
Quant le roy vey qu’elle estoit ainsi encheue en maladie soubdainement, il fut curieux de la faire visiter par phisiciens, et ilz lui tasterent le poulz et encerch[er]ent par tout son corps, mais point ne trouverent signe de maladie15.
Si le goût et le toucher sont délaissés dans les proses bourguignonnes du xve siècle, le sens de l’odorat est quant à lui mieux représenté. Nous verrons ainsi comment le discours témoigne dans ce corpus de la sensation olfactive et quelle fonction il lui assigne. Il s’agira donc d’expérimenter, à travers les proses bourguignonnes de la fin du Moyen Âge, une aventure sensorielle autour du sens de l’odorat. Cette chasse aux odeurs prendra la forme d’un parcours olfactif – semblable à ceux qui existent à l’heure actuelle dans les jardins recréés dans les cours des châteaux du Moyen Âge, dans les maisons ou les musées de parfum, ou encore autour du vin – entre délicates effluves et miasmes nauséabonds.
Bonnes odeurs et douces exhalaisons
L’odeur agréable trouve son expression privilégiée en moyen français à travers le verbe flairer, souvent complété des adverbes bon ou souef. Dans les textes étudiés, flairer renvoie exclusivement aux senteurs florales délicates. Le terme permet entre autres de rendre compte dans une formule topique de la comparaison entre la jeunesse d’une amante et la fraîcheur d’une rose épanouie16. C’est ainsi que le prosateur de Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours reprend de sa source17 l’épisode printanier lors duquel le jeune amant est frappé par une rose magnifique qui lui rappelle sa bien-aimée dont il déplore l’absence : il vey ung rosier chargié de belles roses, qui moult estoient souef flairans, dont une en y avoit qui toutes les aultres passoit de beaulté18.
La mention éculée de l’exhalaison douce et agréable des fleurs trouve toutefois une expression singulière dans la production romanesque du xve siècle à travers la description des festivités solennelles qui accompagnent les entrées triomphales des héros combattants. Ainsi, le retour à Rome d’Esmerés est illustré dans la partie finale du cycle d’Othovyen par une célébration éclatante au cours de laquelle la population romaine rend honneur à son chef victorieux :
Quant l’empereur entra dedans Romme, le Pere Saint et tout le colege du saint siege appostolicque luy vint au devant, et aulx fenestres des palaix et des maisons estoient dames, demoiselles, bourgoys et bourgoisses qui sur l’empereur jettoient fleurs et foelles et erbes souef flairans. Toutes les rues furent encourtinees et jonchies de vert erbe jusques au palaix. La joye qui dedens Romme fu demenee a cely jour n’est nulz qui raconter le vous seusist. Et avec ce, tous les instrumens melodieulx qui pour lors estoient a Romme furent sonné devant l’empereur19.
L’accueil des hauts dignitaires ecclésiastiques, la présence des femmes aux fenêtres, les maisons recouvertes de tapisseries, les rues jonchées d’herbe et de fleurs parfumées ainsi que la musique concourent à l’établissement d’un cérémonial imposant qui fait baigner la scène dans une atmosphère de joie et de fête.
On retrouve dans le manuscrit de Paris et Vienne ayant appartenu à Jean de Wavrin20 une formule identique lors du retour triomphal de Paris à Vienne : Là veissiez tendu maint riche drap batu à or et soye ouvrés par grant maistrie, et partout jonchie de herbes souef flairans21. Le motif est par ailleurs décliné dans deux autres proses bourguignonnes, l’Histoire des Seigneurs de Gavre, et le Florimont en prose22 :
D’aultre part aux fenestres estoyent dames, damoiselles, bourgoises et pucelles : les unes chantoyent, les aultres jettoyent yawe de roses et de fleurs d’oranges sur les testes des barons, que grant odeur estoit a les sentir23.
les dames et les pucelles quy aux fenestres estoyent, chantoyent de pluiseurs melodieuses chansons, les unes espanchoient yawes damasquynes, moult souef flairans, les aultres jettoient fleurs de diverses couleurs desus le roy et les barons quy avoec luy estoient24.
On note une légère variation dans ces deux derniers exemples, puisqu’il ne s’agit plus pour la population de joncher les rues de verdure ou de lancer des fleurs odoriférantes sur le guerrier victorieux, mais bien de disperser des essences obtenues par distillation de fleurs d’oranger ou de pétales de roses25 afin de répandre une fragrance délicate.
L’odorat joue donc un rôle important pour figurer l’accession au trône des héros de romans dans le cadre de tableaux vivants qui recréent dans la fiction l’atmosphère festive des joyeuses entrées princières26.
Toutefois, si l’on excepte ces évocations des fleurs odoriférantes jetées sur les héros lors des festivités des entrées triomphales, on constate que l’expression des senteurs agréables ou des parfums est assez rare dans les romans du xve siècle. Seule l’histoire de Gilles de Chin en prose évoque explicitement une odeur suave et paradisiaque lors de l’épisode édifiant au cours duquel le chevalier hennuyer est appelé de nuit par un ange à se croiser et à se rendre en Terre sainte :
Puis tantost apprés que messire Gilles eult fait son oroison, ceste clarté s’esvanuy, mais la dedens demoura une odeur tant souef et delitable a sentir, qu’il sembla a messire Gilles qu’il fust ravis es chieux. Sy demoura ainsy une heure a genoux, priant Nostre Seigneur devottement que ses pechiés lui volsist pardonner27.
Dans cet extrait, la trace parfumée laissée par l’ange est le signe d’une présence divine qui préfigure les délices paradisiaques.
Cette notation olfactive n’en demeure pas moins exceptionnelle puisque l’on relève principalement dans les proses bourguignonnes la notation d’odeurs nauséabondes qui servent à façonner – à travers une lecture sensorielle manichéenne – des monstres diaboliques (serpents, dragons, griffons) tout droit sortis du gouffre infernal.
Mauvaises odeurs et émanations pestilentielles
Dans son roman d’Alexandre, le bourguignon Wauquelin représente à plusieurs reprises le héros conquérant en proie à des créatures de l’Autre Monde. Alors qu’Alexandre pénètre dans la Vallée Périlleuse, la terre se met à trembler au point que le Macédonien croit à plusieurs reprises qu’elle finira par l’engloutir. Apeuré, Alexandre passe la nuit en prières : il lui fut advis que la terre se prist a ardoir ; et de ceste ardeur yssoit une pueur tant horrible qu’il n’estoit homme qui la peust sentir sans une mortelle plaie endurer28. Projeté en l’air et maintes fois renversé, Alexandre assiste effrayé à une treshideuse bataille de malins esperis29. Au lever du jour, l’agitation disparaît et avec elle les odeurs nauséabondes : Aprés laquelle terrible orreur ne demoura gaires que le jour vint et que le soleil commença a rayer, auquel rayement de soleil toutes les pestillences devant dictes se cesserent30. Alexandre prend alors la fuite et une fois entré dans une sorte de grotte se voit appelé par ung maling esperit enclos dans la roche31 : ladicte voix lui enseigna par ou il wideroit de ladicte place, par condicion que le roy ot couvent qu’il le deffermeroit de la pierre ou il estoit. Si le fist ainsi le roy, mais il n’en sailli autre chose fors une trespuant flaireur si grant et orrible que le roy cuida crever32. Dans cet épisode, la puanteur inhérente aux êtres démoniaques33 est révélatrice du rôle messianique joué par le héros macédonien, chargé de libérer les hommes des créatures immondes, sales et impures.
Un exemple similaire se trouve dans Le roman de messire Charles de Hongrie ; le héros éponyme est appelé au cours de ses aventures à dépasser sa quête individuelle pour réaliser une mission collective, à l’image du Lancelot de Chrétien de Troyes. Charles de Hongrie se retrouve ainsi confronté à la merveille lorsqu’il doit déchiffrer sur un arbre une inscription prophétique qui invite le meilleur des chevaliers à relever une terrible épreuve consistant à libérer des captifs enfermés au sein d’une tour. Charles de Hongrie, qui prend conscience qu’il est le libérateur espéré et qu’il doit accomplir les écritures, décide alors de se rendre vers la tour gardée par un géant. Il est d’abord accueilli par un nain avant d’être attaqué par le géant qu’il tue. Le nain lui demande alors s’il est prêt à achever l’adventure de leans et l’emmène en la chambre ou la farye estoit :
Et Charles s’en vint tout droit a l’uys de la chambre et l’ouvre ; et quant il fut ouvert, il s’en yssit une telle fumee et si espesse que a paine que Charles n’en veoit goute. Touteffoiz il passe avant et voit ou meilleu de la chambre ung grant griffon qui venoit devers luy, la goulle bee, et gictoit feu et souffre par la goulle, si puant et si horrible que merveilles estoit ; il avoit les gris touz tenduz pour l’estrangler34.
Plusieurs héros de romans bourguignons du xve siècle jouent ainsi comme Alexandre ou Charles de Hongrie le rôle de miles Christi au cours de combats allégoriques opposant le Bien et le Mal qui marquent l’« anéantissement de la sauvagerie primitive par un héros civilisateur35 ». Le duel contre un être surnaturel est en effet un motif fréquent dans la production romanesque bourguignonne ; on le retrouve par exemple dans Jean d’Avennes36, Gilles de Chin37 ou encore Gérard de Nevers, mais seule cette dernière mise en prose mentionne la puanteur de la créature diabolique : Le serpent, geulle bee, vint vers luy, jettant une flambe moult orrible et puant38. La puanteur du dragon figure ainsi dans cet exemple une image du chaos et du désordre que doit affronter le héros, avatar romanesque de saint George, en quête d’épreuves initiatiques et probatoires.
En dehors des exemples précédemment relevés, qui ont trait à la merveille d’interprétation chrétienne, les mauvaises odeurs qui relèvent de realia ne sont que très rarement évoquées dans les romans du xve siècle. L’auteur de la biographie romancée de Bouciquaut relate par exemple comment, lors de l’attaque de la ville de Pise, les Français projettent sur leurs adversaires excréments, souillures pestilentielles et autres éléments putrides afin d’infecter la ville assiégée : chacun jour, a force d’engins, gettoient en la forteresse plus de cent quaques plain des ordures des chambres de la ville, de poisons, de charongnes pourries et de toutes punaisies39. Le terme punaisie qui ponctue cet extrait qualifie dans ce texte l’ordure – ce qui au sens étymologique est ord (‘d’une saleté repoussante, immonde’) – et plus spécifiquement l’ordure organique (les souillures des repas, les immondices en voie de putréfaction, les excréments), figurée ici par une odeur répugnante qui provoque le dégoût. De même, dans Othovyen, lorsque l’empereur de Rome et son fils sont capturés en mer, le remanieur figure la saleté repoussante de la sentine du navire (c’est-à-dire la ‘partie la plus basse’) : Et droit a l’eure que on se combatoit, l’empereur et Flourent estoient ou fons de la nef en soulte emprés la puante sentine40. L’épithète puante est ici censée traduire un sol souillé d’eau croupie et sali de déjections humaines, mais il pourrait tout aussi bien renvoyer par métonymie aux propriétaires sarrasins de la nef. En effet, dans les romans du xve siècle, l’adjectif puant est employé fréquemment dans sa dimension abstraite afin de désigner des êtres abjects – au sens premier du terme, c’est-à-dire ‘rejetés’. Il qualifie alors des personnes qui inspirent le mépris et le dégoût par leur bassesse ; insistant sur le rejet moral et l’exclusion, l’adjectif est utilisé comme terme d’injure au sens de ‘vil’, ‘indigne d’estime’, ‘méprisable’, ‘infâme’ et il se réfère plus spécifiquement aux musulmans41. Issu du même paradigme sémantique, l’adjectif punais, proche en moyen français de ord(e) et put(e), désigne de même une ‘personne digne de mépris’, et plus spécifiquement une ‘femme de mauvaise vie’42. C’est précisément en ces termes que l’auteur de Gérard de Nevers qualifie Gondrée, la vielle servante – issue en droite ligne de la lena de la littérature latine – qui trahit injustement sa jeune maîtresse Euryant43.
Par extension péjorative, la puanteur prend donc une orientation morale afin de figurer l’abjection – à savoir l’état de ce qui est rejeté comme bas, vil, impur moralement – qui trouve alors son expression privilégiée dans les textes de notre corpus dans l’image de la charogne. Ainsi, dans le Jourdain de Blaye en alexandrins, la conversion spectaculaire du roi sarrasin Sadoine, frappé par la lumière divine du dieu des Chrétiens, est marquée par le violent rejet du prophète dont l’odeur paraît insoutenable à son ancien fidèle : Plus li put Mahommet que carongne pourie44. De même, est évoquée à deux reprises dans Jehan d’Avennes l’odeur fétide de combattants ennemis dont le corps est réduit à l’état de cadavre en décomposition ; le narrateur use ainsi de l’image de la charogne pour décrire successivement le cadavre de l’empereur d’Allemagne venu assiéger le roi de France (sa charongne corruptible puet estre desciree entre lez abbais dez loux familleux ausquelz, s’ilz voeullent, il est donné en vyande45) et les dépouilles de ses soldats (Puis [les hommes du seigneur de Rochefort] se prinrent a retourner, menans joyeuse vie, en laissant illuec les charongnez de plus de .iii. c. de leurs ennemis mortelz et tournans en vyande aux vers de terre46). Ce dernier exemple figure d’ailleurs parfaitement la notion d’abjection dans son sens propre : l’ennemi méprisable est rejeté au sol et voisine désormais avec les vers qui le dévorent. Les termes très crus utilisés par l’auteur soulignent donc moins la cruauté des champs de bataille que l’altérité radicale des adversaires vaincus, leur rejet et leur exclusion.
L’abjection peut aussi prendre une orientation sociale et politique et son sens passe alors de ‘l’état de ce qui est rejeté’ à ‘l’action de rejeter’. L’être puant et abject peut ainsi représenter dans notre corpus un homme ignoble, c’est-à-dire, d’après le latin ignobilis, ‘de basse naissance’, ‘de basse condition’. Le prosateur de Blancandin profère par exemple une charge pleine de morgue à l’encontre d’un personnage de traître, Subien, un vilain qui par son orgueil s’est hissé dans les plus hautes sphères du pouvoir :
Moult bel chevalier estoit, mais de bas estat estoit venu, car filz avoit esté d’un serf et d’une servante de leans […] Mais on dit en ung commun langaige que oncques bruhier ne couva esprevier. Je le dis pour le chevalier dont icy fay mencion, lequel ot nom Subien, car tant estoit haultain et orgilleux que advis lui estoit que pour la grant auctorité qu’il avoit que nul ne se deust comparer a lui. Et pour ce je dis que de vilain ne de vilaine ne peult partir bon fruit […] car on dit que de vilain ne peult saillir que poison et ordure, qui embau[f]ume le lieu ou il repaire, comme fist celui Subien47.
Embaufumer est un verbe rare, d’origine normande, formé probablement par l’association des deux verbes embaumer et fumer, qui signifie ici par antiphrase ‘empester’48. L’orgueil du vilain qui cherche à quitter son statut social lui vaut paradoxalement d’être réduit par le mépris à un niveau d’infériorité et de soumission : par l’entremise de trois formules proverbiales en cadence majeure, le prosateur bourguignon réduit cruellement le vilain à un être vicieux qui corrompt l’atmosphère dans laquelle il évolue. L’abjection sociale que traduit ici la mauvaise odeur est utilisée à des fins politiques par l’élite nobiliaire dans une apologie de la noblesse et dans une stigmatisation du vilain – l’être vil par essence – dont les nobles de la cour de Bourgogne ne veulent pas et qu’ils repoussent de façon humiliante49.
Comme on a pu le voir précédemment avec l’image de la charogne, la puanteur a surtout un lien étroit dans les romans du xve siècle avec le corps50, et plus spécifiquement avec l’infirmité et la maladie. L’abjection morale cède alors souvent la place à l’abjection dégoûtante, et l’odeur affreuse – en complément de la laideur – devient l’expression privilégiée de la maladie et de la décomposition du corps. Tel est le cas en particulier à l’issue de l’Histoire d’Olivier de Castille : après avoir accompli des exploits en Grande Bretagne et après s’être vu remettre par le roi le royaume d’Irlande, Artus d’Algarbe se trouve en proie à une subite maladie, terrible et spectaculaire, qui lui dévore le visage :
Car le bel et bon Artus fu tant griefment malade que les maistres le jugerent mort, mays il ne fut pas sy eureux que de morir toutte les foys qu’il eust bien eu vouloir de morir de sa maladie, car elle fu la non pareille a toutes celles qui oncques furent car une maniere de vers lui descendoient du cerveau qu’il lui mengoient tout le visaige, pour quoy il estoit sy deffiguré qu’oncquez homme ne fut plus ; de son corpz yssoit la grant puanteur que nul ne le pouoit approchier fors Olivier51.
La puanteur qui se dégage du corps en décomposition d’Artus traduit une mise à l’épreuve des héros dans leur compagnonnage épique. Personnage rendu abject par la maladie et frappé d’une maladie humiliante qui le coupe de son statut de beau jeune homme, Artus est repoussé de tous. La puanteur de la maladie est ainsi implicitement rapprochée de l’abjection du Christ, objet de rebut. C’est la négation exceptive, exprimée par deux adverbes en relation discontinue ne… fors, qui sert ici à figurer d’une part le rejet collectif face au dernier degré de dégradation corporelle, et d’autre part une restriction qui met en lumière la loyauté du fidèle ami, Olivier. La guérison d’Artus ne sera rendue possible que parce qu’Olivier, qui a entendu de nuit une voix le lui conseiller, accepte de tuer ses propres enfants ; il prélève ainsi le sang de deux chrétiens innocents afin de le faire boire à son ami qui recouvre la santé et la vue.
Dans un autre roman contemporain, Paris et Vienne, l’abjection subie se mue en abjection volontaire et prend une orientation religieuse. Dans un épisode très célèbre, l’héroïne Vienne, qui a été jetée en prison par son père parce qu’elle refusait d’épouser un autre homme que son bien-aimé Paris, use d’un habile stratagème pour repousser ses prétendants : elle place des quartiers de poule sous ses aisselles que la chaleur fait pourrir. Vienne tombe dans l’abjection au sens chrétien du terme et s’enfonce dans une humiliation consentie devant Dieu, dans un avilissement volontaire et un mépris de soi afin de préserver sa chasteté :
Mais Vienne pensoit bien autre part, car elle prist la geline et fist semblant de la gecter hors de la prison, mais elle la muça en ung anglet. Aprés, quant elles eurent assez parlé, Vienne dit qu’elle se vouloit mettre en oroison. Sy s’en vint là où elle avoit mis la geline52. Sy la prist et la fendy en deux moittiees et en mist dessoubz chascune aisselle une moittié. Et là la tint bien estroittement tout le jour et toute la nuit que Ysabeau n’en savoit rien. Les jours estoient longs et chaulx ainsi comme à la Saint Jehan, sy que à l’endemain au matin la geline qui dessoubz ses aisselles estoit fut si puante que à paine puet endurer la grant puandeur dont elle sentoit53.
La mauvaise odeur qui émane du corps de Vienne traduit ici un interdit d’ordre sexuel.
Le subterfuge habile de Vienne constitue la réécriture romanesque d’un épisode relaté au viiie siècle par Paul Diacre dans son Histoire des Lombards, qui met en exergue la conduite exemplaire des filles de Romilda, souveraine des Lombards, lors du siège de Cividale par les Avars :
« [...] Ses filles, toutefois, ne suivirent pas leur mère dans sa débauche : portant un amour attentif à leur chasteté, pour ne pas subir l’infection des barbares, elles se mirent entre les seins, sous le décolleté, de la viande de poulet crue qui dégageait une odeur putride en se décomposant sous l’effet de la chaleur. Quand les Avars voulaient les toucher, ils ne supportaient pas la puanteur ; pensant qu’elles sentaient naturellement mauvais, ils s’en écartaient avec dégoût en racontant que toutes les Lombardes puaient. Grâce à cette astuce, les nobles jeunes filles échappèrent donc au viol des Avars ; gardant intacte leur chasteté, elles servirent utilement d’exemple de virginité sauvegardée pour les femmes qui connaîtraient le même sort54. »
Cet exemplum a été repris tout au long du Moyen Âge et il a en particulier été proposé comme modèle de chasteté féminine dans l’éducation des princesses. On le retrouve ainsi, pour le Moyen Âge tardif, dans la traduction par Jean Ferron du Jeu des échecs moralisé de Jacques de Cessoles55, dont s’inspire plus tard Le mesnagier de Paris56 :
Et ses .II. seurs tuerent poucins et les mistrent soubz leur mammelles, si que de la chaleur des mammelles la char des poucins puoit. Si avint que les Hongres qui les vouldrent forcier sentirent la punaisie et s’en fuirent tantost et les laisserent et disoient : « Fi, que ces Lombardes puent !57 »
[…] Et les filles, qui ne sceurent fouyr, doubterent estre violees des Hongres ; si tuerent pigons et les mucerent dessoubs leurs mamelles, et par l’eschauffement de leurs mamelles la char des pigons puoit. Et quant les Hongres les vouloient approuchier si sentirent la puantise et s’en refroidirent et les laisserent tantost ; et disoient l’un a l’autre : « Fy ! Que ces Lombardes puent !58 »
Dans Paris et Vienne, l’épisode exemplaire est repris avec un effet de surenchère puisque l’odeur nauséabonde des volatiles putréfiés est associée explicitement à une maladie dégradant le corps de la jeune femme :
« […] j’ay une enfermeté sur moy, dont il sault si grant et sy mauvaise oudeur qu’il n’est homme qui emprés moy peust demourer quant il la sentiroit, dont raison ne veult que je doye engignier ne decevoir ung si notable baron comme vous estes, car trop seroit grant pechié. Et affin que vous en sachiés le vray, je vous vueil faire sentir mon enfermeté. » Sy commença à delacier la gonnelle pardevant, puis se mist bien au devant de l’evesque et du filz au duc de Bourgoingne et ouvry la gomorre pardevant la poitrine. Et lors saillit une si grant pueur pour la geline qu’elle avoit dessoubz les aicelles qu’il sembloit proprement qu’il y eust ung chien pourry, sy que l’evesque et le filz au duc de Bourgoingne ne la peurent endurer, ains commencerent à clorre le nez et tourner le visage autre part59.
La puanteur qui émane du corps de Vienne engage une forme de métamorphose monstrueuse des volatiles en chair canine en voie de putréfaction. Dans la version brève du roman60, c’est même le propre corps de l’héroïne qui semble putréfié61 puisque Vienne paraît, selon les mots de l’évêque et du duc, « demy pourrie62 » :
« […] je m’en sens si mal disposee de ma personne que ma vie ne sera pas longue et vous dy que, se se fust honneste chose, je vous demonstrasse mes chers, et, pour ce que mieulx m’en croyés, aprochés vous de moy et sentirés ma maladie ! » Et lors le filz du duc de Bourgoine et l’evesque de Saint Laurens s’approcherent de Vienne, de laquelle yssit si grant pueur que a grant paine le peurent souffrir, laquelle sailloit des ayselles pour raison de la puanteur quy y tenoit qui estoit ja pourrie. Incontinent Vienne congneust qu’il avoient assez sentiz de la puanteur, et leur dist : « Mes seigneurs, allez en bonne adventure, car bien congnoistre povez en quelle malladie je suis ! » Et lors prindent congié en grant conpassion qu’ils avoyent en elle et vont dire au Dauphin que Vienne estoit demy pourrie et que se pensoient que ne vivroit pas guieres longuement et que seroit grant domaige de sa mort pour la souveraine beaulté que estoit en elle63.
« Dieu m’a posee en si grant malladie que je ne puis geures vivre en ce monde et m’empire tousjours la maladie, tant que je suis demye pourrie ; pour quoy dictes a monseigneur mon pere qu’il me tienge pour excusee, car, a present, ne puis prendre mari64. »
L’odeur corporelle féminine, qui est traditionnellement associée au désir sexuel et à l’attraction, sert ici au contraire de répulsif puissant ; elle exclut Vienne de la société et fait renoncer le duc de Bourgogne à ses prétentions sur la jeune femme.
Cet épisode narratif, qui symbolise la piété et la chasteté de Vienne, est redoublé lorsque Paris, déguisé en sarrasin, se présente à nouveau devant elle ; toutefois, ce sont désormais des pièces de mouton que l’héroïne place sous ses aisselles :
Vienne, qui vouloit faire à Paris ainsi comme elle avoit fait au filz du duc de Bourgoingne, prist tantost une piece de mouton qu’elle avoit et la party en deux parties et mist soubz chascune aicelle une part, sy que, ains que fust à l’endemain, la char fut aussy puante65 comme une droitte charongne66.
L’effet est similaire et la chair de mouton cuite dans le creux des bras de l’héroïne est comparée une fois encore à une charogne, à une viande de chien en décomposition :
« […] j’ay une enfermeté de maladie sur moy, pour quoy je ne doy consentir à mariage. Et affin que cest gentil homme vous tiengne pour excusé et moy aussi, je ly vueil ma maladie moustrer. » Sy commença à delacier sa gomourre pardevant la poitrine. Puis leur dit qu’ilz s’aprouchassent, et ilz le firent. Paris congnoissoit bien que Vienne vouloit faire, mais faisoit semblant qu’il n’entendoit rien. Sy s’aproucha comme les autres et se mist emprés Vienne. Lors Vienne ouvry son saing, dont il yssit une si grant pueur67 qu’il sembloit proprement qu’il y eust ung chien pourry, dont l’evesque et le frere commencerent à clorre le nez et tourner le visage autre part68.
Comme dans l’Histoire d’Olivier de Castille, seul l’ami fidèle et loyal peut supporter l’infection sans ressentir de répugnance :
Mais Paris, ainsi comme il ne sentist rien, ne se bougoit, ains tousjours regardoit dedens le saing, dont Vienne s’en merveilla. Et quant elle vit qu’il ne se mouvoit, elle dist au frere : « Frere, dittes à cel gentil homme qu’il se oste de cy et ne vueille plus sentir ceste pugnaisie69. » Le frere ly dit, mais Paris n’en faisoit nul semblant de l’oÿr, ains ne se mouvoit plus que s’il y prist plaisir à sentir la pugnaisie70.
Face à ce qui s’apparente à une forme de miracle71, l’héroïne est contrainte d’expliciter sa conduite et se figure elle-même comme une sainte recluse :
Lors Vienne dit une autre fois au frere : « Frere, je vous supply que vous vueilliez faire oster cest gentil homme de cy ! Car je voy bien qu’il n’a que faire de la malvaise oudeur qui de mon corps sault. Et se il me cuidoit avoir à mariage pour la endurer, certes il se traveilleroit pour neant, car ne à lui ne à autre jamais mon corps pour mariage ne sera ottroyé. Ains vous dy que je ay conclus et deliberé, et de cela soyés tout certain, que je vueil du tout le monde habandonner pour estre au service de Dieu72.
Comme l’ont très bien montré les études de Jean-Jacques Vincensini, l’odeur nauséabonde et l’impureté du corps de Vienne symbolisent une menace portée à l’ordre social, indispensable à un retour à la stabilité73. L’héroïne accepte de s’abaisser et de s’avilir pour mieux éprouver d’une part sa foi et sa piété envers Dieu et d’autre part son amour et sa loyauté envers Paris. La dégradation corporelle traduite par la puanteur est alors décrite comme un acte pieux et vertueux, comme une abjection d’orientation chrétienne, tournée vers l’humilité, qui permet à Vienne de vivre paradoxalement en odeur de sainteté.
Ainsi, ce célèbre épisode tisse d’étroits liens intertextuels avec plusieurs romans contemporains dans lesquels des jeunes femmes, en proie à des violences sexuelles masculines, tentent de préserver leur virginité. Dans Apollonius de Tyr, par exemple, la belle Tharsie lutte à plusieurs reprises pour rester vierge, en particulier lorsqu’elle est placée de force dans un bordel. La préservation de la chasteté passe au préalable par un interdit d’ordre sexuel qui est cette fois, de manière plus attendue, relatif au toucher (La dame requist que nul ne la touchast deshonnestement74). Pareille préservation du corps est sensible par ailleurs dans la partie d’Othovyen correspondant à la mise en prose de Florence de Rome dans laquelle la jeune héroïne subit d’incessantes persécutions et cherche à se protéger des attouchements répétés d’hommes agressifs et violents :
Alors le marchant prist Flourence et l’embracha en l’estraignant prés de luy. Quant la belle se senty atouchier d’estrange homme, elle s’escrya et dist : « Sire, je vous prye que du tout vous depportés de moy atouchier car ains que par vous ne par aultre volsisse souffrir estre deshonnouree, je me lairoye ardoir en ung feu75. »
Toutefois, dans ce roman, la préservation de la virginité de Florence est facilitée par le fait qu’elle est protégée par un anneau magique76, talisman contre le viol, que lui a offert son parrain, le Pape Simon :
Moult l’ama son parin le Pappe benoit, lequel apprés ot nom Simon. Quant il vey la pucelle sy bien introduite et aprise, moult l’ama et tint chiere. Et pour la grant beaulté et la vertu et science qu’il veoit en elle, il luy donna ung moult riche anel, ouquel avoit une moult digne et rice pierre, en laquelle avoit tel vertu que tant que une femme ou une pucelle qui sur luy le portast, jamais ung homme n’euist eu le pooir ne la force de le deshonnourer malgré elle77.
C’est parce que Vienne, comme Tharsie, est dépourvue de talisman et qu’elle doit lutter seule pour se défendre, qu’elle s’en remet à des émanations putrides pour rester vierge. Ainsi, dans Paris et Vienne, la puanteur des volatiles placés sous les aisselles constitue une forme de concrétisation de la merveille que les proses contemporaines tirent de sources plus anciennes.
Dans la production romanesque bourguignonne du xve siècle, la puanteur renvoie enfin, selon une conception chrétienne bien ancrée au Moyen Âge, à l’état de dégradation dans lequel se trouve le corps de l’homme par suite du péché originel. Ainsi, dans la partie d’Othovyen qui constitue la mise en prose de Florence de Rome, le traître Milon, qui a tenté à plusieurs reprises de violer la chaste Florence, est atteint d’un mal incurable qui sanctionne ses mauvaises actions passées. Maladie et puanteur associées rendent ainsi compte de la corruption de l’homme pécheur puni pour son vice :
Ainsy comme Milon ot esté une grant espace en l’ostel du chevalier et que nuit et jour avoit fait ses prieres a Nostre Seigneur, lequel jamais ne veult oublyer le povre pecheur quant de bon cuer il luy deprye et oussy que point ne veult que le pechiet que la creature fait ne comment en ce monde qu’il demeure impugny mais couvient que en ce monde ou en l’autre il en porte penitance, sy volt faire ceste grace a Milon que de l’avoir oÿ, car Nostre Seigneur luy jetta sur luy ung sy grant flayel pour le battre que il luy envoye une lieppre et une poureture sy grande par tout le corps qu’il n’y ot membre ne place wide que toute ne fust couverte de meselerye. Le visage, le neez, la bouche et les yeux avoit sy tres enflé qu’il n’ot puissance de parler ne alainer, et avec ce, avoit les jambes et les piés sy tres enflés qu’il n’euist sceu faire ung seul pas. Et couvint que le seigneur le feist porter hors de son hostel et arriere de gens pour la grant horreur que c’estoit a voir et pour la puantise et l’ordure qui estoit en luy78.
Renvoyé à son corps malade d’homme pécheur, Milon est tenu à l’écart de la société. Repoussé et rejeté, il n’obtient son salut que par la grâce de la vierge qu’il a pourtant longuement persécutée : A ! tresnoble dame, a qui j’ay tant fourfait, dont pour le mal m’avés rendu le bien […] Certes, pas ne suis digne de vivre quant tant de maulx vous ay fait. Et sy m’avez sané et gary de la plus puante et orrible maladye que home peuist avoir79.
Au vice de l’homme pécheur s’opposent la vertu et la piété de la chaste jeune femme. Les notations sensorielles de l’odorat sont ainsi à mettre en étroite relation avec un autre sens : celui du toucher. En effet, si le traître Milon quitte son enveloppe corporelle d’homme pécheur, c’est parce qu’il est racheté – ressuscité en quelque sorte – par la belle Florence qui est dotée de pouvoirs thaumaturgiques80 :
Cousin, saches de certain que quant tu te trouveras a Beau Repaire, tu verras plain les cloistres et jardins, tant d’ommes et malades, de poisteulx, de contrefais, de leppreux et d’enflés que tous seras esmerveilliéz ne ja ung seul tu n’en verras retourner que sain et net ne soit gary pour tant qu’il ait sa confidence en Dieu et la pucelle l’ait atouchié de ses mains nues81.
Quant Flourence ot veu que ars estoient les traitres, elle vint vers les malades que la endroit estoient, lesquelx tous, l’un apprés l’autre, elle viseta et les atoucha de ses mains en faisant le signe de la croix, lesquelx incontinent, quant ce ot fait et que elle ot esté d’un bout a l’autre, furent sain et gary oussy net que oncques jour de leur vye avoient esté82.
Toucher et odorat sont ici étroitement associés : en touchant les malades, Florence met un terme aux mauvaises odeurs. Le pouvoir miraculeux détenu par Florence met ainsi fin à la dégradation corporelle, à la maladie et à la puanteur, et rend incorruptibles les corps des Élus destinés à la vie éternelle. C’est de ce pouvoir que la chaste jeune femme tire son statut de sainte dans le siècle.
***
Au terme de notre parcours, force est de constater que la présence de l’odorat dans les romans bourguignons du xve siècle est assez ténue. Les expressions sensorielles de l’odorat sont relativement pauvres et se concentrent sur deux verbes récurrents et opposés : flairer (souef) et puir, ainsi que leurs dérivés morphologiques (flaireur, d’une part ; puant, punaisie, d’autre part). L’odeur agréable semble exclusivement liée à une exaltation de la beauté et de la joie, sensible en particulier dans l’idéalisation politique des entrées triomphales des chefs de guerre, qui s’accompagnent de jets de fleurs odoriférantes. A contrario, la puanteur, inhérente au corps en putréfaction, est étroitement associée à la maladie. En somme, l’itinéraire olfactif ici dessiné permet de mieux saisir le rôle dévolu à l’odorat au sein de la littérature romanesque du xve siècle : l’appréhension sensorielle du monde est au service d’une double idéalisation des personnages de romans, celle d’une part de figures masculines civilisatrices porteuses de joie, et celle d’autre part d’héroïnes féminines chastes et vertueuses, figures de saintes dans le siècle.