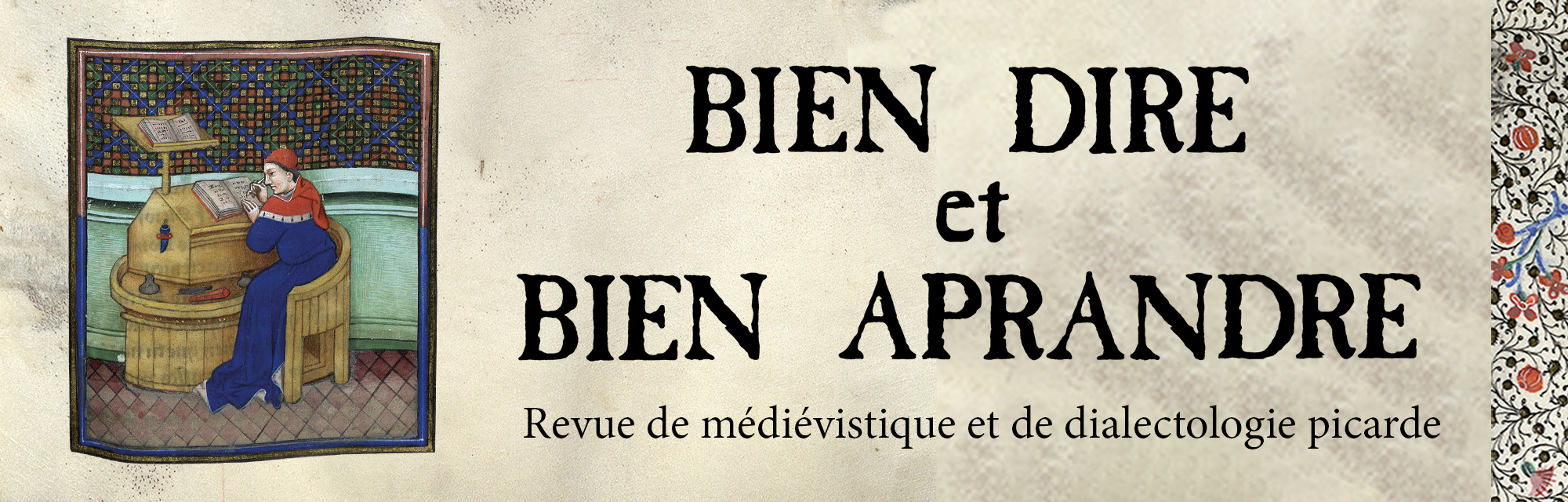L’ensemble des contributions rassemblées dans le présent ouvrage proposent une réflexion sur l’image de la femme médiévale dans la production littéraire bourguignonne de la fin du Moyen Âge et de la première Renaissance. Elles sont issues du colloque qui s’est tenu à l’Université Littoral – Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) et à l’Université de Lille (Villeneuve-d’Ascq) du 16 au 18 octobre 2019, colloque qui s’inscrit dans le cadre des rencontres internationales organisées depuis plus d’une quinzaine d’années à l’Université Littoral – Côte d’Opale afin d’étudier la vaste production littéraire élaborée au cœur des États bourguignons. Ces rencontres ont été consacrées tour à tour à l’écriture de l’histoire en milieu bourguignon2, à l’œuvre multiforme du chroniqueur et poète Jean Molinet3, au célèbre recueil inspiré de Boccace et connu sous le titre de Cent Nouvelles nouvelles4, à l’art du récit à la cour de Bourgogne, autour de Jean de Wavrin et de son atelier5, au rôle joué par l’imprimerie naissante dans le rayonnement de la production bourguignonne6, et enfin à l’écriture du voyage7.
La question spécifique de la place consacrée à la femme au sein même des textes littéraires bourguignons constitue un très beau sujet d’étude. Les recherches menées ces dernières années sur la représentation de la femme à la fin du Moyen Âge et à la première Renaissance ont permis, déjà, d’apprécier toute la richesse d’une telle thématique. Parallèlement aux études générales consacrées aux princesses et aux dames de cour8, nombre de travaux sont venus mettre en lumière plusieurs aspects spécifiques de la présence féminine relevant de l’histoire culturelle ou politique, tels le lectorat et le mécénat féminins9 ou le rôle joué par les femmes de pouvoir10. La société savante SIEFAR, Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime11, s’applique plus largement, depuis l’an 2000, à fédérer l’ensemble des initiatives destinées à mettre en lumière la présence des femmes dans la vie sociale, économique, politique, intellectuelle, scientifique et artistique des périodes précédant la Révolution française.
L’image de la femme a pareillement fait l’objet d’importants travaux dans le domaine précis des études bourguignonnes12. Force est toutefois de constater que la place spécifique consacrée à la femme dans les textes bourguignons n’a donné lieu, jusqu’à ce jour, à aucune étude transversale, embrassant d’un même regard l’ensemble des genres littéraires, qu’ils soient narratifs, didactiques, poétiques ou historiographiques.
Conçu dans une perspective interdisciplinaire, le présent ouvrage a pour ambition de croiser plusieurs types d’approches, littéraire, linguistique, historique, sociologique et artistique et se décline en trois parties complémentaires. La première partie, « Portraits de femmes dans l’espace bourguignon », vise à rendre compte de la diversité des visages de femmes évoqués dans les genres littéraires les plus divers, que l’on songe à l’historiographie, à la littérature de voyage, à la poésie courtoise, à la veine moralisante ou encore à la production ludique et facétieuse qui s’épanouissent à la cour des ducs. S’y ajoutent les figures de ces femmes bibliophiles dont le patrimoine lillois demeure aujourd’hui le vivant reflet. S’ensuit dans la deuxième partie, « Personnages féminins dans les mises en prose bourguignonnes », une réflexion sur les spécificités du remaniement des portraits, des sentiments et des émotions des femmes dans les réécritures en prose qui émanent du creuset littéraire bourguignon. Le volume envisage enfin dans une troisième partie, « Figures féminines dans la nouvelle et le roman bourguignons », l’image contrastée des héroïnes dans la nouvelle et le roman, qui s’élabore entre facétie et grivoiserie, d’une part, et idéal de vertu féminine et valorisation de la femme, d’autre part.
***
« La noblesse est-elle une affaire d’homme13 ? ». La question posée par Éric Bousmar peut à coup sûr être éclairée par l’analyse approfondie de la littérature de cour. Il convient de dégager, dans cette perspective, la place occupée par la courtoisie dans la culture des élites bourguignonnes. Si plusieurs des auteurs phares de la cour de Bourgogne, tels Michault Taillevent ou Martin le Franc, s’inscrivent dans le droit fil de cette tradition, la production bourguignonne n’en est pas moins marquée en profondeur par une veine didactique et moralisante qui stigmatise volontiers la frivolité du jeu courtois. Nombre d’œuvres émanant de ce creuset littéraire relèvent, par ailleurs, de la « galanterie souriante14 » qui s’épanouit à la cour du Grand Duc d’Occident15. Imprimé à Bruges par Colard Mansion, le recueil anonyme des Adevineaux amoureux (1479‑1482) fait se succéder, sur un ton humoristique, les demandes et venditions en amour, transactions amoureuses où la courtoisie confine à la plus franche grivoiserie16, de même que les poèmes de Philippe Bouton entremêlent subtilement registres grivois et courtois17.
La poésie de circonstance du siècle de Bourgogne est vouée, pour une part, au panégyrique des princesses de la dynastie austro-bourguignonne, les vertus canoniques dont elles sont parées, vantées sous la plume des indiciaires de Bourgogne18, allant de pair avec leur action en faveur du bien de paix19. Les célébrations de naissances princières et, davantage encore, le genre de la plainte funèbre témoignent de la place déterminante du modèle féminin dans la littérature de cour20. De même, le genre didactique des « miroirs des dames » est largement représenté en milieu bourguignon, du Procés d’honneur feminin de Pierre Michault au Miroir des Dames de Philippe Bouton21. Les remontrances adressées aux femmes et à leurs conjoints dans Le Parement et triumphe des dames d’Olivier de la Marche ou Le Purgatoire des mauvais maris22, comme l’évocation des caprices de Fortune par George Chastelain ou Michele Riccio23 offrent un tableau contrasté de la société de cour, qui gagne à être confronté au témoignage des chroniques contemporaines. Il importe en outre d’apprécier, dans l’ensemble de ce corpus, les divers modes d’expression de la voix féminine24. L’on songe par exemple à la figure essentielle de Marguerite d’Autriche, qu’elle s’exprime par le truchement de Jean Lemaire de Belges, son poète attitré25, ou fasse entendre sa voix propre dans telle ou telle composition. Ainsi la Complainte de Marguerite d’Autriche tend-elle vers un « affranchissement de la voix féminine » où la mélancolie solitaire de la dame l’emporte sur les plaisirs du jeu courtois26.
Les récits de pèlerinage bourguignons connus de nos jours – comme ceux du Montois Georges Lengherand (1486-1487), du Valenciennois Jean de Tournai (1488-1489) et du Douaisien Jacques Lesage (1519)27 – ont été écrits par des hommes. Néanmoins, il est bien question de femmes dans ces textes : pèlerines, femmes étrangères, prostituées, femmes de chez soi, femmes réelles ou légendaires apparaissent discrètement sous de multiples visages, sans toutefois être mises à l’honneur28. La participation des dames de la cour de Bourgogne aux fêtes et aux cérémonies curiales29, mais aussi le rôle des souveraines dans la gestion des affaires politiques entre la fin du xve et le début du xvie siècle30 s’avèrent également des plus révélateurs de la mentalité des contemporains, en particulier à la lecture des écrits des chroniqueurs bourguignons31. On peut ainsi examiner le rôle des jeunes femmes dans les joutes, tournois et pas d’armes32 qui constituent des épisodes privilégiés, tant de la vie de cour bourguignonne que des nombreux récits d’armes et d’amours bourguignons – comme Ponthus et Sidoine ou Ciperis de Vignevaux33, où l’on ne peut manquer d’établir un lien entre l’amour pré-marital et les prouesses chevaleresques. La présence féminine est également sensible dans les marques de possession ou de féminisation dont témoignent les manuscrits qui nous sont conservés34 ; par l’étude de ces objets plus ou moins riches ou modestes dans leur apparence, on apprend beaucoup sur la culture de ces femmes lettrées, dont certaines restent cependant encore dans l’ombre et ne sont connues que par la trace qu’elles ont laissée sur les parchemins35.
Une autre piste de réflexion conduira dans une deuxième partie à envisager les métamorphoses des personnages féminins dans les mises en prose en plein essor dans le milieu bourguignon. Il est en effet éclairant de mener des études sur le corpus de ces mises en prose composées sous le règne de Philippe le Bon et de rechercher les points de comparaison ou de divergence entre les textes-sources et les remaniements en prose dans la figuration des modèles féminins. Il s’agit ainsi de mieux cerner le regard porté par les prosateurs sur les personnages féminins issus des versions-sources, qui se fait tantôt bienveillant et fidèle, tantôt amusé et distancié. Dans cette perspective, le devenir dans ces réécritures de types féminins comme la femme fée36, la vieille sorcière (l’on songe ici à la perfide Gondrée de l’Histoire de Gérard de Nevers37), ou encore la princesse orientale (représentée par Clarmondine, la bien-aimée du héros éponyme dans le Cléomadès en prose38) doit retenir toute notre attention.
En analysant le processus de sélection opéré par les remanieurs, il convient en outre, à travers les révisions et les corrections apportées dans les réécritures du milieu du xve siècle, de définir l’état de la condition féminine qui semble se dégager de ces versions remaniées. En étudiant alternativement les portraits de jeunes vierges, d’épouses stériles ou de mères assumant la formation des jeunes héros en devenir, on peut ainsi mettre en lumière le rôle des femmes dans les relations sociales, conjugales et familiales. L’étude des réseaux symbolique, associatif ou emblématique mis en place par les romanciers pour décrire les sentiments et les émotions des héroïnes, mais aussi les corps ou les parures féminines, se révèle du plus grand intérêt39 puisque ces réseaux relèvent à la fois d’un modèle social et d’un idéal esthétique. Il existe en effet dans ces textes un certain nombre de clichés descriptifs dans l’art du portrait – au premier rang desquels on compte l’analogie avec les modèles exemplaires du passé (comme Didon, la reine de Carthage, ou Hélène de Troie) – qui mettent en exergue des parangons de beauté, de sagesse et de clergie40. Aussi les figures féminines sont-elles souvent valorisées dans les réécritures en prose à travers des figures de femmes puissantes et justes41.
Toutefois, la critique littéraire a surtout cherché à mettre en évidence les relations de pouvoir déséquilibrées entre hommes et femmes dans les mises en prose bourguignonnes. Elle s’est attachée plus spécifiquement à souligner les violences perpétrées à l’encontre de plusieurs héroïnes persécutées42 comme la belle Euryant de l’Histoire de Gérard de Nevers, l’Orgueilleuse d’Amours de la prose de Blancandin43, ou Joie, l’héroïne à la main coupée de la Manequine de Jean Wauquelin44. Le présent ouvrage permet ainsi d’examiner à nouveaux frais plusieurs motifs éculés qui fleurissent dans les proses bourguignonnes – comme le mariage forcé (qui menace la chaste Florence, l’impératrice de Rome de la prose d’Othovyen45), le viol (illustré par La Fille du Comte de Pontieu46), ou l’inceste (qui sert de moteur au récit de La Belle Hélène de Constantinople en prose de Wauquelin47).
L’étude attentive des cycles iconographiques des mises en prose bourguignonnes permet de mettre en évidence certaines caractéristiques relatives aux figures féminines, peu ou moins sensibles dans les textes. Dans les témoins enluminés des réécritures en prose, la lecture personnelle du peintre offre en effet très souvent une image renouvelée des héroïnes. À ce titre, le Maître de Wavrin48 – que l’on connaît pour avoir illustré dix manuscrits représentant pour la plupart des mises en prose de romans de chevalerie49 – apporte par exemple une attention très particulière aux questions de justice dans la mise en prose de Florence de Rome50, puisqu’il représente l’héroïne éponyme non seulement comme un modèle de chasteté et de loyauté, mais aussi comme une fontaine de justice51. Ailleurs, dans l’Histoire de Gérard de Nevers, il offre une interprétation facétieuse et pleine d’humour en inscrivant dans les images des jeux sur les mots teintés de grivoiserie qu’il convient de déchiffrer52.
Le dernier axe de recherche du volume portera sur l’image de la femme dans la nouvelle et le roman bourguignons, entre facétie, grivoiserie et imaginaire romanesque. Nombreuses sont les allusions grivoises dans le recueil des Evangiles des Quenouilles, où un clerc vieillissant réunit, malgré lui, les propos des fileuses bourguignonnes dans le cadre de veillées hivernales, propos qui portent sur tous les aspects de la vie féminine et maritale, tout en rendant compte d’une sagesse populaire53. Commanditées par Philippe le Bon en personne, les Cent Nouvelles nouvelles, premier recueil original de récits brefs en prose et en langue française, renferment pareillement de nombreuses scènes comiques et gauloises54 où la ruse féminine constitue un leitmotiv55. Dans le roman de Jehan de Saintré, la Dame des Belles Cousines constitue de même un exemple parfait de ruse et de duplicité féminine alors qu’elle s’applique à éduquer, à la fois d’un point de vue social et amoureux, le héros éponyme56.
Il est donc opportun de se demander dans quelle mesure ces textes livrent une image, parfois exacerbée, de la femme et de ses artifices, et quelle part de misogynie s’y révèle. Composées par des hommes, ces œuvres constituent-elles une critique ou une apologie plaisante des femmes ? Ainsi peut-on notamment, sur base de ce corpus, situer la présence du féminin dans le cadre de la réflexion portant, plus généralement, sur les cultures de l’Autre. Comme l’ont démontré plusieurs travaux récents, consacrés, par exemple, au roman français du Moyen Âge tardif57, l’étude des relations entre hommes et femmes, menée dans la perspective des « gender studies58 », trouve dans cette période de l’histoire littéraire un vaste champ d’investigation59.
Le corpus romanesque bourguignon relaie par ailleurs dans l’univers fictionnel la fonction sociale de la femme dans la génération et la perpétuation de la lignée, préoccupation dont on peut par exemple saisir l’importance à travers la figuration récurrente de personnages dans l’incapacité de procréer. L’illustration la plus célèbre est sans doute représentée par Le Roman de Gillion de Trazegnies qui s’ouvre sur un vibrant éloge de l’amour maternel prononcé par dame Marie, émue aux larmes devant le spectacle donné dans un bassin par une maman carpe et ses petits carpeaux60. Sur ce modèle, nombre de récits fictionnels bourguignons mettent en exergue la menace inquiétante de la stérilité dans le couple, comme dans le Roman du Comte d’Artois, où la comtesse d’Artois parvient par la ruse et le travestissement à retrouver grâce aux yeux de son mari et à engendrer un enfant61.
Cette dernière partie s’attachera par ailleurs à mieux appréhender la sainteté féminine qui occupe pareillement une place déterminante dans les romans composés ou copiés à la cour de Bourgogne. On sait toute l’importance de la littérature hagiographique bourguignonne : la Vie de sainte Katherine de Jean Miélot62 est commanditée par Philippe le Bon tandis que David Aubert réalise pour Marguerite d’York une copie du même texte. La protection octroyée à sainte Colette et à ses couvents par la duchesse Isabelle de Portugal va de pair avec la rédaction par Pierre de Vaux de la Vie de sainte Colette de Corbie, dont Marguerite d’York offre un exemplaire aux clarisses de Gand63. L’adaptation par Jean Miélot des Miracles de Notre Dame, illustrés, dans l’exemplaire de Philippe le Bon, des superbes grisailles de Jean le Tavernier64, témoigne de l’importance du culte marial, favorisée par l’intense activité des puys du Nord de la France et attestée, de même, en milieu curial sous la plume de George Chastelain, que l’on songe à sa Louenge à la tresglorieuse Vierge ou à son Lay de Nostre Dame de Boulogne65. Nombre de romanciers bourguignons refondent ainsi leurs héroïnes romanesques à partir de ce moule hagiographique et promeuvent une idéalisation de la femme à travers des figures exemplaires de saintes dans le siècle66. Aussi trouve-ton en abondance dans le roman-fleuve Perceforest des portraits valorisants de jeunes femmes belles et savantes67, de mères aimantes et attentionnées68, et de femmes fortes et viriles, porteuses de revendications féminines69.
***
Il nous est agréable de remercier ici l’ensemble des contributeurs du présent ouvrage, historiens et littéraires, qui ont permis, de porter un regard neuf sur les visages de femmes dans la littérature bourguignonne au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance et d’ouvrir de nouvelles et riches perspectives dans ce domaine de la recherche.
Notre profonde reconnaissance s’adresse également à la compagnie « Mille Bonjours » qui, dans le cadre de notre colloque, a mis sur pied en collaboration avec le Service culturel de l’Université Littoral – Côte d’Opale un spectacle musical médiéval représenté le mercredi 16 octobre 2019 dans les locaux de l’Université à Boulogne-sur-Mer et adapté du Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil70. Notre gratitude va par ailleurs à la Bibliothèque municipale de Lille qui, en la personne de Monsieur Jean-Jacques Vandewalle, Responsable du service Patrimoine, a accueilli les participants du colloque, le vendredi 18 octobre 2019 : Madame Catherine Dhérent, Conservateur général des bibliothèques, a présenté à cette occasion quelques-unes des pièces maîtresses du fonds de manuscrits et d’imprimés anciens de cette institution.
Nous souhaitons enfin remercier chaleureusement nos deux Unités de recherche, l’équipe de recherche Alithila (Analyses Littéraires et Histoire de la Langue) de l’Université de Lille et l’Unité de recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures & l’Interculturel (HLLI) de l’Université Littoral – Côte d’Opale, ainsi que la Fondation pour la Protection du Patrimoine Culturel, Historique et Artisanal (Lausanne), qui ont apporté leur appui financier à la présente publication.