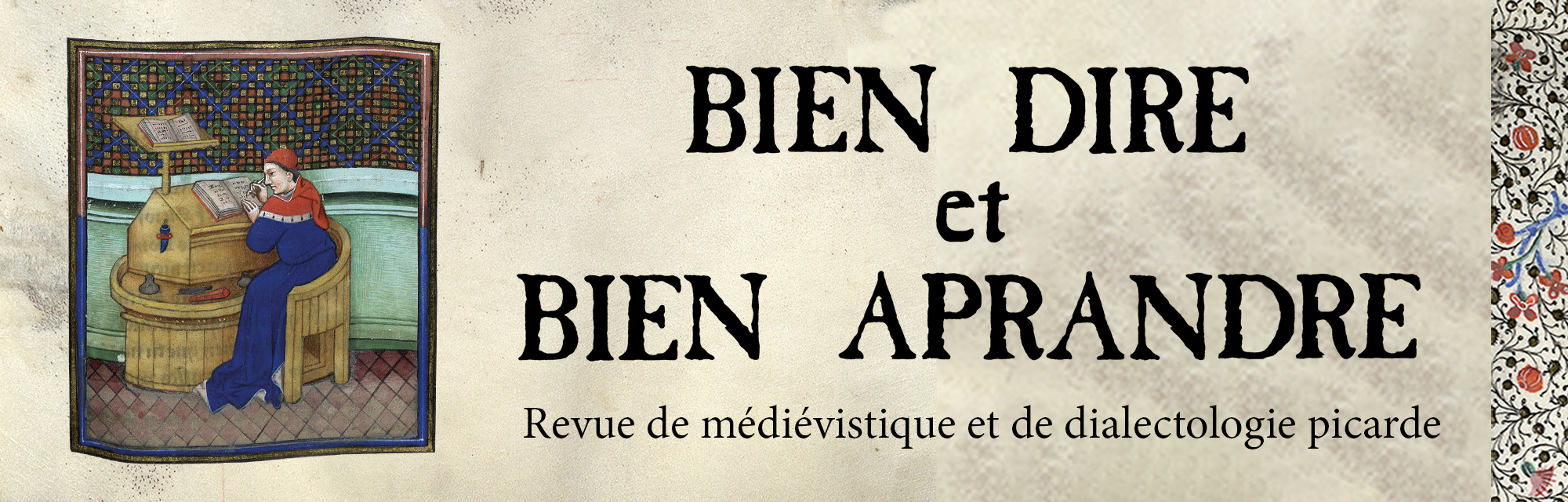Dans son Livre des Prudens et Imprudens (1509), Catherine d’Amboise recourt à trois héroïnes païennes illustrant la prudence (Minerve, Cérès et Isis) et à un exemplum a contrario incarnant l’imprudence, Sémiramis. Emblématiques de la Querelle des femmes entre le xve et le xvie siècles, les trois dames civilisatrices sont sacralisées par l’autrice et servent en partie de prétexte à une diatribe contre les ennemis et controversez du sexe feminin, tandis que la reine des Assyriens se voit déchue du statut de vaillante guerrière qu’elle avait chez Boccace et Christine de Pizan pour exemplifier, de manière univoque et particulièrement véhémente, le vice de lubricité.
L’étude qui suit se propose de mettre en lumière ce paradoxe étonnant, en explorant tour à tour les chapitres consacrés à ces quatre figures mythiques. C’est là l’occasion de faire entendre une voix encore méconnue parmi les traités d’histoire ancienne au seuil de la modernité.
Catherine d’Amboise, plutôt que de rappele...
Ce document sera publié en ligne en texte intégral en décembre 2024.
Catherine d’Amboise, Œuvres complètes, éd. E. Berriot-Salvadore et C. M. Müller, Paris, Classiques Garnier, 2022 (Textes de la Renaissance, 243).…
Parmi les nombreuses études sur cet affrontement idéologique, on consultera l’article suivant : Éliane Viennot, « Champions des dames et misogynes :…
Dans la Mer des histoires, un des titres mentionnés par Catherine d’Amboise à d’autres endroits de son traité, les sept arts libéraux trouvés par…
Fol. 33ro-vo, p. 138-139.
Le nom de Christine n’étant jamais cité explicitement dans son traité, il est impossible de savoir si Catherine d’Amboise a pu avoir sous les yeux…
Fol. 33vo-34ro, p. 139. La ressemblance avec la phraséologie de Christine de Pizan, justement dans le cadre de son éloge de Minerve, est frappante :…
Fol. 34ro, p. 139.
Par exemple, fol. 21vo, p. 123 : O Dame refulgente, par ta vertus almificque as tout le monde sucité, non seullement le sexe femynin mais toulte…
Fol. 34ro-vo, p. 140.
Fol. 34vo, p. 140.
Boccace retient de Cérès l’invention du labour (grâce à celle des charrues et à l’idée d’y atteler des bœufs) et de la transformation du blé ;…
Martin Le Franc, dans son Champion des dames, est le seul avant Catherine d’Amboise à suggérer une association entre la sage Cérès et la religion…
Fol. 34vo, p. 140.
Fol. 34vo, p. 140.
Fol. 34vo-35ro, p. 140-141. Ailleurs dans les Prudens et Imprudens, elle déplore son manque de formation universitaire (fol. 6vo, p. 102) : C’est…
Boccace en moyen français : trouva par son engin caracteres et lettres couvenables au langaige et plus couvenables a doctrine, et aprés enseigna…
Antoine Dufour, par exemple, affirme qu’Elle fut la première inventrice des escriptures et des caracthères, pour satisfaire à sa gloire et à sa…
Fol. 36ro-vo, p. 142-143.
L’exemple le plus parlant est celui de l’éloge de la Vierge Marie (fol. 21ro, p. 122-123) : Toulte esjouye suis et en esperict esprise, quant de…
La source d’inspiration n’est pas clairement nommée dans cette œuvre.
L’emploi de ces adjectifs, généralement attribués aux figures sacrées dans ce traité (par exemple à Marie et à Prudence), se justifie également à…
La vertu d’Isis est mise en avant par Symphorien Champier : en plus d’être à l’origine de l’invention des lettres égyptiennes, du labourage de la…
Martin Le Franc ajoute aux bienfaits de la déesse la construction de maisons (Martin Le Franc, Le Champion des dames, t. 4, éd. cit., p. 19, v. …
Fol. 35ro-vo, p. 141-142.
Fol. 36ro, p. 142. Boccace lui aussi la déclare noble femme et tresdigne de memoire (Boccace, Des cleres et nobles femmes, éd. cit., p. 38).
La réduplication synonymique y est particulièrement frappante : caulauder ne justement hault louer, la tresillustre et refulgente dame, magnifier…
Le Miroir historial décrit Sémiramis de façon relativement neutre : en premier lieu, citant Valère Maxime, comme une guerrière prête à défendre…
Dans la Cité des dames, Raison explique à Christine qu’elle choisit Sémiramis comme premiere pierre ou fondement de [leur] Cité ([Le Livre de la…
À la lumière des deux notes précédentes, on constate que l’argumentation autour du personnage de Sémiramis illustre bien les deux extrêmes de la…
Il est intéressant de noter que c’est justement dans la partie laudatio de son portrait de Sémiramis que Boccace emploie l’hyperbole, l’emphase et…
L’influence de l’écriture sur le corps et l’esprit est formulée également dans d’autres chapitres, surtout lorsqu’intervient la pudeur et que les…
Fol. 29ro, p. 134.
C’est peut-être également une façon implicite de montrer que les exempla des trois héroïnes païennes évoquées précédemment rejaillissent eux aussi…
Fol. 29ro-vo, p. 134.
Fol. 29vo-30ro, p. 134. Rappelons que pour Catherine d’Amboise, un même devoir de bien dire s’applique aux femmes prudentes, en l’occurrence…
Fol. 29ro, p. 133.
Fol. 29vo, p. 134.
Sur cette notion, cf. La Vertu de prudence entre Moyen Âge et âge classique, dir. E. Berriot-Salvadore, C. Pascal, F. Roudaut et T. Tran, Paris…
Fol. 34ro, p. 139.
Fol. 33vo, p. 139.