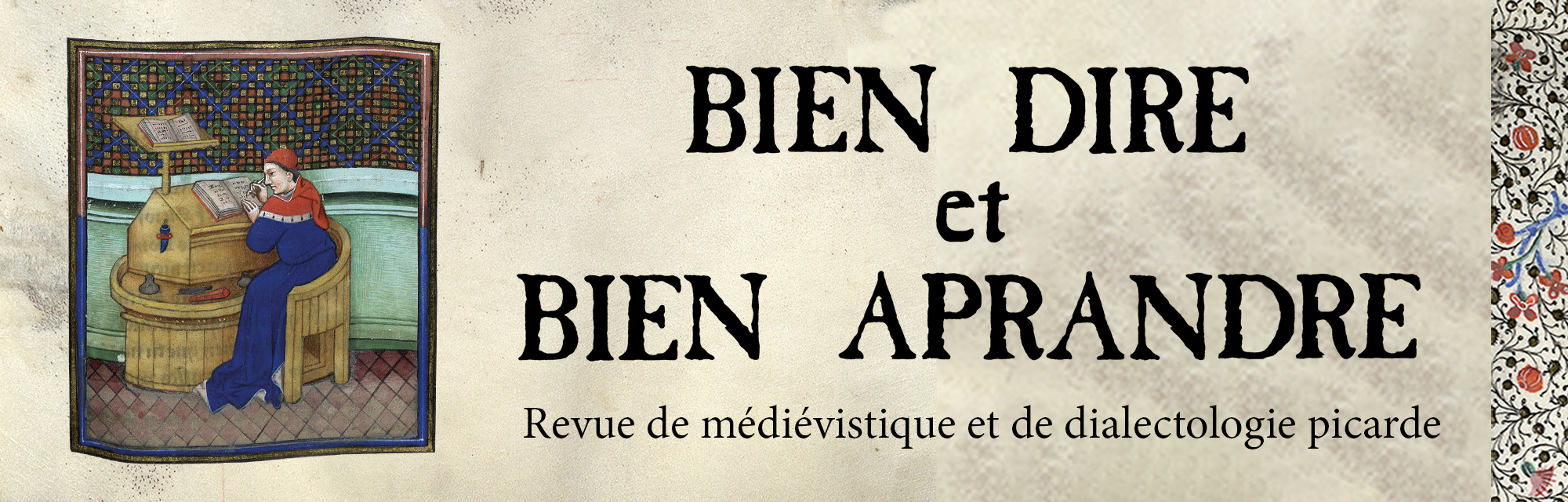Ovide, Les Métamorphoses, éd. et trad. G. Lafaye, 3 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1928-1930, t. 2, VIII, v. 1-151. S. Cerrito souligne que « la…
Pour une description de l’œuvre du xive siècle et de la tradition textuelle, voir le premier volume de l’édition de référence : Ovide moralisé.…
Les Métamorphoses, Bruges, Colard Mansion, 1484, Paris, BnF, RES G-YC-1002. Nous nous sommes attachée dans notre thèse (encore inédite), consacrée à…
Nous ne considérons pas comme une nouvelle version la Bible des poëtes, publiée à trois reprises par Antoine Vérard (1493, ca 1497, ca 1507) puis…
Ce projet est annoncé dans le prologue du premier volume : digne que tel livre soit par icelle leu selon le naturel du livre sans allegories (Le…
Nous désignerons dorénavant ce texte par le titre abrégé Grand Olympe. Nous ne conservons aucune édition antérieure à 1532, et si Antoine du Verdier…
Les Histoires des poëtes comprises au grand Olympe […], Niort, Thomas Portau, 1595, Paris, BnF, RES G-YC-738. Ce texte avait précédemment été…
Deux mises en prose indépendantes l’une de l’autre voient le jour au xve siècle. La première, la prose d’Anjou (1466), présente des objectifs tout à…
S. Cerrito, « ‘En un oiselet la muerent’ ». La chercheuse souligne également les liens avec la Ciris de l’Appendix vergiliana, et soulève la…
Ovide, Les Métamorphoses, éd. cit., VIII, v. 92-94 (« prends, comme gage de mon amour, ce cheveu de pourpre et dis-toi bien que ce n’est pas un…
Les trois commentaires se lisent dans Ovide moralisés latins : Arnoul d’Orléans, Allegoriae, Jean de Garlande,Integumenta, Giovanni del Virgilio…
Comme il est régulièrement d’usage dans les études sur l’Ovide moralisé, nous empruntons à l’auteur du xive siècle le terme « exposition », qu’il…
L’auteur de l’Ovide moralisé utilise diverses sources afin de rédiger son texte, à la fois dans les parties narratives et herméneutiques ; sur ce…
Scilla despoulla dou chief sor/ Son pere […] (Ovide moralisé, éd. cit., VIII, v. 361-362). C. De Boer corrige son manuscrit de base afin de…
Ovide moralisé, éd. cit., VIII, v. 372-375.
Ovide, Les Métamorphoses, éd. cit., VIII, v. 76-80 (« J’oserai passer à travers les flammes et les glaives ; mais, après tout, il n’est pas besoin…
Ovide moralisé, éd. cit., VIII, v. 211-213.
Ibid., VIII, v. 228-232.
Ibid., éd. cit., VIII, v. 82-86.
Sur les dynamiques à l’œuvre dans les mises en prose, on pourra voir G. Doutrepont, Les Mises en prose des épopées et des romans chevaleresques du…
Le prosateur ne conserve en effet que les explications physiques, historiques et parfois morales. Précisons que la rédaction est effectuée à partir…
Silla despouilla son pere Nisus du chief, ce fut du grant tresor qu’il avoit amassé (Ovide moralisé en prose II, fol. 102v°).
Ovide moralisé, éd. cit., VIII, v. 377-379.
Ovide moralisé en prose II, fol. 102v°.
Silla despoulla son pere Nysus du chevel fatal, ce fut du grant tresor qu’il avoit amassé ; Homme guerroyeur pert bien sa puissance qui son tresor…
Mansion utilise la première version de l’œuvre de Bersuire, rédigée indépendamment de l’Ovide moralisé. Le texte se lit dans Petrus Berchorius…
Le texte d’Ovide semble néanmoins avoir été utilisé ailleurs, notamment dans la fable de Philomena où l’éditeur rétablit le discours de la jeune…
Petrus Berchorius, Ovidius moralizatus, éd. cit., p. 326. Les variantes concernant la couleur du cheveu (pourpre ou or) se lisent dans l’ensemble…
Les Métamorphoses, fol. 191v°.
Ibid., fol. 194r°. Petrus Berchorius, Ovidius moralizatus, éd. cit., p. 327.
Les Métamorphoses, fol. 194v°. Petrus Berchorius, Ovidius moralizatus, éd. cit., p. 328.
Les Métamorphoses, fol. 194v°.
Ovide moralisé en prose II, fol. 101r°. Le texte en vers (VIII, 82-86) est cité supra.
Une partie des illustrations, dont celle de Scylla, est réalisée à partir du manuscrit de la prose de Bourgogne conservé à la BnF. Sur l’…
Voir A. M. Cavanna, « Tra elegia e tragedia: descrizione letteraria e visualizzazione artistica del mito di Scilla, filia Nisi, nel Cinquecento…
S. Cerrito, « Une relecture renaissante », art. cit., p. 191-193.
Grand Olympe, t. 2, fol. 41v°. Le premier passage remplace l’apostrophe Faulx et de pute origine ; seule la dernière proposition du second est…
Ovide, Les Métamorphoses, éd. cit., VIII, v. 108-113 (« Où fuis-tu ainsi, abandonnant ta bienfaitrice, ô toi que j’ai préféré à ma patrie, que j’ai…
Ibid., VIII, v. 125-127 (« Punis-moi, Nisus, ô mon père ! Réjouissez-vous de mon malheur, murailles que je viens de trahir. Oui, je l’avoue, je l’…
Grand Olympe, t. 2, fol. 40r°.
Ibid., fol. 39v°.
Les Métamorphoses, fol. 191v°.
Grand Olympe, t. 2, fol. 41r°. Par rapport à la version de Mansion, desloyalle fille remplace forsennee folle, violentes et enragees réduit le…
V. Dupuis, La Femme au théâtre les figures féminines et la poétique de la tragédie en France (1550-1660), thèse de doctorat, Université McGill…
Cupidon m’a navrée avec son dardillon (Les Histoires des poëtes, fol. 142v°). Lorsque l’imprimé contient des signes diacritiques, nous les…
Les Histoires des poëtes, fol. 143v°. Dans le Grand Olympe en prose, c’est avec la mention de l’acte cruel que la narration reprend : Aprés ces…
Les Histoires des poëtes, fol. 143v°. Le Grand Olympe en prose se limitait à fournir ces informations : Maintenant puis je faire et accomplir mon…
Les Histoires des poëtes, fol. 144r°.
Ibid., fol. 143r°.
Grand Olympe, t. 2, fol. 40v°.
Grand Olympe, t. 2, fol. 40v°.
Pour le xvie siècle, toutes les occurrences de ce syntagme répertoriées dans la base Frantext se lisent dans des tragédies.
Dans le Grand Olympe, nous lisons : Lors luy trencha le cheveul sans aulcune vergongne, et yssit joyeusement du palais à tout le cheveul de Nisus…