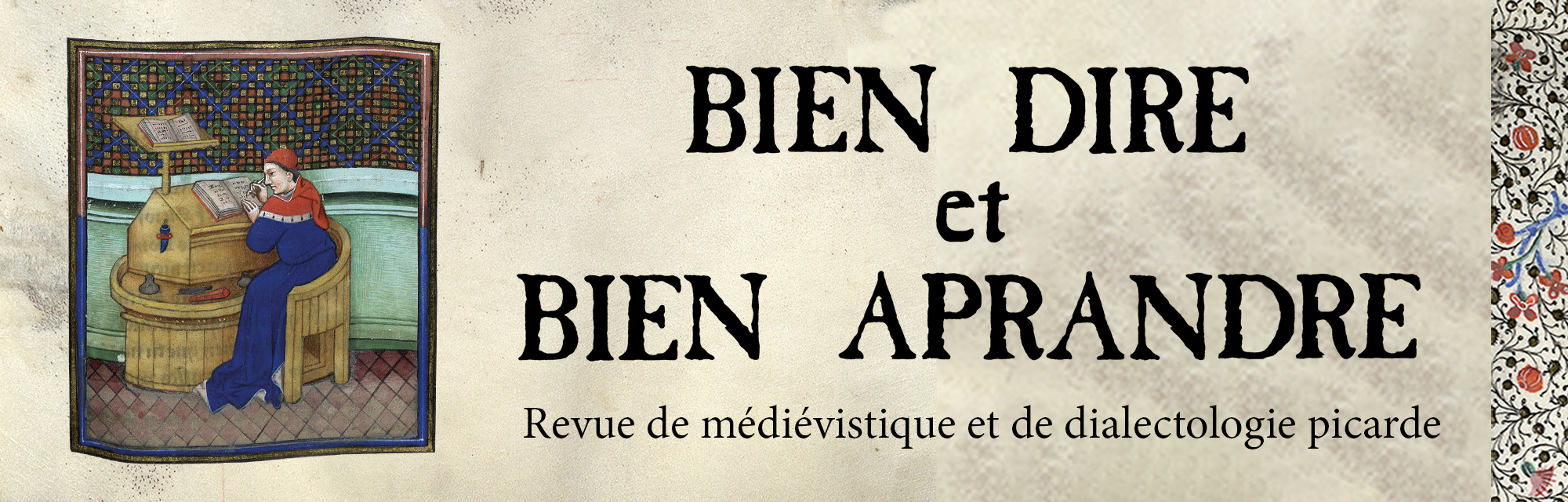Le manuscrit de l’Histoire de Gérard de Nevers enluminé par le Maître de Wavrin dans les années 1450 (Bruxelles, KBR, ms. 96311), comporte des images surprenantes voire énigmatiques dont la fonction symbolique reste encore à déchiffrer2. C’est selon cet angle particulier que nous nous sommes penchée sur elles. Les histoires d’armes et d’amour constituent un terreau fertile pour accéder à différents niveaux de lecture de ces images extrêmement codifiées qu’il convient d’analyser et interpréter, à partir de modes de pensée symbolique et analogique qui ont conditionné la production et la lecture du manuscrit.
La spontanéité apparente du geste de l’artiste suggère un mode de lecture bien particulier, celui d’une parole sur le vif3. Les images du Maître de Wavrin sont ancrées dans les topoï littéraires et les traditions iconographiques, mais aussi dans les mentalités et les modes de pensée de leur temps. Elles sont le résultat « d’une fascination pour la multiplicité des sens, pour la richesse des possibles, pour l’attrait chatoyant de l’ambigu » ; elles sont le fidèle reflet de « l’esprit médiéval », tel que Bruno Roy le caractérise4. Le Maître de Wavrin, très attentif à l’humour que suggère le prosateur, exploite tous les éléments à sa disposition pour encoder les images de manière équivoque, déstabiliser le lecteur-spectateur à l’aide de procédés plastiques inédits, de jeux sur les expressions et locutions d’une parole inscrite dans les images. Son objectif est de susciter le sourire ou le rire et la grivoiserie que suggère le contenu iconographique joue un rôle primordial. Mon angle d’approche permet l’analyse des procédés plastiques et iconographiques porteurs d’une charge symbolique, au fil d’un récit en images qui est autant celui d’une éducation sentimentale et sexuelle que guerrière. C’est dans les échanges entre jeunes gens que s’exprime le plus clairement la facétie du Maître et, à cet égard, le manuscrit de Bruxelles constitue un point d’entrée dans l’étude des « pratiques symboliques relatives à la pensée érotique5 » et des pratiques de lecture d’un cercle restreint de bibliophile qui s’est constitué autour de Philippe le Bon.
Quand l’histoire de Gérard commence, le Maître de Wavrin plonge immédiatement les spectateurs dans l’action. Il met véritablement en scène le chevalier avec toute l’impétuosité et la fougue de sa jeunesse, au moment où il proclame son amour pour Euryant, une épée rougie à la main (Figure 1). Attribut par excellence du chevalier, l’épée est une des métaphores utilisées fréquemment pour faire référence au sexe masculin. Elle revêt alors une double fonction pour le chevalier qui « doit faire preuve d’une compétence érotique au moins égale à la prouesse guerrière6 », selon un mode de pensée analogique qui donne à la forme valeur de signe. La métaphore phallique associée à la couleur rouge renvoie alors aux multiples expressions consacrées ou proverbiales de la langue parlée. Comme le baston au bout rouge fait référence au désir sexuel7, l’épée enflammée symbolise l’ardeur amoureuse8 de Gérard qui a littéralement le feu d’amour9. Le Maître de Wavrin inscrit du texte qui n’est pas celui de la prose dans l’image. L’association du rouge avec le jaune, « qui excite ou qui transgresse10 », en est un indice supplémentaire. Gérard est immédiatement dépeint comme un chevalier de l’Ardente Espee, une expression qui trouve une place de choix dans le dictionnaire érotique de Rose Bidler11. Le jeune chevalier ne manque cependant pas de défauts, même si la beaulté, sens, courtoisye, humilité, la hardiesse et proece […] en luy [sont] apparant12. Présenté dans l’image comme inexpérimenté et vaniteux, il est un personnage comique13 qui se pose en instigateur involontaire de la suite des événements.
Son impétuosité et son ardeur préfigurent une conséquence majeure de la gageure : la perte de sa bien-aimée. Le Maître de Wavrin lance le récit en images d’une manière magistrale. Les spectateurs sont avertis des tonalités humoristiques et grivoises et sont invités à participer activement pour accéder à un autre niveau de lecture. L’image fonctionne par association d’idées, avec au centre, cette épée équivoque, véritable ressort comique qui « rompt avec les convenances14 » et suscite d’emblée une réaction. La miniature répond aux ambitions narratives d’un conteur qui donne à voir sa propre lecture de l’histoire, une lecture subjective où la « présence comique15 » est signifiée et où le désir masculin, dirigé vers les femmes qui en sont les objets, se révèle être une thématique centrale.
La demoiselle objet de désir fait en effet partie du répertoire wavrinois. Évidemment, d’un point de vue plastique, le recours à des traits schématiques16 tend vers un effacement des personnages féminins, représentés à la manière de constructions géométriques érotisées. Les demoiselles, ni mères ni fidèles épouses, ont un statut qui leur permet d’entrer officiellement dans les jeux de l’amour, dans le Jardin de Déduit. Elles se retrouvent souvent en détresse, quand elles ne sont pas ou mal accompagnées, et deviennent alors des interlocutrices idéales pour le chevalier qui va pouvoir mettre en œuvre ses compétences guerrières et érotiques au fil d’un parcours initiatique.
L’épisode de la Demoiselle au Gant (Figure 2) constitue la première rencontre que fait Gérard après s’être rendu compte qu’il a vainement mis à l’épreuve Euryant. Maîtresse d’un povre hostel17 assiégé, la demoiselle tente de repousser Galerant, un mauvais chevalier qui voudrait la faire sienne. Le prosateur mentionne les divers éléments autour desquels se construit l’action de la miniature qui accompagne le texte : le coffre sur lequel s’installe Gérard, le vieux chevalier et les soldats, ainsi que le gant tendu à Gérard. L’image semble donc constituer une illustration littérale du moment où la damoiselle entendy le chevalier et prist son gant senestre sy le bailla a Gerart, que moult volentiers le prist18. Cependant, les jeux sur les mots et les expressions inscrits dans l’image par le biais des éléments iconographiques ajoutent au texte un essaim de significations et d’interprétations.
Pour Gérard, le gant signifie l’investiture : c’est au nom de la demoiselle, dont il devient le champion, qu’il s’apprête à relever ce défi. Associé à la demoiselle, le gant renvoie à la reddition19. Elle, docile et accommodante ou, selon une expression de l’époque, molle comme un gant20, s’en remet entièrement à Gérard. La connotation grivoise est bien présente quand le gant, d’un rouge saturé, passe d’une main à l’autre : avoir les gans signifie ‘être le « premier » homme d’une femme’21. Cette interprétation concorde avec celle du coffre, un motif immédiatement identifiable comme féminin et évocateur, car le coffre d’une femme, c’est aussi son sexe22. Le motif renvoie également à la beauté et la richesse de la demoiselle. Or, la demoiselle est pauvre, mais très belle. L’expression belle au coffre, qui se dit d’une femme qui est ‘laide mais riche’, est donc présente a contrario dans une image qui fonctionne encore une fois par association d’idées, une image riche en possibles23.
Cette première épreuve de Gérard est toute symbolique. Au sens figuré, l’assaut du château, comme la cueillette de la rose, a pour objectif la relation sexuelle et en est devenu une image. Mais c’est littéralement que Galérant assiège le château de la demoiselle. Or, grâce à la bravoure et aux prouesses de Gérard, le siège de Galerant n’a pas raison de la forteresse féminine. Et c’est en revanche sans eschielles que le héros a pris chasteaux et tours, une expression dont le sens figuré, avec une acception érotique24, vient à l’esprit à la lecture des paroles de la demoiselle qui dit : Ma terre et mes chasteaulx et tout ce que j’ay au monde vous abandonne pour en faire a vostre plaisir ; moy meismes me donne a vous pour estre vostre femme ou vostre amye25. La représentation de Gérard assis sur le coffre dans la figure 2 est donc loin d’être anecdotique, le Maître utilise littéralement l’expression seoir en banc pour signifier que Gérard est « à la place d’honneur, en pouvoir26 ».
Avec la miniature qui suit le combat des deux chevaliers (Figure 3), le Maître s’éloigne du texte qui précise que la demoiselle hastivement par ses gens sur son escu le [Gérard] fist emporter ou chastel27. Dans l’image, c’est elle qui accourt les bras tendus. D’un point de vue métaphorique, c’est le château qui se jette dans les bras de l’assaillant. Certes, le cadavre décapité de Galérant témoigne de la férocité du combat, pourtant Gérard ne paraît pas en avoir souffert. Assis, il tourne le dos à la demoiselle. L’enlumineur donne du chevalier une image ambivalente qui oscille entre celle du chevalier qui refuse de prendre la demoiselle pour femme, et celle de l’amant non satisfait qui en a fait son amye. En effet, la figure du chevalier la main à la maisselle, c’est-à-dire la main à la mâchoire28, fait partie du vocabulaire du Maître de Wavrin. L’expression n’apparaît pas dans le passage du texte qui narre cet épisode et l’enlumineur l’utilise de manière tout à fait originale pour signifier la frustration sexuelle29. Gérard n’a pour l’instant pas trouvé d’adversaire à sa taille, mais cela ne saurait tarder.
Lors de sa rencontre avec Denise de la Lande, Gérard est confronté à une femme expérimentée qui a déjà cédé aux avances d’un puissant chevalier avec lequel elle s’est plue à jouer aux champs30 (Figure 4). Parce qu’elle a vanté les mérites d’un autre, son amant lui a imposé le châtiment de l’immersion dans l’eau froide. Une fois libérée, Denise dévoile son corps totalement nu à Gérard comme aux spectateurs. Sa longue chevelure, qui signale qu’elle est une femme « peu sérieuse31 », se fond dans l’arrière-plan par un effet de transparence en même temps que sa couleur jaune semble « contamine[r]32 » le reste de l’image. En associant ainsi le jaune et le vert de la campagne environnante, le Maître encode la miniature et rappelle que les bois et forestz que Gérard a traversés pour arriver jusque-là sont estranges33. L’enlumineur signale la dangerosité de la demoiselle34. Il en est de même avec les rayures de la robe, disposée sur un arbre à la manière d’un trophée : elles placent immédiatement Denise dans une sphère différente, qui n’est plus celle de la raison ou de la norme, mais celle de la transgression35.
Le cadavre gisant au premier plan évoque également la proximité entre armes et amour. Le texte décrit bien le combat guerrier qui précède le sauvetage de Denise, mais le Maître de Wavrin relate un autre type de combat, le combat amoureux. Le sang offre un point d’entrée dans l’image et crée une connivence avec les spectateurs. Il n’est pas qu’un symbole de violence : trace du combat, il témoigne d’un symbolisme sexuel. Au corps nu érotique de Denise fait écho une sexualisation du corps masculin dont la « force » et « l’impénétrabilité36 » se matérialise « en surface » par le biais de l’armure37. L’épée rougie, le membre viril de Gérard, est bien présente. Elle est dirigée vers Denise, car, comme on disait à l’époque, femme nue veult on au lict38. Sa couleur est d’autant plus explicite qu’elle est associée au vert du paysage, de la reverdie et de l’inconstance39 qui offre un cadre approprié aux aventures que vit le jeune chevalier.
Le geste de Gérard qui glisse son épée dans le fourreau, geste métaphorique de la pénétration, suggère l’expression mettre la main a l’espee40. Les mains ouvertes et tendues de la demoiselle, grandes et bien visibles, témoignent de la disponibilité sexuelle de Denise qui effleure l’arme et de son emprise possible sur Gérard. La fontaine explicite le type de relation qu’ils entretiennent et évoque les expressions boire à la fontaine qui peut être d’amour41 ou verser en la fontaine qui ne sera jamais pleine qui renvoient à l’acte sexuel42. Tous deux sont en train de s’escrimer, de s’adonner à la lutte amoureuse43.
Dans la miniature suivante (Figure 5), Denise est rhabillée et Gérard est allongé, la tête sur le giron de la fausse demoiselle en détresse alors qu’elle est maintenant en train d’échafauder une tentative de meurtre par intermédiaire. L’enlumineur semble faire preuve de réserve, mais la tonalité plaisante et grivoise de la miniature précédente perdure. La fontaine a été déplacée, mais pas supprimée et le cheval de Gérard est représenté la tête baissée, en train de boire l’eau qui s’en écoule. Le cheval renvoyant au chevalier, c’est aussi Gérard qui boit à l’eau de la fontaine. Bien que dans son fourreau, l’épée que Gérard tient fermement de ses deux mains est toujours présente, toujours aussi rouge, même si elle semble être au repos. L’enlumineur a ajouté un détail : un court trait perpendiculaire à la lame en délimite clairement le bout comme pour rendre la représentation plus anatomique. Avec la juxtaposition de l’épée au cadre, la connivence est encore de mise, les spectateurs sont en contact physique avec l’image.
L’ironie de la scène suscite le sourire, mais ce sont bien les jeux de mots dont on peut déchiffrer l’inscription dans l’image qui s’avèrent susceptibles de déclencher le rire des spectateurs. Gérard s’est mis dans une position de vulnérabilité : il a baissé la garde. Il est pourtant bien connu qu’il ne faut se fier ni a femme, ni au giron44 ! Dans cette séquence de deux miniatures, l’enlumineur met en scène deux « situations plaisantes45 » : la ruse et la déconvenue de Denise. En en faisant une illustration littérale, il fait une lecture figurée du contenu textuel qui présente Denise la main a sa maisselle46. Et c’est elle qui se trouve alors en position de frustration sexuelle, une position habituellement réservée aux hommes. Alors qu’il était jusque-là présenté comme séducteur dominant, Gérard est séduit et dominé.
Les demoiselles ne sont donc pas de simples objets du désir masculin et la question du désir féminin est également posée avec force, qu’il s’agisse de Denise, de la Demoiselle au Gant ou d’Euryant, la première des demoiselles. Objet du désir, mais aussi séductrice, cette dernière n’est pas qu’une demoiselle-étape sur le parcours de Gérard.
Le Maître de Wavrin explicite le statut particulier de l’héroïne grâce à un simple accessoire que porte Gérard. Pour cette miniature extrêmement codifiée et empreinte de pensée symbolique et proverbiale (Figure 6), nous ne nous attarderons que sur un détail d’importance dans la caractérisation d’Euryant : le foulard qui cache partiellement le visage du héros. Le Maître de Wavrin l’utilise pour faire référence à la maladie d’amour dont Gérard est frappé et que suggère le contenu textuel47. Parce que le mal d’amour est souvent associé au mal de dents48 et que la jalousie qui vient de tres grant amour49 est à l’origine d’un mal plus esragié que nul mal de dens50, le foulard atteste de la force et de la véracité des sentiments de Gérard pour Euryant, qui s’impose comme la vraie amie.
L’enlumineur insiste par ailleurs sur la dimension psychologique d’Euryant à de nombreuses reprises, ce qui témoigne de l’importance qu’il lui accorde. C’est par ailleurs en l’absence de Gérard qu’Euryant démontre au mieux sa force et sa résilience. La miniature où Euryant se défend de Méliatir (Figure 7) est très fidèle au texte qui dit qu’elle haulcha le piet destre sy en fery le chevalier par la bouche ung cop si grant que quatre de ses dens luy rompy en la gorge51. L’enlumineur insiste sur l’efficacité du coup porté et fait du méchant chevalier l’objet du rire. L’aplomb d’Euryant et son dynamisme freinent nettement le mouvement vers le lit engagé par son assaillant. La fenêtre derrière elle, solidement grillagée (symbole de virginité), et la couleur bleue des draps confirment la loyauté52 dont elle fait preuve envers Gérard. Le coup porté est hautement symbolique. Contrairement à Gérard, ce n’est pas l’amour, mais la concupissence53 qui fait souffrir Méliatir des dents, dans une sorte de justice poétique. Les symptômes de l’humiliation et de la colère de Méliatir sont les mêmes que ceux du mal d’amour : il refuse de s’alimenter et de s’hydrater jusques ad ce que d’Euryant euist vengance54. L’objet de son désir étant définitivement inaccessible, c’est par ailleurs ironiquement derrière un coffre que Méliatir se dissimule pour tenter d’assassiner la jeune femme dans son sommeil.
Le Maître de Wavrin n’illustre pas ce passage et les spectateurs pénètrent avec le meurtrier dans la chambre qu’Euryant et Ismaine partagent, les découvrant au lit (Figure 8). L’enlumineur profite de cette occasion pour broder sur le texte. La scène se déroule de nuit et c’est un procédé habituel du Maître de Wavrin que d’utiliser la présence de bougies pour renvoyer à l’obscurité. Mais une chandelle aurait été suffisante alors que le Maître de Wavrin en fait figurer deux ici. Liées à la flamme amoureuse, les bougies sont souvent mises en relation avec l’amour55. Et, parce que la chandelle fonctionne dans les images par symbolisme analogique et que sa forme fait allusion au sexe masculin56, les deux chandelles sur le dressoir convoquent immédiatement à l’esprit des spectateurs attentifs l’expression mettre deux chandelles au chandelier57, utilisée pour dire d’une femme qu’elle a deux partenaires58. La fumée qui se dégage des mèches indique clairement qu’Euryant et Ismaine ont allumé puis éteint la chandelle59.
Le pot, ici enchâssé entre les « jambes » du dressoir, fait référence au sexe féminin60. Véritable signe visuel, son interprétation est essentielle pour la construction du sens : il renvoie à plusieurs expressions proverbiales liées à la vie de couple61. Les demoiselles pensent être a pain et a pot62 (en toute intimité), mais les spectateurs descouvrent le pot63 (la vérité cachée) s’ils se rappellent les expressions proverbiales relatives à la sexualité et plus précisément à l’homosexualité féminine, puisque n’avoir soin de pilete dans le pot fait référence aux « pratiques lesbiennes64 ». Le pot, qui évoque une sexualité « périphérique65 », n’est pas présent dans la description textuelle qui est faite de la chambre, c’est un détail ajouté par le Maître de Wavrin qui s’appuie sur différents éléments du texte pour en faire une lecture figurée. Le prosateur insiste sur le fait qu’Euryant trouve du réconfort en retrouvant Ismaine et que ces dernières tant amoyent l’une l’autre que deux seurs n’en pouoyent plus faire66. Plus loin dans le texte, il est dit que les demoiselles ont découvert leurs bras et leur poitrine en raison de la grant chaleur67 qui peut aussi signifier « l’excitation sexuelle68 ». La métaphore filée des travaux d’aiguille est présente dans le texte comme dans les images et nous nous contenterons de mentionner qu’Euryant, qui en est experte, se trouve toute désignée pour apprendre et monstrer a ouvrer d’or et de soye69, à la moult jone et belle70 Ismaine.
Comme Gérard avec ses demoiselles déflorées, Euryant, qui n’est visiblement pas blanche comme violette71, excelle dans l’art de l’amour. Pour reprendre la métaphore des travaux d’aiguilles qui a peut-être mis le Maître de Wavrin sur la piste de la grivoiserie, nous pouvons résumer ici en disant que sur touttes les aultres femmes Euryant en estoit la maistresse72. Le parcours d’Euryant n’est donc pas si divergent de celui de Gérard. Ses mésaventures sont des occasions pour faire ou parfaire une éducation sentimentale et sexuelle, mais aussi presque guerrière !
Le cycle iconographique de l’Histoire de Gérard de Nevers offre un exemple particulièrement divertissant d’une lecture facétieuse des images qui se faisait sans aucun doute entre amis, dans le cercle très restreint de « lecteurs amateurs73 » qui s’était constitué autour de Philippe le Bon. Les compétences qu’Euryant et Gérard acquièrent sont aussi celles requises du lectorat. Les images suggèrent que ces dernières sont non seulement militaires et officielles, mais aussi sociales et érotiques. À travers les tribulations du jeune couple, le lecteur-spectateur lui-même est éclairé sur les choses de la vie, la complexité des rapports sociaux, notamment avec l’autre sexe, et la nécessité de percevoir les intentions parfois mauvaises qui motivent les actions. C’est après beaucoup de péripéties que les deux héros sont finalement réunis – et prêts – pour vivre en bonne paix et amour tout le cours de leur vye74.
« Obscénité rendue courtoise75 » ou courtoisie rendue obscène ? Difficile d’apporter une réponse claire : le Maître de Wavrin s’adresse à ses spectateurs de manière bien plus personnelle et complice, mais avec élégance et sophistication. Son style spontané et sa touche humoristique sont mis au service du trait ou du « mot d’esprit76 », avec pour objectif affiché le sourire ou le rire77. Aux « dimensions affective, esthétique, poétique ou onirique » s’ajoute la dimension humoristique qui s’avère être une propriété tout aussi « essentielle à [l]a mise en œuvre et à [l’]efficacité78 » du symbole dans les miniatures du manuscrit bruxellois. C’est seulement lorsqu’ils revêtent une fonction symbolique que ces « objets [qui] n’existent que rapportés au[x] héros79 » – et aux héroïnes – deviennent pour nous une porte d’entrée dans l’univers du Maître de Wavrin.
Fig. 1
Gérard, chevalier de l’épée ardente, à la cour de Louis le Gros (Miniature 2) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 2v°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 2
Gérard se fait le champion d’une demoiselle en détresse : la Demoiselle au Gant (Miniature 18) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 33r°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 3
La demoiselle se jette dans les bras de Gérard après son combat avec Galérant (Miniature 20) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 37v°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 4
La Demoiselle hors de la fontaine, Denise de la Lande (Miniature 39) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 85v°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 5
Gérard, tête sur le giron de la mauvaise demoiselle (Miniature 40) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 88v°
© Bibliothèque royale de Belgique)
Fig. 6
Le foulard ou Euryant la vraie amie (Miniature 21) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 40v°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 7
Euryant se défend de Méliatir (Miniature 33) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 71r°
© Bibliothèque royale de Belgique
Fig. 8
Euryant et Ismaine au lit (Miniature 34) dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Bruxelles, KBR, ms. 9631, fol. 72r°
© Bibliothèque royale de Belgique