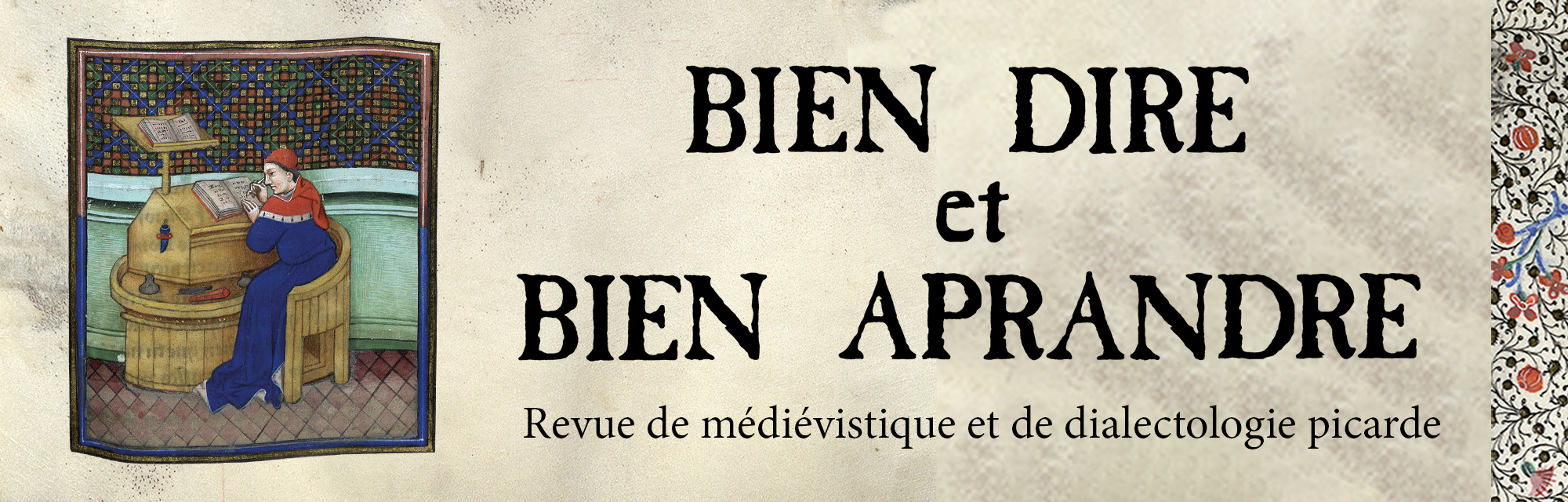« Les Cent Nouvelles nouvelles offrent de multiples visages à leurs lecteurs. » (A. Velissariou1)
« En même temps qu’elle se déguise, Katherine souhaite être reconnue. » (A. Velissariou2)
Katherine, une jeune aristocrate vivant dans l’hôtel d’un baron du Brabant, est l’héroïne de la nouvelle 26, une nouvelle exceptionnelle du recueil bourguignon Les Cent Nouvelles nouvelles3. Exceptionnelle tout d’abord par son originalité, elle est une de ces quelques pièces pour lesquelles les spécialistes n’ont pas trouvé de sources directes. Exceptionnelle ensuite par sa longueur et surtout par son ton qui est clairement parodique voire caricatural. Il tourne en dérision l’ancienne littérature courtoise où l’amour est sérieusement sublimé, mais aussi au xve siècle déjà usé et démodé. Cependant, malgré la parodie, il y a un glissement vers le sérieux. Roger Dubuis a même vu dans cette pièce une nouvelle psychologique et Jean Devaux une nouvelle édifiante, un exemplum moralisateur4. La nouvelle est également exceptionnelle car l’on y lit la fascination envers les exploits du personnage féminin, d’une héroïne, de Katherine. Contrairement à ses congénères, elle ne tombe pas dans la catégorie tellement caractéristique des femmes des Cent Nouvelles nouvelles, femmes souvent abusées par le corps masculin, souvent peintes de manière misogyne.
Elle est tombée amoureuse de Gérard, un gentilhomme qui demeure dans la même maison : ils ont pu vivre leur passion, tous deux aveuglés par Amour, durant deux années entières ; mais les commérages concernant cet amour illicite arrivent jusqu’aux parents de Katherine ainsi qu’au maître de la maison. Une amie conseille alors à Katherine de donner congé à Gérard et de l’envoyer vivre une aventure quelconque, jusqu’à ce que l’affaire se calme ; entre-temps ils s’aimeront par correspondance. Suivant ce conseil, Katherine annonce à Gérard qu’il doit partir séance tenante. Les deux amants se promettent de rester fidèles, même éloignés l’un de l’autre. Très peu de temps s’écoule après le départ de Gérard avant que le père de Katherine lui impose un mariage. Il faut donc que Katherine s’advis[e] d’un tresbon tour pour contenter tous ses parens, sans enfraindre la loyaulté qu’elle veult tenir a son serviteur5. Elle demande à ses parents la permission d’aller en pèlerinage à Saint Nicholas de Varangeville, pour vérifier, par la révélation souhaitée du saint, si son destin est le mariage ou le célibat, son plan étant de se rendre, en cours de route, chez son ami. Accompagnée seulement de son oncle et déguisée en homme, Katherine exécute le pèlerinage mais sur le chemin du retour elle convainc son oncle, en lui promettant une fortune, de faire halte au château du Barrois où Gérard s’est installé entre-temps. Affaire conclue, Katherine se nomme à présent Conrard6, et elle est acceptée comme gentilhomme par le seigneur du Barrois et puisqu’elle/il vient du Brabant tout comme Gérard, le maître d’hôtel l’héberge dans la même chambre que ce dernier. Pendant les trois jours et surtout les trois nuits qui suivent, Gérard ne reconnaissant pas Katherine dans Conrard se découvre dans sa déloyauté. Le cœur brisé, Katherine lui laisse une lettre d’adieu et le quitte à nouveau. Le lendemain, comprenant l’échec de son épreuve amoureuse à la lecture de la lettre, Gérard se précipite vers le Brabant, mais en vain. Il arrive le jour des noces de Katherine.
Peut-être plus que le désir de se moquer des anciens idéaux courtois qui pouvaient encore fasciner des jeunes filles comme Katherine, la nouvelle marque la désillusion par rapport à ces rêveries. C’est Gérard qui le précise bien en critiquant les amants fins et fidèles : si vous maintenez ceste folie, jamais vous n’arez bien et ne ferez que songer et muser, et secherez sur terre comme la belle herbe dedans le four chault, et serez homicide de vous mesmes7. Or, la désillusion se comprend en relation avec les idéologies qui la précèdent et qu’elle tourne en dérision. Les trois visages de Katherine, fille éperdument amoureuse, garçon en pèlerinage amoureux et amoureuse délaissée, renvoient aux images de grandes héroïnes des siècles passés que le narrateur s’emploie à subvertir selon les trois temps de la nouvelle. Entre l’aventurière qui, se mettant en quête de son amoureux, défiait les normes sociales et l’amante déçue qui y revient, le pèlerinage aventureux de Katherine/Conrard, constitue la majeure partie de la nouvelle.
Katherine, le souvenir de la malmariée et de l’amante déçue
Les amours de Katherine et Gérard pourraient bien résonner avec celles d’un des couples phares de la littérature courtoise, Guigemar et la dame malmariée dans le lai de Marie de France. Défiant Amour par son orgueil, Guigemar, le protagoniste homonyme du lai rédigé quelque 300 ans avant notre nouvelle, a été grièvement blessé par une biche blanche représentant justement le dieu offensé. Un navire magique l’amène alors à la ville mystérieuse de la malmariée. Du récit d’un amour unilatéral le lai devient celui d’un amour réciproque car la dame, après l’avoir guéri, tombe également amoureuse de Guigemar. Les deux amants vivent leur passion pendant un an et demi, mais, découverts en flagrant délit, ils se séparent. Guigemar fuit et la malmariée est emprisonnée. Mais au bout de deux ans, elle s’enfuit également et entreprend un voyage à la recherche de son amant8. Fin heureuse, les deux protagonistes se retrouvent et se reconnaissent.
Je suis fascinée par le parallèle possible avec Guigemar, non pas parce que Guigemar et Gérard riment et partagent leurs initiales, mais plutôt parce que l’itinéraire de la deuxième partie du lai et la première partie de la nouvelle recèlent de nombreux dénominateurs communs9. L’amoureuse avertit que le séjour dans le locus amoenus des amants liés par un amour interdit touche à sa fin (au bout d’an et demi dans le lai et de deux ans dans la nouvelle) et que des précautions doivent être prises. La rupture qui s’annonce inévitable pour les deux femmes fait naître chez elles la peur qu’il ne s’agisse pas vraiment d’une séparation temporaire, mais de la fin de l’amour. Elles souhaitent garantir la fidélité de leur compagnon par des promesses et des gages, et elles partent finalement à la recherche de leur amant10. Dans le lai le pressentiment de la dame est présenté comme une intuition féerique et relie la malmariée aux deux autres personnages mythologiques du lai, la biche parlante et Vénus, la déesse de l’amour représentée sur les murs dans la chambre de la dame. Le recours à la matière antique est d’ailleurs un autre point de rapprochement. Dans le lai, la rencontre de Guigemar avec la biche blanche – l’incarnation poétique d’Amour/Cupidon – est doublée par l’évocation de Vénus11. Les deux protagonistes courtois sont en manque d’amour dans leur vie et pour eux la présence symbolique du personnage mythologique est le signe révélateur de l’arrivée proche de l’amour. Guigemar est atteint par la flèche d’Amour qui lui donne l’espoir en même temps qu’une blessure, en lui révélant qu’il peut guérir grâce à l’amour d’une femme. La mère d’Amor, Vénus, offre un peu d’espoir à la malmariée par sa présence, mais aussi parce qu’elle brûle les Remedia amoris d’Ovide, un livre qui se moquait plutôt des affres de l’amour pur en proposant comme alternative ‘thérapeutique’ l’oubli de l’amante par sa substitution. Amour est également évoqué dans la nouvelle comme celui qui suscite la passion entre Gérard et Katherine, ainsi que les leçons ovidiennes auxquelles il semblerait que Gérard a recours quand il est au Barrois, comme nous le verrons plus loin12.
Pas d’intuition dans la nouvelle, puisque le secret est d’ores et déjà divulgué. Or, la bonne amie de Katherine, soucieuse de l’honneur de cette dernière, la presse de prendre des mesures avant qu’il ne soit trop tard. L’a priori se change ici en a posteriori, ce qui met en relief la dégradation intentionnelle du sublime vers le trivial. Le mystère du savoir psychique et intérieur attribué à la femme devient un savoir pratique et extérieur.
Théoriquement, la complice propose un modèle de l’amour plus spirituel, car il s’agirait d’une transition du matériel vers l’intellectuel. Elle pense peut-être, et Katherine en serait séduite, à l’histoire d’Abélard et Héloïse dont l’amour qui ne pouvait plus être vécu physiquement fut sublimé par l’échange de lettres qui célébraient à la fois l’infini de l’amour et la réflexion philosophique13. Mais la nature même de cette proposition est quelque peu subversive par son pragmatisme. La séparation amoureuse est imposée ordinairement suite à la découverte d’un flagrant délit : tel a été le cas entre autres, pour les couples qui nous concernent, Guigemar et sa dame, et Héloïse et Abélard. Selon le principe des amours interdites, tous les risques valent la peine d’être pris pour réaliser l’amour, ce qui pousse les amants au subterfuge afin de trouver des moments propices et clandestins pour se voir plutôt que de prendre l’initiative de se séparer afin d’éviter a priori le scandale. La séparation est pressentie par la malmariée, mais elle se réalise uniquement après que son mari a découvert les amants au lit. Pareillement, la correspondance entre Abélard et Héloïse, certes une sublimation de leur liaison, ne commence qu’après que les deux amants ont été brutalement séparés par l’oncle d’Héloïse et installés dans deux couvents.
Ainsi, l’héroïsme amoureux, malgré les discours enflammés des deux protagonistes au moment de la séparation, est quelque peu contaminé par les aspects pragmatiques et réalistes14. Et quoique Katherine se rallie aux principes du grand amour, elle-même les dégrade. Elle pense peut-être à des couples d’amants illustres dont la fuite commune symbolisait la fatalité sublimée de l’amour, tels Pirame et Tisbée, ou encore Tristan et Iseut. Mais le fatalisme héroïque s’amenuise face à des soucis d’intérêt personnel et des calculs froids : elle se fust offerte de luy faire compaignie en son voyage ; mais, esperant de quelque jour recouvrer ad ce que treseureusement faillit, la retira de ce propos15. C’est un moment révélateur où l’idéalisme de Katherine commence à se mêler avec le réalisme, le pragmatisme voire le matérialisme. L’apogée en serait dans le troisième temps de la nouvelle. Katherine dans la peau de Conrard s’imagine peut-être comme telle ou telle amante qui se suiciderait sur l’autel de l’amour (j’aymeroie plus cher morir mille foiz, si possible m’estoit, que d’avoir fait a ma dame si grande faulseté16), mais en réalité elle laisse un message froid, raisonné et surtout réfléchi et intéressé. Se voyant libérée des contraintes de son serment, elle reprend l’anneau qu’elle a offert à Gérard comme gage de son amour, et le remplace par une lettre d’adieu résumant toute leur histoire, qui ne finit pas par une mort glorieuse mais par un retour désenchanté à la réalité : s’en va vers son païs, et ne le quiert jamais ne veoir, ne rencontrer17. Tout cela peut apparaître au lecteur d’aujourd’hui comme une marque de ‘féminisme’ ou, pour reprendre les termes de Roger Dubuis, une « vengeance qu’elle veut éclatante18 ». Or, ce n’est pas là de l’amour, en tout cas pas selon les critères élevés de la fin’amor, qui ne permet ni serments effacés ni gages repris : la seule issue à cette impasse est la mort, comme le prouvent les héroïnes des Héroïdes ou encore La Châtelaine de Vergy19.
Katherine, le souvenir de la sainte travestie
Ce sont les péripéties que vit Katherine dans la peau de Conrard qui constituent le noyau narratif de la nouvelle. Comme le souligne Vern L. Bullough dans son article précurseur sur le transvestisme féminin au Moyen Âge, cette pratique attestée dans quelques légendes et mythes de saintes offrait une solution à des jeunes femmes contraintes au mariage20. Il ne s’agissait pas uniquement d’éviter le rapport sexuel et de célébrer l’idéal (patriarcal) de la virginité, mais également « to imitate the superior sex, to become more rational21 ». Se forge ainsi une différence fondamentale entre la conception sociale des femmes travesties qui gagneraient selon Vern L. Bullough statut et admiration en se perfectionnant spirituellement par la prise de l’identité et du rôle masculins, et celle des hommes travestis qui feraient le chemin inverse et seraient associés surtout à l’érotisme et « would be losing status, becoming less rational22 ». Ce contraste entre l’idéal de la masculinité féminine et le mépris de la féminité masculine, surtout autour de la question de la sexualité, se manifeste clairement dans le ton narratif. Dans le monde dit courtois et sublimé, l’on trouverait plutôt des femmes qui se déguisent en hommes afin de fuir ‘héroïquement’ la sexualité. En revanche, les hommes se déguisant en femmes chercheraient plutôt les exploits sexuels qu’ils pourraient accomplir grâce au déguisement et ils peupleraient surtout le monde de la farce, avec quelques travesties faisant de même23. Cette distinction entre les types d’activité sexuelle (ascétisme féminin vs débauche masculine) est également relevée par Michèle Perret, qui envisage le transvestisme féminin comme un dernier recours face à des impasses souvent d’ordre sexuel, dans les romans et récits médiévaux24. Michèle Perret estime que le transvestisme représente dans ces récits « des situations ambiguës, où l’homosexualité, au second degré, est toujours suggérée25 ». Katherine serait nostalgique de quelques-unes de ces héroïnes et s’en inspirerait tout en offrant un cas de figure original. Elle prend l’initiative de sa transformation dans le contexte d’un mariage imposé, empruntant ainsi quelque chose d’une sainte ou d’une Blanchandine, mais en même temps il ne semble pas qu’elle le fasse par contrainte comme en dernier ressort, mais plutôt en raison de sa fascination devant la possibilité de partir à l’aventure, comme un homme26. En se glissant dans la chambre de Gérard et en passant les trois nuits intimement avec lui, elle reconstitue une situation farcesque, rappelant quelques fabliaux, mais là aussi elle change l’horizon d’attente, en ne se livrant pas finalement à la passion charnelle et en sublimant ainsi davantage l’idéal amoureux qu’elle défend (peut-être un peu maladroitement).
L’apogée de la nouvelle se déroule dans la chambre où pendant trois nuits Gérard et Conrard dorment ensemble dans le même lit, sans pour autant que Gérard découvre qu’il dort avec Katherine. Ce lit, l’endroit par excellence de la transgression sexuelle dans les Cent Nouvelles nouvelles, devient non pas un lieu d’ébats mais de débat. C’est là que les deux protagonistes exposent respectivement et graduellement leurs théorisations de l’amour. Katherine/Conrard protège les valeurs de la fin’amor27 tandis que Gérard représente une ‘philosophie’ ovidienne (ne le dit-il pas lui-même : je voulz user pour remede du conseil d’Ovide ?)28.
Le scénario d’un couple d’amants se retrouvant ensemble dans un lit sans consommer l’amour renvoie a priori, et ironiquement il va sans dire, à un topos de la fin’amor troubadouresque, l’asag. « Épreuve purificatrice », comme l’a défini René Nelli, ou « héroïsme sentimental » selon Roger Boase, l’asag est un essai, un test qui requiert de l’amant de passer la nuit dans l’alcôve, voire dans le lit, de la dame désirée dormant toute nue, sans passer à l’acte sexuel29. La réalisation d’un tel défi serait la preuve du mérite du prétendant à travers sa maîtrise de soi30. En revanche l’épreuve à laquelle Katherine soumet Gérard est d’un autre ordre. Il devait certes se montrer digne de son amour, mais sans réserve, qu’il s’agisse de discours ou d’action.
Ironiquement donc puisque Gérard réussirait son asag tout en échouant. Ce n’est pas par maîtrise de soi, ni par héroïsme amoureux qu’il ne s’approche pas de Katherine dormant trois nuits à ces côtés, non pas nue, mais certainement avec un sous-vêtement qu’il aurait suffi de regarder pour imaginer la femme dessous. Mais justement, c’est par l’aveuglement total de Gérard – et par aveuglement, l’on entend bien un renoncement aux idéaux mêmes de l’amour31 – qu’il parvient (sans aucune difficulté) à laisser Katherine intacte, et non en honorant les lois de l’amour pur ou en pensant à la réputation de l’objet de son désir. Au contraire, c’est d’un honneur égoïste et pour ainsi dire masculin dont il se soucie plutôt, après avoir appris la vérité : qui plus près du cueur luy touche, il a couché trois nuiz avec elle sans l’avoir guerdonnée de la peine qu’elle avoit prinse de si loing le venir esprouver. Il ronge son frain aux dens et tout vif enrage quand il se voit en celle peleterie32.
Mais revenons à ce lit dans la chambre de Gérard au Barrois. Quoiqu’il s’agisse en fin de compte d’un échange strictement spéculatif sur l’amour, la tension sexuelle est incontestable et vacille entre un érotisme hétérosexuel et un érotisme potentiellement homosexuel. Si seulement Gérard manifestait le moindre intérêt pour son roomate, il aurait pu être taxé, à ses yeux ou aux yeux du public lecteur de la nouvelle, d’une inclination homophile, mais en même temps, s’il le faisait, il se rendrait compte de sa féminité. Lectrices et lecteurs de la nouvelle envisagent donc les deux scénarios. Gérard va-t-il franchir le pas du tabou en tentant un attouchement/rapprochement avec Conrard33 ? Et en le faisant, Gérard et Katherine donneraient-ils libre cours aux délices de l’amour ? Qui plus est, quoiqu’au fond ce soit Katherine qui désire Gérard, c’est également Conrard qui le désire un peu, ne serait-ce qu’à un niveau fantasmatique. Au premier degré elle aurait voulu que Gérard la reconnaisse comme Katherine, qu’il soit sensible sinon aux traits physiques de son visage, au moins à sa voix34. Rappelons que la vue et l’ouïe constituent les deux premiers niveaux du gradus amoris, un topos du jeu de l’amour qui évolue de la rencontre jusqu’à l’accomplissement total de l’amour par l’acte charnel. Symboliquement donc, puisque Gérard ne parvient même pas à passer ces deux niveaux préliminaires, l’on est déjà averti de l’échec des niveaux ultimes.
Mais au deuxième degré, elle voudrait en quelque sorte que Gérard l’aime comme Conrard. Le choix de demeurer encore sous l’apparence d’un homme, tandis qu’elle avait la chance de se dévoiler, suggère que Katherine se complaît dans ce rôle de mâle et que les limites du gender se brouillent aussi pour elle35. Elle renforce sa petite expérience en passant de l’extérieur vers l’intérieur, de l’apparence (le déguisement) vers la mentalité (investissement dans la masculinité). Elle invente l’existence d’une femme aimée et introduit le topos de la beauté féminine comme éveil du désir. Il faut certainement lire les événements de la nouvelle selon ses deux dimensions, pragmatique et symbolique. Selon le récit de Katherine – le personnage ‘réel’ –, l’aveu d’un amour au Brabant n’est qu’un jeu de miroir qui reflète son amour pour Gérard, visant à provoquer en retour l’aveu de ce dernier. Selon le récit de Conrard – un personnage fantasmatique, qui n’existe pas vraiment en tant que tel –, l’aveu d’aimer une femme serait un jeu stimulant, qui pourrait indiquer potentiellement un désir refoulé pour les femmes36.
Michèle Perret reconnaissait une inclination potentiellement homosexuelle dans le personnage de la reine des romans médiévaux de transvestisme féminin, tombant amoureuse du chevalier qui est en effet une jeune femme déguisée37. Nous avons ici le cas inverse : non pas un personnage féminin qui tombe amoureux de Conrard/Katherine, mais Katherine/Conrard qui serait amoureuse/eux d’une femme imaginaire. C’est dans cette confusion d’identité « qu’il faut chercher une remise en question du clivage sexuel, une représentation plus nuancée de la différence des sexes38 ». Dans le cas de notre nouvelle, non seulement il/elle est envoûté/e pas de belles femmes39, mais par la suite, elle/il va un pas plus loin en acceptant la proposition de Gérard d’être présenté(e) à une autre femme, afin d’oublier la belle dame imaginaire de Brabant : Si ce n’estoit faulse[r] mon serment a ma dame, je le desireroye beaucoup, [ce dit Conrard ;] mais au fort j’essaieray comment il m’en prendra40. C’est peut-être le souvenir d’Yde – une travestie qui par miracle obtenait un pénis au moment de vérité, alors que ses noces avec Olive devaient être consommées –, qui vient à l’esprit de Katherine quand elle accepte le défi. C’est peut-être son désespoir exprimé cyniquement, ou encore une assimilation fantasmatique avec sa nouvelle masculinité imaginaire. Il reste que le prosaïsme de la réalité viendra frapper cette rêverie. En voyant l’alliance qu’elle a offerte à Gérard au doigt de sa nouvelle amie, elle retrouve son sang-froid. Elle en reprend possession et met fin à l’aventure, prenant dès le lendemain le chemin du retour vers le Brabant et vers Katherine.
***
La quête d’aventures, cela a été dit maintes fois, construit l’identité du chevalier qui s’y engage. Conçu à la mesure de l’idéal de masculinité, le voyage devient ainsi le rêve du jeune aristocrate aspirant, afin de gagner gloire et renommée, à visiter des lieux exotiques, à être vainqueur de confrontations dangereuses, enfin et surtout à goûter des amours merveilleuses. C’est bien rarement en revanche qu’on trouverait une femme en voyage et ce serait dans des circonstances moins avantageuses. Elle ne part pas pour chercher gloire, renommée et aventures, mais plutôt afin de fuir une situation épineuse, un père incestueux par exemple, espérant trouver un endroit sûr qui l’accueillera et lui fournira protection. Il pourra s’agir aussi d’un pèlerinage aux lieux saints pour cause d’infertilité ou de spiritualité. C’est la vulnérabilité féminine qui est alors mise en relief et remplace la prouesse masculine. Des mesures de précaution doivent être prises, comme la ceinture de la malmariée dans Guigemar ou le transvestisme de Katherine41. Chose surprenante dans le cas de Katherine : qu’elle soit femme ou homme, tous ses efforts pour éveiller le désir de Gérard, sont vains.
Comprenant l’échec de son aventure, Katherine rédige une lettre d’adieu, un dernier acte d’héroïsme courtois qui aurait dû, à l’instar d’une Didon, l’amener au suicide ou à la réclusion religieuse. Or, elle aussi a perdu ses illusions, elle retourne en Brabant et épouse celui qu’elle n’aime pas. Fin décevante pour les féministes modernes42. Le début de la nouvelle s’annonce comme l’histoire d’une femme résistante et courageuse qui défie les normes oppressantes pour sa sexualité. Mais au bout du compte, après toutes les aventures extraordinaires qu’elle a vécues, ces mêmes normes l’emportent. Katherine se défait de son apparence masculine, grâce à laquelle elle pouvait goûter à la liberté, pour redevenir une fille obéissante et accomplir « un retour à la norme43 ».
Le réalisme de la nouvelle et du recueil en général reflète encore une fois un monde matériel et patriarcal qui rejette l’idée de la fin’amor et de la fidélité, associée surtout aux fantasmes féminins. Mais en même temps qu’il le fait, il traduit également l’intérêt que pouvait avoir la société homoérotique, pour utiliser la terminologie de David LaGuardia44, à l’endroit de tels récits. Car ce n’est pas le résultat qu’il faut mettre en relief dans cette nouvelle, à savoir que les hommes, représentés par Gérard, ne sont pas vraiment intéressés par les valeurs chimériques de la fin’amor, et que les femmes représentées par Katherine demeurent obéissantes, ne peuvent que rêver d’être héroïques, et n’ont pas vraiment de choix. Ce qui retient l’attention est bien plutôt le fait que le narrateur, tout en subvertissant et parodiant les modèles courtois incarnés par le personnage de Katherine, se montre fasciné par les codes qu’ils véhiculent.