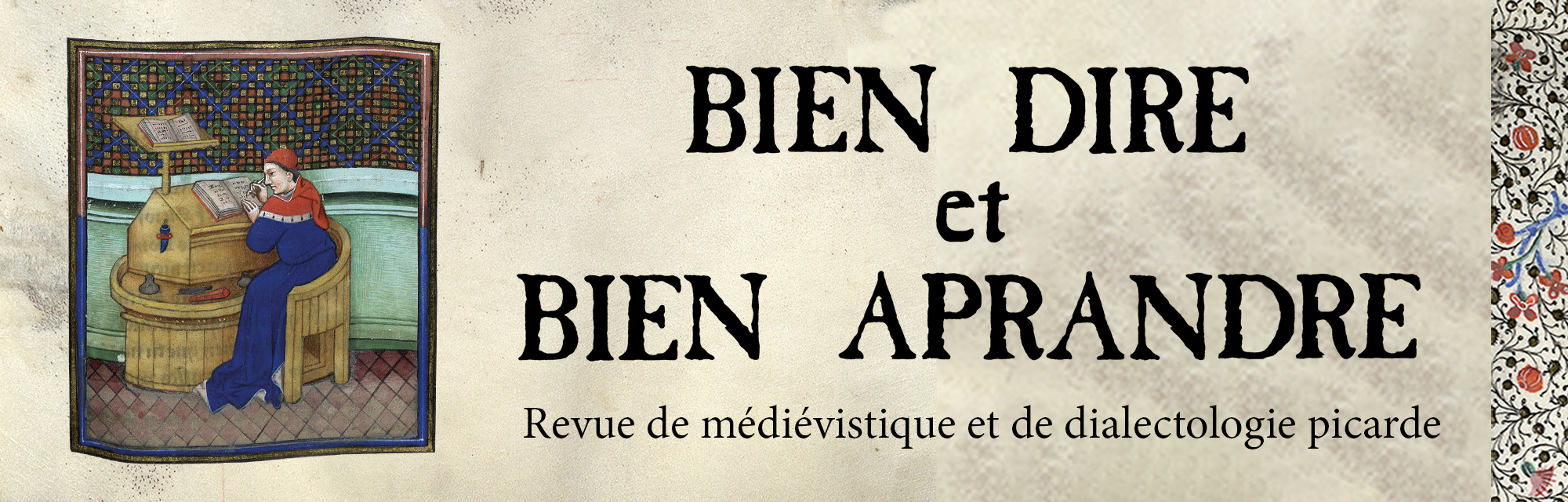O vous que j’aime ! ô toi que j’adore ! ô vous qui avez commencé mon bonheur ! ô toi qui l’as comblé ! Amie sensible, tendre amante, pourquoi le souvenir de ta douleur vient-il troubler le charme que j’éprouve ?
– Le Chevalier Danceny à madame de Merteuil
(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre CXLVIII)
Comment une dame sans nom, la dame des Belles Cousines, peut-elle avoir été ce modèle de maîtresse-femme qui, du Mariage de Figaro1 jusqu’à La Femme et le Pantin2, a servi de réservoir à l’imaginaire littéraire ? Comment est-elle ce modèle – ou cet anti-modèle – de femme de pouvoir qui, par ses stratagèmes, n’a rien à envier à la Marquise de Merteuil ?
La dame des Belles Cousines est bien cette énigme : une énigme féminine et une énigme littéraire à l’image de l’œuvre bourguignonne d’Antoine de la Sale qui lui donne corps en ce début de xve siècle. Ce texte au genre troublé, oscillant entre fabliau, nouvelle, roman de chevalerie, exemplum et épopée, est aussi un texte qui interroge le genre (genders3) : quelle place pour les femmes dans une société masculine qui édicte les codes et les usages4 ? Comment, pour elles, prendre le pouvoir ? Comment renverser la table ? Ce texte, dont le manuscrit a été signé de la main d’une femme, Marie de Luxembourg5, pose justement cette question – et justement par la table.
Car c’est à table que la dame des Belles Cousines va rencontrer pour la première fois Jehan de Saintré, ce petit page dont elle va se proposer de faire l’éducation amoureuse et curiale. C’est par la table que Jehan de Saintré va réaliser ses exploits dans un itinéraire où la commensalité s’est substituée au champ de bataille, révélant les enjeux de pouvoir d’une sociabilité bourguignonne dont les célèbres banquets ont marqué la puissance économique, militaire et imaginaire. C’est à la table de l’Abbé que la dame des Belles Cousines va rompre avec Jehan de Saintré, conduisant à la chute du roman.
Mise en débat, l’alimentation de cour est ce qui semble condenser dans Jehan de Saintré d’Antoine de la Sale la présence de la dame des Belles Cousines et son intercession. On sait l’importance de la table dans les cours européennes – qu’il s’agisse de la Chronique de Mathieu d’Escouchy, de la Chronique de Jean Lefèvre de Saint-Rémy, des Mémoires d’Olivier de la Marche, les témoignages historiographiques ne manquent pas, notamment en pays bourguignon6, pour témoigner de la centralité de la nourriture dans la dramatisation des liens sociaux –, c’est qu’elle focalise tous les regards7. La cour d’Anjou-Provence ne rompt pas avec ces pratiques. Quelques mois à peine séparent le célèbre banquet bourguignon (Banquet du Faisan, Lille, février 1454)8 de la rédaction du premier manuscrit (1456) de Jehan de Saintré. Pourtant, le roman témoigne du même vœu9 : le petit Saintré organise, à la veille du 1er mai, un bel et gracieux bancquet, qui sera d’entremelz et d’aultres nouvelles viandes assez, pendant lequel il fait porter le paon ; et lors les seigneurs, les dames et les damoiselles, les chevaliers et escuiers [firent] leurs veux10. La cérémonie des vœux du paon témoigne bien, par la fiction historique et littéraire, que la gastronomie participe de la ritualisation des actes et des codes, de la mise en scène de l’autre, de la représentation sublimée de l’espace commun. Elle est un moyen d’interroger la cour dans ses fonctionnements et dans ses rites, témoignant d’une culture des élites dont rend compte le roman. Mais aussi la place de la femme dans cette nouvelle culture gastronomique et curiale – non seulement comme un acteur mais aussi comme un promoteur de ses rites et de ses symboliques. Assise à la table des puissants, la dame des Belles Cousines est une figure statique. Pourtant, c’est elle qui orchestre les mouvements des hommes et qui les transforme – permettant, dans un jeu spéculaire de se laisser deviner dans leur ombre. « Deuxième sexe », la femme à table est bien celle qui révèle et celle qui est révélée par la table des hommes. Elle est cette convive du récit qui permet de révéler les dessous de table de cette cour bourguignonne où la dame des Belles Cousines préfigure Madame Bovary qui « étouffe dans son milieu d’apparat où tout se fait entre la messe du matin, l’inévitable dîner et les espices du soir11 ». D’Antoine de la Sale à Gustave Flaubert, la dame est ce double de l’écrivain qui engendre le texte et façonne l’itinéraire de ses héros. Si, pour Julia Kristeva, Jehan de Saintré est le premier roman moderne12, c’est qu’il est un roman de la décomposition des valeurs courtoises orchestrée par la dame, mais aussi celui de la recomposition littéraire autour d’une figure féminine tout à la fois mouvante et statique. Oxymore, la dame des Belles Cousines est ce manège scopique qui ne se donne à voir que dans ses mirages13 et qui éclaire les pratiques de cour par ses apparences et ses (dés)illusions.
La dame-manège
Que vos craintes me causent de pitié ! Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous ! & vous voulez m’enseigner, me conduire ! Ah ! mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi ! Non, tout l’orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l’intervalle qui nous sépare.
– La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre LXXXI)
Subtile est la composition de Jehan de Saintré d’Antoine de la Sale. Au premier plan : des hommes. Derrière eux une femme dont le héros masculin (et avec lui l’auteur) a volontairement effacé le nom. Personnage central du roman, elle est pourtant une femme anonyme. Mais cette femme de l’ombre est néanmoins celle qui dicte les règles : à commencer par les règles amoureuses puisqu’elle se donne pour objectif d’initier un jeune page aux arts de l’amour, de la table et de la cour :
le vray amoureux gentil homme [est,] a table, le plus honneste, en compaignie de seigneurs et de dames, le plus avenant, de ses oreilles [nul] villain escouter, de ses yeulz [nul] faulz regarder, de sa bouche [nul] deshonneste parler, de ses mains nul faulx serment ne atouchier, de sez piez, en nul deshonneste lieu aler14.
D’emblée le paradoxe est posé par Antoine de la Sale : le personnage sans nom15 a pour objectif de se faire un nom à travers celui du page élu pour réaliser ses projets, Jehan de Saintré. Elle est cette figure de pygmalion16 inversé qui engage déjà, dès le début du roman, vers les renversements successifs à venir. Centrifuge et centripète, la force de la dame des Belles Cousines repose non seulement sur une contenance sociale qui lui confère une dimension statique, mais aussi sur sa capacité à mettre en mouvement les hommes qui gravitent autour d’elle. Elle est, en ce sens, une « femme manège » dont l’identité ne peut être saisie que par l’évolution des acteurs de la commensalité qui sont dans son écosystème.
Son action se fait, en effet, inexorablement sentir sur les autres, à l’image de l’ascension de Saintré dont elle est l’instigatrice. Fine connaisseuse des liens hiérarchiques médiévaux, c’est par la table qu’elle va permettre l’ascension de Saintré – qu’elle rencontre d’ailleurs à table :
Madame, qui estoit assize au bas boult de la table du roy et de la royne, de adventure voit devant elles le petit Saintré […]17.
Jehan de Saintré est alors un page à la cour du roi dont la fonction est le service de table :
Lequel josvencel, par sa debonnaireté, vint en grace au roy, et tellement qu’il le voult avoir ; et, car il estoit encores bien josne, le ordonna a estre son paige, seullement aprés lui chevauchier, et le surplus servir en salle, comme ses aultres paiges enffans d’onneur. Lequel Jehan de Saintré, sur tous les aultres paiges enffans d’onneur, servoit ung chascun a table […]18.
Grâce à l’éducation de la dame des Belles Cousines, il va devenir échanson puis valet tranchant. C’est là encore la dame des Belles Cousines qui va décider de son évolution au sein de la hiérarchie médiévale, estimant qu’il est suffisamment âgé désormais (il a alors seize ans !) pour être promu dans le corps des offices de bouche :
Madame se appensa que il estoit ja assez grant pour estre hors de paige, car il savoit bien tranchier, que il fust varlet trenchant du roy ou de la royne, qui pourroit19.
Au comble de son ascension sociale, il va devenir un convive extrêmement prisé :
Et au .iiij.e jour le roy voult que la royne le feist convier, et les gentilz hommes de sa compaignie, tous a disner20.
Le roy et la royne, quant furent en leur hostel de Saint Pol descendus, lors le roy ordonne que la royne feist par ses maistres d’ostel prier le seigneur de Loyssellench et sa compaignie au soupper, et vault que Saintré y fust aussi21.
Et il va même jusqu’à être celui qui organise des banquets en invitant à son tour, à sa table, les puissants de ce monde :
Lors Saintré prinst congiet, et messire Enguerran avec pluiseurs chevaliers et escuiers retint au soupper, dont tout ce soir et pluiseurs jours aprés ne cessa le deviser de la beaulté et gracieuseté de Saintré et de tous les sciens22.
Saintré pria moult les seigneurs, ses conseilliers et aultres, celle nuit de soupper avec lui […]23.
La table – comme la dame – est ce levier d’évolution sociale. Mais elle est aussi le révélateur d’un jeu de dupes. Dans l’espace public, (le petit) Jehan de Saintré est celui qui éclipse les autres par sa connaissance des usages du (grand) monde. Dans l’espace privé, il est la marionnette de la dame des Belles Cousines qui l’instrumentalise pour réaliser ses rêves de pouvoir et d’ascension. Le héros dépersonnifié est bien le masque social de la dame et il dissimule tout autant qu’il éclaire celle qui agit dans l’ombre. « En » être ou ne pas « en » être, telle est la question de ces jeux d’inclusion et d’exclusion que révèle le roman sur le mode littéraire de l’appartenance – et avec elle, la dame.
Pour Antoine de la Sale, au service de la cour des Anjou-Sicile avant de rejoindre la cour de Luxembourg, la table est, bien sûr, le lieu du questionnement sur les apparences où le faire-savoir concurrence le savoir-faire, la parole l’acte24. La dame des Belles Cousines en est l’emblème. C’est à la table que la bouche orchestre les entrées et les sorties25 – sur le plan symbolique, certes, mais aussi sur le mode réaliste. Aussi la position sociale doit-elle être tenue, y compris lorsque la cour est itinérante. Le roi, en déplacement, ne se sépare pas de ses queux qui assurent le ravitaillement et les repas de la suite royale :
Et quant ilz orent tous disné, et les chevaulz bridez et tous troussez, la furent chevaliers et escuiers de la court du roy, de la royne, et de mesdiz seigneurs, et pluiseurs aultres, au nombre de entour mille chevaulz, tous venus pour le convoier. Lors il fait partir, tous les premiers, ses deux fourriers, ses queux et son chappellain […]26.
C’est toute une logistique de la bouche qui prend part à l’étiquette royale pour garantir, même hors du château, la hiérarchie des mets et des convives. D’ailleurs, c’est encore elle qui marque le rang de chacun dans l’organisation des banquets, ainsi qu’en témoignent les chroniques et conjointement le roman. Reproduisant la liste des invités, dans l’ordre de préséance, le texte dit assez le rôle de chacun dans une organisation sociale complexe :
puis convia seigneurs, dames et damoiselles, chevaliers, escuiers, bourgoiz, bourgoises de Paris, et aultres a planté27.
Et, de manière nouvelle, l’auteur y décrit la place et le rôle des femmes :
Que vous diroye ? Ad ce disner furent seigneurs, dames et damoiselles, chevaliers et gens d’estat, que de treslong temps ung tel disner n’avoit esté fait28.
Pourtant, même si les références historiques abondent dans Jehan de Saintré pour faire de la table un miroir de son temps29, le roman n’est pas une somme de realia. Car, comme le rappelle justement Daniel Poirion, « il n’y a pas de véritable mimésis, dans un roman historique comme Jean de Saintré, mais une falsification du contexte pour fabriquer un monde référentiel en trompe-l’œil30 ». Et si l’expression de « trompe‑l’œil » peut être entendue, dans Jehan de Saintré, dans son sens métaphorique, elle doit encore être comprise au pied de la lettre. Ainsi, la fin du roman va s’écrire en trompe-l’œil littéraire et amoureux pour renverser la table de la dame des Belles Cousines. Dans ce texte à double sens, la dame nourricière devient une dame blason31.
Le manège de la dame
Alors je commençai à déployer sur le grand théâtre les talents que je m’étais donnés. Mon premier soin fut d’acquérir le renom d’invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j’eus l’air d’accepter les hommages. Je les employais utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l’amant préféré. Mais, celui-là, ma feinte timidité ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde ; & les regards du cercle ont été, ainsi, toujours fixés sur l’amant malheureux.
– La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre LXXXI)
À l’image du service (commensal et amoureux), tout est à entendre à double entente dans Jehan de Saintré. Et, comme l’énonce la dame des Belles Cousines dès le début du roman, le bon du jeu ne fait que venir !32. C’est d’ailleurs sur ce registre de l’équivoque que commence la relation entre la dame des Belles Cousines et son jeune amant. Se déroule alors, sous l’égide de la dame des Belles Cousines, un dialogue privé/public autour des actes sociaux :
[…] endementiers qu’il portoit la tasse au vin de congié, Madame en passant lui dist : « Faittes comme l’aultre jour, petit Saintré. » Laquelle parole il entendi bien33.
La bouche de la dame, au centre des échanges, établit la frontière entre le dit et le non-dit, le dedans et le dehors. Outre un rôle alimentaire, sexuel et langagier, elle endosse une fonction sémiotique dans Jehan de Saintré pour engager un autre organe (partageant lui-même les trois fonctions énoncées ci-dessus) : l’œil34. Ainsi, la dame des Belles Cousines explicite au chapitre 32 le principe de communication de la bouche et de l’œil :
quant vous me verrez que d’une espingle je furgeray mes dens, ce sera signe que je voulray parler a vous, et lors froterez vostre droit oeil, et par ce congnoisteray que me entenderez, et a celle foiz y vendrez35.
De la bouche à l’œil, c’est un nouveau langage qui s’établit sur la base de codes parallèles. Particulièrement efficace, le procédé est signalé à de multiples reprises au commencement de la relation et du roman. Ainsi, les chapitres 33, 34, 37, 39, 40, 46, 54, 85, 127, 128, 131, etc., ne manquent pas d’avoir recours au code du signal qui joue à la fois comme « marque distinctive » mais aussi comme senhal, à savoir comme signature de la dame des Belles Cousines, domina de la parole privée et des sentiments de Saintré. C’est donc par le mimétisme amoureux que le jeune page répond à la communion muette de la bouche et de l’œil dans une cour qui focalise toute l’attention sur le regard et la parole :
Et en riant de ces parolles il fait a Madame son signal. Madame, qui bien congnut son parler, que ce fust pour l’aviser du couchier du roy avec la royne, ne fust pas sourde ne muette, car incontinent par son signal lui respondit36.
Autour de la table, tous les sens sont sollicités (sourde ne muette, vue et goût) comme préliminaires au toucher. Dédoublant le lecteur dans son initiation sémiotique, Saintré est placé en position d’observateur puis, ultérieurement lors de l’épisode avec damps Abbés, en position de voyeur. D’ailleurs, c’est par la translation œil-bouche ou pied-bouche que se marquera, à la fin du roman, la trahison de la dame des Belles Cousines puisque damps Abbés fait du pied à la dame des Belles Cousines, qui lui répond par un sourire et un clignement de l’œil :
Et, en ce disant, la guerre des piedz de l’un a l’autre estoit sans cesser. Et quant il vist Madame sousrire et guignoier, sceut bien que le gieu a Madame plaisoit37.
Ainsi, du service alimentaire au service amoureux, le roman garantit comme base de la relation interpersonnelle le service dans tout son spectre sémantique. Le terme étant issu du latin servitium, « condition d’esclave », c’est bien de servitude volontaire dont parle le roman en thématisant les relations amoureuses de Saintré et de la dame des Belles Cousines, magnifiées par les codes féodaux et courtois. Mêlant culte amoureux et culture religieuse, les actions de Saintré visent à honorer une dame élevée au rang sacré. Réactivant sèmes religieux et militaires, le service de Saintré le transforme en véritable serviteur… mais aussi en serveur. Si dès le xiiie siècle le terme service se spécialise dans « l’action, la manière de servir à table38 », il est celui que privilégie le roman pour rendre compte, par la table, de l’itinéraire amoureux, religieux et guerrier d’un jeune page servant à la table des puissants.
Ainsi, la bouche organise dans le roman le parcours narratif que suivra Jehan de Saintré dogmatiquement et… au pied de la lettre39 ! L’expression est à entendre de façon littérale puisque le roman met en scène Jehan de Saintré aux pieds de la dame des Belles Cousines, retranscrivant ses paroles dans des lettres d’armes dont il s’attribue l’énonciation. Maîtresse de la bouche, la dame des Belles Cousines orchestre les entrées et les sorties des actants qui, autour de la table, participent de la mise en scène d’une commensalité courtoise. Poussant jusqu’à ses limites les liens que les personnages entretiennent avec la nourriture, elle va même métamorphoser Jehan de Saintré en écuyer tranchant puis en tailleur de langue40. Elle-même suivra un itinéraire signifiant qui la mènera d’un état tel que a veue d’ueil toute seschoit tellement41 jusqu’aux débauches alimentaires de la fin du roman.
C’est justement dans cette dernière partie du roman, qualifiée de « fabliau » par la critique ou de « nouvelle », que va se révéler la dernière identité de la dame des Belles Cousines. Et là encore, c’est l’alimentation qui va jouer ce rôle d’identificateur. Damps Abbés, en offrant à la dame des Belles Cousines du gibier42, va lui permettre, selon la symbolique alimentaire43, de devenir celle qu’elle a toujours été. En incorporant ce gibier, elle devient en substance un chevalier qui s’alimente comme tel et qui pratique la chasse :
Que vous diroye ? Ne passa sepmaine de Karesme que, comme tresdevotte, ne allast […] priveement disner, bancquetter et soupper ; et, aprés son dormir, aux renars et aux texons, par ces boiz et aultres deduis, souventeffois chassier. Et par ainssi tout cet Karesme passa le temps joieusement44.
Le divertissement cynégétique45 – la chasse aux « bêtes noires » : renard et blaireau46 – est signifiant47 : le renard (et son avatar le blaireau), caractérisé par son intelligence, animalise Jehan de Saintré, lui-même piégé par la dame des Belles Cousines et par l’abbé. D’ailleurs, Maître Julien, émissaire de la Reine, ne manque pas de s’étonner de la nouvelle fonction chasseresse de la dame des Belles Cousines :
Madame […] fist haster le disner et lever les tables, puis incontinent s’en va en son hostel pour escripre la response, puis dist a maistre Julien : « Disnez, et incontinent a moi venez. » Damps Abbés, qui gracieux seigneur estoit, fist a maistre Julien tresbonne chiere et s’assist pour deviser, vis a vis de luy. Et entretant que il disnoit, vint a damps Abbés ung de ses braconniers, qui dist avoir destourné ung tresgrant cerf, acompaignié de dix ou de .xij. grans biches, pour veoir ung tresmerveilleux et bel deduit. Lors dist damps Abbé : « Je plains que Madame n’est yci, mais, a tout perdre, nous le attendrons a demain. – Et comment ? dist maistre Julien a damps Abbés, Madame va elle chassier voullentiers ? »48.
Et le gibier visé par la nouvelle partie de chasse ne manque d’ailleurs pas de surprendre : le cerf et les biches sont, en effet, les proies favorites de la chasse royale à partir du xive siècle, et cette prérogative ne s’applique ni au clergé ni à la (moyenne) noblesse. La mention de la chasse, sans cesse mêlée à la gastronomie, n’a de cesse d’interroger ici les personnages et le lecteur-spectateur sur une rupture sociale et culinaire. Loin du foyer royal, la dame des Belles Cousines édifie un nouveau foyer où règne le feu dans la salle basse et où la nourriture se fait magie49. Si l’abbé est le maître du temps, la dame des Belles Cousines devient la maîtresse des lieux en fondant, par un jeu d’inclusion et d’exclusions alimentaires, sa propre cour gastronomique. À sa compaignie, elle offre bonne chiere et à son équipage faing, advene et littiere a foison50 ; mais à ses especiaulx amis de court51, elle refuse toute chiere. Ainsi, la dame des Belles Cousines n’invite Julien de Broy qu’au spectacle de fin du dîner et à la levée des tables :
Il trouva Madame avec damps Abbés viz a viz a table a bien peu de gens […]. Car il n’avoit de celle journee beu ne mengié, Madame lui dist que dinast tost et vensist a elle52.
L’émissaire de la reine devra se contenter de disn[er] […] des parolles damps Abbé53. C’est bouche cousue que Julien observera le spectacle gastronomique donné par la dame – la mention étant reprise à demi-mot par le narrateur sur le mode satirique : Julien sy n’en dist mot, mais ja pourtant n’en pensa moins54. Le décrochage narratif s’opère par la mise à distance du signe et du sens ; d’où l’utilisation de l’euphémisme pour parler de l’hospitalité de la dame – Madame […] luy fist assez grant chiere de faire boire son vin55 – et d’où le ton satirique employé dans le texte : Et quant il eust disné et comprins des parolles damps Abbés ce qu’il luy pleust56.
Le personnage de Julien, qui préfigure celui de Jehan de Saintré, interroge bien le texte par ses propres interrogations. Et c’est la table qui symbolise dans le texte ce point focal pour dire le renversement des ordres symboliques par la dame puisque c’est par l’adéquation à ses rites sociaux ou bien par la transgression de ses codes que se réalise la fracture du texte. D’ailleurs, c’est sur le mode du manquement alimentaire que Julien fera son compte rendu à la Reine, soulignant ainsi le dérèglement à l’œuvre et dans l’œuvre par la table :
Lors lui compta comment […] il trouva Madame avec damps Abbés viz a viz a table a bien peu de gens, et comment il ly presenta ses lettres, lesquelles leues ne tarda gaires que a tresmatte chiere elle se leva et fist oster les tables […], et incontinent en son hostel s’en alla, et, car il n’avoit de celle journee beu ne mengié, Madame lui dist que disnast tost et venist a elle ; damps Abbés, qui gracieux seigneur estoit, aprés ses mains lavees, le fist asseoir et, pour lui tenir compaignie, devant lui s’assist ; et comment le braconnier arriva, qui porta la nouvelle des biches et du grant cerf, ou Madame devoit aller57.
Deux mois plus tard, le même procédé se répète lorsque la reine envoie un deuxième émissaire :
Madame, qui avecques damps Abbés devoit soupper, la sur les champs fist sa responce par escript […]. Lors le chevaulceur prinst congié sans boire et sans mengier et sans gaires aultre chose lui dire58.
La bouche vide des ambassadeurs royaux se remplit de la répétition du manque alimentaire et courtois. L’histoire du mauvais accueil se répète alors, entre chasses et repas. Et lorsque Saintré revoit la dame des Belles Cousines pour la première fois après de longs mois, il la trouve, après déjeuner, à la chasse son esprevier sur le poing, et ses troiz moisnes qui portoient les grans boutailles et le gardemengier pour raffreschir59. Transformés en queux, les membres du clergé n’officient plus pour la chaire mais pour la chère. L’ordre médiéval est bestourné par la dame qui a retourné la table. Pris aux rets de la dame des Belles Cousines, Saintré va faire l’expérience du spectacle comique de la table donné à ses dépens. Déréglée, la bouche dans ses usages sociaux et gastronomiques est ici d’autant plus signifiante qu’elle est doublement associée à la privation de carême et à l’excès gastronomique. Et même à la magie alimentaire de la dernière partie… Une pouldre de duc scande les repas du curé et de la belle dame :
Nous avons desjuné des tottees a l’ypocras et a la pouldre de duc60.
« Poudre composée de sucre blanc et de cannelle, destinée à être mêlée au vin formant la base de l’hypocras61 », elle combine encore des épices pour réchauffer l’estomac62 selon une recette bien mystérieuse pour Gilles Ménage qui, dans son Dictionnaire étymologique de la langue françoise avoue : « je ne sais ce que c’est que cette pouldre de duc63 ». Certes, la poudre de duc affiche ses vertus digestives mais aussi aphrodisiaques surtout lorsqu’elle constitue le seul élément de déjeuner avec les tottes a l’ypocras. Dans un tel contexte bacchique, la dame des Belles Cousines est non seulement celle qui anime le texte (la femme-manège), qui en est le stratège (le manège de la femme), mais aussi celle qui révèle la discourtoisie de ces abuzés en court64 qui fréquentent le grand théâtre du monde.
Prendre « congié »
Le marquis de ***, qui ne perd pas l’occasion de dire une méchanceté, disait hier, en parlant d’elle, que la maladie l’avait retournée, & qu’à présent son âme était sur sa figure. Malheureusement tout le monde trouva que l’expression était juste.
– Madame de Volanges à madame de Rosemonde
(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre CLXXV)
Le vin de congié, qui marquait, dans la première partie de Jehan de Saintré, l’intimité des couples par l’ellipse narrative65, devient un philtre dégradé : le vin herbé de Tristan et Yseult n’est ici qu’une boisson alcoolisée destinée à échauffer les sens66 ; le feu d’amours67 se métaphorise sous la forme sexuelle du dart, pour viser le dessous de table. De même, l’eau bénite du coucher des rois68 a disparu sur cette table érotisée chargée de vins. La satire est de mise dans un contexte discourtois et anti-moral.
La dame en est tout à la fois l’instigatrice et la révélatrice. En levant les voiles de la fiction sur la réalité triviale de la consommation alimentaire et sexuelle, elle s’est affichée comme celle par qui tout est arrivé, mais dont le nom ne mérite pas d’être consigné. Chassée de la cour comme de la fiction, la dame des Belles Cousines est bien cette comédienne d’une cour corrompue, femme sans visage pour le Moyen Âge ou défigurée au XVIIIe siècle. Elle est celle qui y a perdu son nom et même sa renommée. Si la dame des Belles Cousines clamait haut et fort au début du roman J’ay plus chier morir de fain que vouloir perdre ma bonne renommee69, le cycle s’est accompli. Le manège a continué de tourner. Et c’est peut-être là la satire la plus forte d’un roman désabusé sur les abusés justement. Si la dame des Belles Cousines a pensé être la maîtresse de ce jeu curial de dupes, elle en a été la victime (et, avec elle, Jehan de Saintré et l’Abbé). Comme d’autres après elle, elle a été son créateur et sa créature70, elle a été celle qui a pensé suivre les règles tout en édictant les siennes, elle a été son « ouvrage » mais aussi cet « ouvrage », ce livre écrit par des hommes pour parler de femmes pas comme les autres…
Mais moi, qu’ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m’avez-vous vue m’écarter des règles que je me suis prescrites & manquer à mes principes ? je dis mes principes, & je le dis à dessein : car ils ne sont pas, comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen & suivis par habitude ; ils sont le fruit de mes profondes réflexions ; je les ai créés, & je puis dire que je suis mon ouvrage.
– La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre LXXXI)