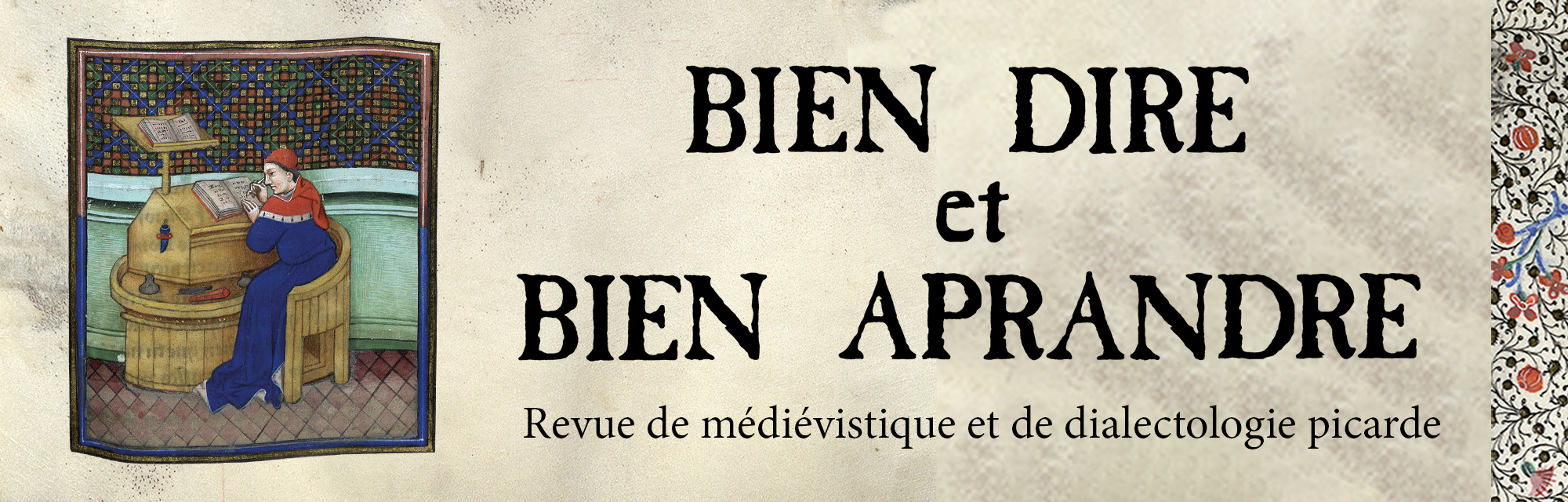Ains suis nette et pure, comme la rose entre les espines sans estre pointe1. Illustration d’un caractère exemplaire, d’un personnage pris entre deux feux – à savoir celui des obligations dévolues au monde de la prostitution et celui de la préservation de sa virginité –, cette phrase est représentative de Tharsie, fille du roi Apollonius, et touche le cœur de l’Histoire d’Apollonius de Tyr. Pour mieux comprendre l’intérêt que l’on peut porter à cette figure féminine, notamment à la cour de Bourgogne, il est essentiel de contextualiser quelque peu l’œuvre et d’en dessiner les contours.
Le roman d’Apollonius de Tyr connut une large diffusion en Europe et pendant plus d’un millénaire traversa les âges. Dès les ve‑vie siècles, des versions latines de cette histoire, l’Historia Apollonii regis Tyri, probablement issue d’une hypothétique source grecque datant du iiie siècle, rencontrèrent leurs lecteurs. Cette époque correspond probablement à la période où le remaniement latin servant de modèle nous est parvenu ; ce dernier a donné naissance à une soixantaine de manuscrits datés des ixe et xe siècles. Durant tout le Moyen Âge, ce texte subit grand nombre de fluctuations et c’est en France qu’il connut le plus vif succès. Il en existe huit versions françaises. Notons d’emblée un paradoxe : il est surprenant que cette œuvre, regorgeant de lieux communs de l’Antiquité, ait pu obtenir tant de suffrages sur une période aussi longue2. Ce phénomène d’attraction peut s’expliquer par le fait que certains motifs mythologiques sont transposables et interprétables selon l’époque, s’ils ne sont pas remaniés ou supprimés3.
Aussi la présente étude se fonde-t-elle sur l’un des cinq codices de la version dite littérale4 de l’Histoire d’Apollonius de Tyr qui échut à la cour de Bourgogne, car cette version littérale constitue une traduction fidèle du texte d’origine en latin ; le manuscrit étudié est le ms. Bruxelles, KBR, 9633, qui fut exécuté pour Jean de Wavrin dans les années 1453‑14605. Les chercheurs ont démontré que la mythologie avait connu un fort regain d’intérêt dans ce milieu culturel6. Ce roman peut être également apprécié pour ses accents hagiographiques puisque Tharsie est la figure même de la sainte prostituée. La jeune fille naît en mer dans des circonstances funestes ; son père la confie alors à des pairs de Tarse, Stragullon et Denise, et disparaît pendant quatorze ans. Tharsie grandit et croît en beauté et en sagesse. Par jalousie, Denise envoie son serviteur Theophile la tuer au bord du rivage. Au moment où il va la frapper, la jeune fille est ravie par des pirates, vendue aux enchères et envoyée au bordel à Mytilène. Les épisodes se centrent ensuite sur les assauts successifs des clients au lupanar. À bien des égards, les épisodes de la vie de papier de Tharsie peuvent être comparés à diverses vies de saintes bien connues de la production littéraire de la cour de Bourgogne, si l’on considère les ouvrages hagiographiques gravitant dans cette sphère, nous songeons entre autres à La Légende dorée ou encore au livre Vie et miracles de Nostre‑Dame7 et à la Vie de Sainte Katherine8 de Jean Miélot.
Sans nous borner aux représentations mythologiques, nous proposerons une lecture orientée vers l’hagiographie en nous centrant sur cette figure féminine ambivalente qui offre une lecture stimulante pour les contemporains du texte en reflétant un idéal féminin d’exemplarité.
Tharsie : un personnage tenant de la légende ?
Questions préliminaires
Comme nous l’évoquions précédemment, le texte a plu au xve siècle car les lecteurs bourguignons – faisant abstraction des représentations mythologiques – ont reconnu des modèles dignes d’être imités. Dans Les Légendes hagiographiques d’Hippolyte Delehaye, ce phénomène est nommé « survivance païenne9 ». Par cette expression, le savant belge entend des éléments transférables du culte des dieux et des héros au culte des saints car les deux religions se ressemblent dans leurs manifestations et par leur esprit.
À titre d’exemple, une étude menée par Élisabeth Pinto‑Mathieu a établi des rapprochements convaincants entre l’Historia Apollonii regis Tyri et la vie de Marie‑Madeleine pour révéler une influence du roman sur la vie de cette sainte10. Cette réflexion laisse en suspens deux questions : si l’on prend pour acquis qu’à l’époque du texte latin ce dernier a pu inspirer des épisodes d’une hagiographie, Apollonius de Tyr a‑t‑il pu influencer d’autres vies de saintes ? Les Bourguignons du Moyen Âge tardif connaissaient‑ils par ailleurs cette relation lointaine entre les deux textes ? Il serait difficile de prouver qu’Apollonius de Tyr a pu impacter de manière significative d’autres vies comme celles de sainte Agnès et de sainte Agathe, même si l’un des épisodes, celui de la vierge conduite de force au lupanar, les réunit. De même, aucun argument ne nous permet d’avancer que la cour de Bourgogne ait eu connaissance de cette parenté entre les deux écrits. Dès lors, les analogies visibles entre des textes hagiographiques et la vie de Tharsie suggèrent plutôt l’attachement à des modèles de vertu et marquent le poids de l’imagination populaire.
Dans ces conditions, sondons le personnage de Tharsie pour vérifier si elle peut s’inscrire dans la légende.
L’héritage d’un capital d’exemplarité
Tharsie fait partie d’une longue galerie de personnages de femmes persécutées communes aux romans chers à la cour de Bourgogne11 ; enlevée par des pirates et mise en vente parce qu’elle est vierge, elle peut être assimilée à une martyre.
Comme dans tout récit hagiographique, l’accent est mis en premier lieu sur les origines du futur saint et sur les qualités qui lui permettront de surmonter les supplices à venir. Aussi le récit écourte-t-il l’enfance de Tharsie par le biais d’une ellipse qui fournit les seules données utiles sur la jeune fille, à savoir son éducation : […] en l’aage de cincq ans fut envoyee a l’escolle pour apprendre les ars liberaux. Ensuite, une nouvelle ellipse nous mène aux quatorze ans de Tharsie et à la mort de sa nourrice Liqueride. Avant de rendre l’âme, cette dernière apprend à la jeune fille toute son histoire personnelle et la véritable identité de ses parents, et lui confie la mission de racompt[er] publicquement devant les citoiens [se]s aventures toutes à côté de l’ymage de son père en la place du marchié12. L’expression racompter toutes ses aventures ou sa variante racompter toutes ces choses ponctue l’ensemble du récit13. Elle est remarquable parce que, d’une part, elle marque le devoir de perpétuer l’histoire de sa famille et parce que, d’autre part, elle est uniquement employée pour deux personnages, Apollonius et Tharsie. Tharsie hérite donc des dons de conteurs de son père, Apollonius, qui tire de son nom même sa figure de poète. Ce don d’éloquence est l’une des principales armes de défense et de guérison dont use la jeune fille au lupanar.
Le passage suivant insiste sur les activités de Tharsie et sur leur fréquence depuis la mort de Liqueride :
Aprés peu de temps la pucelle retourna a l’estude et, quant elle estoit retournee a l’estude, elle ne buvoit ne mengoit jusques a ce que alast ou lieu ou sa nourrice estoit enterree et qu’elle aroit racompté en plourant toutes ses aventures. Et comme elle feist souvent ainsi [...]14
Ce rythme régulier qui structure les journées de Tharsie n’est pas sans rappeler les occupations de la Vierge Marie et des jeunes vierges dans La Légende dorée qui alternent entre prière et travaux manuels avant de se nourrir15. Comme elles, Tharsie respecte son engagement auprès de sa nourrice et, après ses études, accomplit son devoir de mémoire avant de se substanter.
Cette exposition permanente du personnage sur la place du marché la met dans une position délicate. Les citoyens de Tarse comparent Tharsie avec la véritable fille mal gracieuse de Denise et insistent a contrario sur la beauté exceptionnelle de la jeune fille. Cette beauté extérieure, héritée de sa mère, reflète de surcroît la beauté de son âme. Tharsie est définie par sa virginité et son innocence. On relève ainsi à diverses reprises lors de situations critiques des termes qui accentuent le caractère virginal de la jeune fille16. Dès sa première rencontre avec Leominus, le houllier de Mytilène, la jeune fille est prête à tout pour préserver son corps ; elle le prie donc instamment d’avoir mercy de [s]a virginité et de ne pas être mise a tel vieuté et a telle ordure17. Ce comportement exemplaire rappelle celui de sa mère qui avait demandé à deux reprises aux médecins chargés de l’examiner lors de son réveil à Éphèse de ne pas la toucher deshonnestement18. La mère de Tharsie décide ensuite de consacrer sa vie à la déesse Diane, recluse dans un temple ; elle devient prêtresse et fait vœu de chasteté en compagnie de plusieurs vierges. La dame est dans le roman assimilée à la déesse elle‑même et la description des habits et pierreries référant au culte de Diane la chaste renvoient pour le lecteur du xve siècle aux attributs du culte marial19. La déesse Diane et Marie semblent interchangeables, ce qui fait de la mère de Tharsie un modèle de chasteté et de sainteté. Tharsie, qui hérite de ses qualités, est alors vouée à devenir une femme vertueuse et sainte.
Enfin, la sainteté de la jeune héroïne se manifeste par la capacité à susciter la malveillance de ses proches. Dans un ouvrage portant sur les saints au Moyen Âge, Régine Pernoud énonce les caractéristiques de la sainteté en ces termes : « elle se présente comme un absolu qui provoque l’agacement, puis l’hostilité de son entourage ; et, pour celui qui en est porteur, une exigence qui l’amène à lui donner plus d’importance qu’à sa propre vie20 ». La grâce de Tharsie amène Denise à agir à son égard aussi comme forsenee, et très vite la jalousie et la convoitise laissent place à un complot d’assassinat afin de vêtir sa propre fille des aournemens de Tharsie21.
En somme, Tharsie est victime de sa nature : son exemplarité manifeste, héritée de ses deux parents, déclenche l’hostilité de Denise et la conduit à mettre en jeu sa réputation.
Tharsie compromise
Pour accomplir l’assassinat de Tharsie, Denise envoie son serviteur Theophile au bord du rivage. Mais avant de mourir, Tharsie obtient de Theophile le droit de recommander son âme à Dieu. Cette prière à Dieu lui permet d’être temporairement sauvée ; en effet, en réponse à sa prière, des larrons de mer accostent près des deux personnages et sauvent la pucelle en peril de mort. Ce sauvetage d’une demoiselle en détresse pourrait à première vue paraître comme un acte noble ; en réalité, il n’en est rien car les pirates considèrent la pucelle comme leur proye et comme une source de profit. Par ailleurs, le rapt revêt une signification particulière au Moyen Âge : l’enlèvement d’une personne, qui est souvent suivi de violences physiques, se rapproche indéniablement du viol22. Cet épisode annonce donc le destin proche de Tharsie : la vente de sa chair et de sa virginité.
Plus tard, lors de la mise aux enchères de Tharsie à Mytilène, deux personnages se battent pour obtenir la jeune fille : le houllier Leominus et le prince Anathagoras. Pour le premier acheteur, le motif invoqué pour acquérir Tharsie est, comme pour les pirates, qu’il s’agit d’une pucelle. Dans le monde de la prostitution, il est plus facile de faire commerce de corps frais : Tharsie a alors quatorze ans ; cet âge est idéal pour faire une carrière plus longue dans le métier et donc pour ramener plus d’argent au souteneur. D’autres éléments textuels viennent corroborer la cupidité du proxénète : Leominus est qualifié par deux tournures hyperboliques, il est tres convoiteux et tres aver ; il n’est pas touché par les larmes et les prières de la jeune fille à qui il déclare que prieres ne larmes ne prouffittent riens envers ung houllier23 ; il enferme Tharsie dans une maison bordeliere et, pratique courante dans la prostitution, il indique le prix de sa virginité sur une enseigne24, Quiconques vouldra violer Tarsie, il paiera demi livre d’or25.
Le second acheteur, Anathagoras, conçoit autrement cette acquisition ; dès la première parole du prince, l’accent est mis avant tout sur le plaisir sexuel masculin :
Et qu’ay je a faire d’estriver a ce houllier ? Je la lui laisseray achater et, quant il l’aura habandonnee, j’entreray le premier a elle et ainsi auray son pucellage26.
Le passage peut avoir deux significations : entrer a qq’un peut signifier ‘pénétrer chez qq’un’ et donc pénétrer chez Tharsie au bordel ; l’expression a également le sens à connotation sexuelle de ‘pénétrer qq’un’. Dans la mesure où le discours d’Anathagoras se prolonge avec la volonté de déflorer la jeune fille, auray son pucellage, l’on peut supposer que les deux sens se complètent et que le fait de réussir à pénétrer chez la demoiselle laisse entendre que sa virginité sera prochainement compromise.
De même, lorsque le souteneur du lupanar est enragé d’apprendre que la préservation de la virginité de Tharsie lui fait gagner plus d’argent que les services rendus habituellement par sa maison, il demande à son villain de la compromettre et de lui oste[r] le veu de virginité27. Néanmoins, aucun des prétendants n’arrive au résultat escompté avec Tharsie.
Par les vertus héritées de ses parents et par la mise à l’épreuve au lupanar, la jeune vierge Tharsie vit des situations semblables à celles des récits hagiographiques d’Agnès et d’Agathe28, ce qui fait d’elle une sainte et un personnage de la légende.
Tharsie : une prostituée ?
Une courtisane de luxe
Bien que Tharsie puisse à juste titre être assimilée à une sainte, la jeune fille peut également entrer dans une autre catégorie de personnages, à savoir celle des prostituées, dans la mesure où elle remplit avec brio ses offices au lupanar. En effet, Tharsie revient à chaque entrevue avec tresgrant quantité d’argent qu’elle remet au proxénète : tout d’abord, le prince Anathagoras lui offre .xl. flourins ; puis, un ami du prince lui donne une livre d’or entierement29 ; enfin tous ceux qui entrent à l’intérieur de la maison la rémunèrent à prix d’or. Pourtant, le travail effectué par Tharsie ne correspond pas à la vision traditionnelle de la prostitution et le désir des clients est assouvi sans passer par l’acte sexuel. Chaque entretien avec le client respecte la même procédure : dans une première phase, l’homme entre, Tharsie ferme la porte, s’agenouille à ses pieds et lui raconte l’histoire de son lignage ; dans la seconde phase, après le récit, le client ne désire plus la toucher, la paie dûment en retour et conserve son secret. Les lecteurs n’ont pas les détails du récit conté par la jeune fille, ce qui rend expéditifs les divers passages des clients. Le travail de Tharsie consiste donc à discuter avec le demandeur ; sans parvenir aux fins envisagées, le client écoute les aventures de la jeune fille, s’en satisfait et la rémunère pour son exemplarité.
Par ailleurs, en payant son loyer, Tharsie provoque son employeur à deux reprises par l’ironie en mettant en avant la préservation de son corps : Tiens, vecy le pris de ma virginité et Veéz cy que oncques ma virginité n’a peu faire30. Ces exemples permettent d’envisager une catégorie de travailleuse plus respectable pour Tharsie, mais néanmoins voisine du métier de prostituée, celle de la courtisane de luxe. La courtisane se définit par la difficulté à être conquise et par sa maîtrise de l’éloquence et de la musique31 ; elle peut être considérée comme une enchanteresse qui fait fructifier les affaires du proxénète grâce à ses talents oratoires. Tharsie correspond à cette figure car Anathagoras a d’abord voulu l’acheter précisément parce qu’elle estoit noble et sage. Ensuite, dans un autre extrait, Tharsie passe un accord avec le serviteur de Leominus en insistant sur son potentiel intellectuel : elle est capable d’une part de divertir un public en jouant de la harpe et en contant ses aventures, et d’autre part de résoudre par ses connaissances n’importe quelle énigme qui lui est posée. Le peuple prend en charge la dette de Tharsie et lui donne pour cela une tresgrant somme d’argent32. Il est intéressant de souligner que Tharsie propose d’elle‑même cette solution au serviteur ; elle a l’idée de jouer de ses charmes à la fois pour gagner de l’argent et pour rester vierge : sainteté et prostitution se confondent alors au sein du personnage.
D’autres agissements de Tharsie sont plus ambigus et la rapprochent davantage de la courtisane. Lorsque le père de Tharsie revient à Tarse, Denise et son mari lui font croire que sa fille est morte. Désespéré, Apollonius embarque sur son navire et après une tempête son embarcation dérive jusqu’au port de Mytilène. Il s’installe seul en fond de cale et exige qu’on le laisse mourir. Pour sauver Apollonius, Anathagoras va quérir les services de Tharsie pour le conforter et lui propose de l’argent pour mieulx vacquer a [s]a virginité garder33. Il n’est pas rare dans la réalité qu’un seigneur aille chercher une musicienne chez le proxénète pour distraire des invités en échange d’une compensation financière. Néanmoins, Tharsie a un comportement surprenant. Après un premier essai qui reste vain pour faire quitter le fond de cale à Apollonius, elle abandonne sa mission, accepte les deux cents florins d’Apollonius et s’en va34. Anathagoras intervient alors et la jeune fille retourne accomplir son travail pour obtenir plus d’argent du prince de Mytilène. Par ailleurs, Tharsie a des gestes affectifs plutôt équivoques envers un homme qu’elle ne connaît que depuis peu : elle mist son chief sur lui et l’embraça estroittement35. De surcroît, lorsque la jeune fille prend la main d’Apollonius pour qu’il la suive, l’homme la frappe du talon et la pucelle cheÿ a terre et commença a seigner du genoul36. Michel Zink et Jean Scheidegger ont rapproché ce saignement de genou de l’inceste évoqué au début de l’Histoire d’Apollonius de Tyr37. Apollonius avait résolu l’énigme pour obtenir en mariage la fille du roi incestueux d’Antioche. Ce saignement est apparenté ici à un viol, d’autant que ce moment succède à une phrase ambiguë de Tharsie : Se tu desires ta fille, espoir que tu la trouveras saine et haittie38. Tharsie ignore être la fille d’Apollonius et le père est résolu à croire à sa mort. Cette phrase peut être allusive et renvoyer à un inceste39. De même, le motif de l’inceste est sous‑jacent lorsque le texte mentionne qu’Anathagoras amoit Tharsie comme sa propre fille40 et que l’on apprend plus tard qu’il l’épouse41.
Une prostituée « honnête »
Si quelques‑uns de ses agissements sont ambigus, Tharsie peut néanmoins être considérée comme une « prostituée honnête ». Par cette formule, nous entendons que Tharsie exerce, grâce à sa beauté et les divertissements et chansons qu’elle propose, une sorte de thérapie sur l’âme.
Lors des spectacles en plein air, deux expressions démontrent que Tharsie est une figure de tendresse : attraire a amour et attraire en son manoir et amour42. Ces termes renvoient au siège des émotions, siège que Tharsie arrive à atteindre par [s]on beau parler. Grâce à sa clergie, elle devient une figure de consolation et elle réussit à ramener Apollonius à la lumière car elle est sage et parle tres doulcement43.
L’honnêteté de Tharsie est également prouvée lorsqu’Anathagoras requiert la main de la jeune fille à Apollonius. Anathagoras explique que la fille est demouree vierge par [s]on aide44 ; Tharsie n’a exercé ses talents que pour conserver sa virginité. Sa fama est donc intacte et le mariage lui permet de rompre avec les mœurs dissolues du monde de la prostitution.
En fin de compte, Tharsie se situe entre la femme publique et la femme savante45 ; elle est une femme qui maîtrise la parole et qui sait par son éloquence aller droit au cœur. Cette position apparaît comme un compromis entre prostitution et sainteté. À travers la figure ambivalente de Tharsie, semblable à celle de Marie‑Madeleine, le motif de la prostitution est détourné pour créer un récit édifiant.
Une hagiographie de Tharsie : un récit édifiant
Plusieurs épisodes de la vie de Tharsie dans l’Histoire d’Apollonius de Tyr peuvent constituer la trame d’un récit hagiographique, comme le montrera le rapprochement avec deux œuvres appartenant au milieu culturel de la cour de Bourgogne. Le premier récit hagiographique qui nous servira de support pour la comparaison est la Vie de Sainte Katherine de Jean Miélot tirée du ms. Paris, BnF, fr. 6449 daté de 145746.
Dans le récit, lorsque le lignage incomparable de Katherine est présenté, la jeune fille est comparée à une rose que l’on peut voir flourir entre les espines et de laquelle devoit yssir une fleur de liz47. Cette comparaison n’est pas sans rappeler la manière dont se définit Tharsie dans sa chanson pour Apollonius. Dans les quatre premiers vers de l’insertion lyrique, la métaphore de la rose sans épine est employée :
Je vois par ordures, / Mais point ne suis entachee d’ordure, / Ains suis nette et pure, / comme la rose entre les espines sans estre pointe48.
Dans les deux exemples, la virginité est mise en exergue. La rose est un symbole de pureté et de régénération ; les épines représentent le monde ordurier dans lequel les jeunes filles sont contraintes d’évoluer. Les deux personnages sont exemplaires par leur innocence et se rapprochent de la figure mariale. Dans le cas de Katherine, la pureté passe par la métamorphose de la rose en fleur de lys ; pour Tharsie, elle est démontrée par la lutte pour la préservation de son corps au lupanar. Tharsie et Katherine sont toutes deux gardiennes de leur virginité ; elles sont deux vierges innocentes.
Lors de sa détention à Alexandrie, l’empereur Maxence veut obliger Katherine et les Chrétiens à aourer les sacrefices prophanes49. Quant à Tharsie, dès son arrivée au bordel, Leominus lui ordonne d’aoure[r] le dieu Pryapus50. Katherine s’oppose à l’empereur et Tharsie résiste au proxénète. Les deux jeunes filles se défendent par la parole. Lors du débat organisé par Maxence entre Katherine et cinquante docteurs, Katherine a réponse à toutes les questions des savants. Deux extraits marquent les effets que produisent les paroles de la jeune fille sur les docteurs51. Les expressions esperdu, tourbléz et confus, se rendirent muyaulx, confus et vainquu ou encore en esbahissement et en admiration que nous ne sçavons du tout en tout riens dire mettent en évidence le sentiment de confusion et de surprise que provoque l’éloquence de Katherine : les docteurs perdent la capacité de s’exprimer et décident de se convertir. Dans Apollonius de Tyr, on retrouve des expressions similaires lors du passage des clients chez Tharsie : après le conte de Tharsie, Anathagoras est tout confus et piteux, meu de pitié et pleure ; le serviteur est meu de pitié ; les autres clients pleurent à tour de rôle52. Un autre personnage réagit différemment : Apollonius gémit53. Ce détail différencie les deux personnages : Tharsie réinitie Apollonius au langage et essaie de l’amener à reprendre sa place de roi ; Katherine convertit les docteurs qui n’ont plus d’arguments valables à répondre. Cependant, les deux épisodes mènent à un sauvetage de l’âme. Apollonius suit en quelque sorte un parcours de guérison en procédant à des rites au lieu comme les croyants pouvaient le faire lors de pèlerinages. Les conditions sont les suivantes54. Le pèlerin doit être en rupture avec le quotidien : Apollonius est à fond de cale à Mytilène. Il doit s’en remettre volontairement ou non à des mains plus puissantes que les siennes : Anathagoras lui envoie Tharsie qui connaît toutes les réponses. Des rites propitiatoires comme le contact avec la statue d’un saint sont effectués pour obtenir une guérison : le contact avec la main de Tharsie fait réagir violemment Apollonius et c’est cette réaction virulente qui lance la complainte de la jeune fille sur ses origines et ses aventures malheureuses. En reconnaissant sa fille, le père pleure de joie ; ses larmes sont le symbole de la purification de son âme et le signe de son rétablissement social progressif. Ce phénomène s’appelle la liesse de guérison55. L’éloquence est donc l’apanage de Katherine et de Tharsie.
L’épisode du miracle de Theophile dans Vie et miracles de Notre-Dame de Jean Miélot56 est le second texte qui peut servir de comparaison avec notre récit pour démontrer l’assimilation de Tharsie à la Vierge Marie. Dans le texte de Miélot, Theophile est un vicaire qui qui voue sa vie à Dieu avec assiduité ; après avoir été destitué de ses fonctions par un évêque, il vend son âme au diable pour récupérer ses biens et recouvre la foi en se repentant auprès de la Vierge Marie. Dans Apollonius de Tyr, le nom de Theophile est donné au serviteur de Denise et de Stragullon. Avant l’épisode du rapt de Tharsie, Denise contraint Theophile à tuer la pucelle et lui propose en échange la liberté. Toutefois, le serviteur ne peut se résoudre à tuer une vierge innocent et il est dolent et triste57. Dans la légende de Theophile, le personnage regrette ses actions. Or, la repentanche et le repentir58 sont également prégnants dans Apollonius de Tyr. Dans le miracle, Theophile n’est pas abandonné par Dieu qui reconnaît en lui un ancien serviteur loyal, induit en erreur par les mauvais conseils du diable ; la Vierge Marie lui pardonne progressivement sa mauvaise conduite. Dans Apollonius de Tyr, Theophile prend Dieu à témoin lors du rapt de Tharsie et se réjouit de ne pas avoir commis le meurtre commandité par Denise, figure du mal. Le personnage entame une rédemption qui sera accomplie par l’intercession de la vierge Tharsie. Lors du jugement de Denise par Apollonius et par sa fille à Tarse, Theophile est placé dans la situation du condamné sauvé miraculeusement au moment de l’exécution. Tharsie pardonne pleinement au serviteur ses mauvaises actions parce qu’il lui a révélé le nom de la conspiratrice Denise ; mais la jeune fille a une autre raison de le sauver : aucun Tarsien ne l’a secourue et seul Theophile s’est montré charitable et l’a aidée en lui laissant le temps, l’espace de deux heures59, de recommander son âme à Dieu. La vierge Tharsie se comporte alors en dame et use de son pouvoir gracieux régalien60 envers un serviteur qui lui a été secourable.
Ainsi, à certains égards, Tharsie est proche de Katherine et de la Vierge Marie. Néanmoins, le récit de l’exemplarité de la jeune fille n’est pas construit pour aboutir à la foi chrétienne et à une conversion ; dans Apollonius de Tyr, il mène à une glorification du lignage de Tharsie et à une mise en valeur du pouvoir politique61.
Conclusion
La figure exemplaire de Tharsie est bien apparentée au fonds ancien d’archétypes féminins présents dans la littérature hagiographique du Moyen Âge. Tharsie ne pourrait pas être considérée comme une véritable sainte dans le siècle si son itinéraire de vie avait été un long fleuve tranquille, sans opposition, sans violence, sans mise à l’épreuve. L’ambivalence de ce personnage, à la fois prostituée et sainte, ne trouve sa complétude que dans l’amour et la lumière qu’il suscite : elle fait preuve de force morale et elle connaît le langage qui mène au cœur.
Il n’est guère surprenant que ce roman aux accents hagiographiques ait pu plaire à la cour de Bourgogne : Tharsie est la clef de voûte de l’Histoire d’Apollonius de Tyr et le récit édifiant de ses aventures met en relief toutes les acceptions du mot histoire. Ainsi l’histoire de la vie du personnage fonctionne pour les contemporains du texte comme un exemplum qui affiche ses ambitions didactiques et vise l’exemplarité.