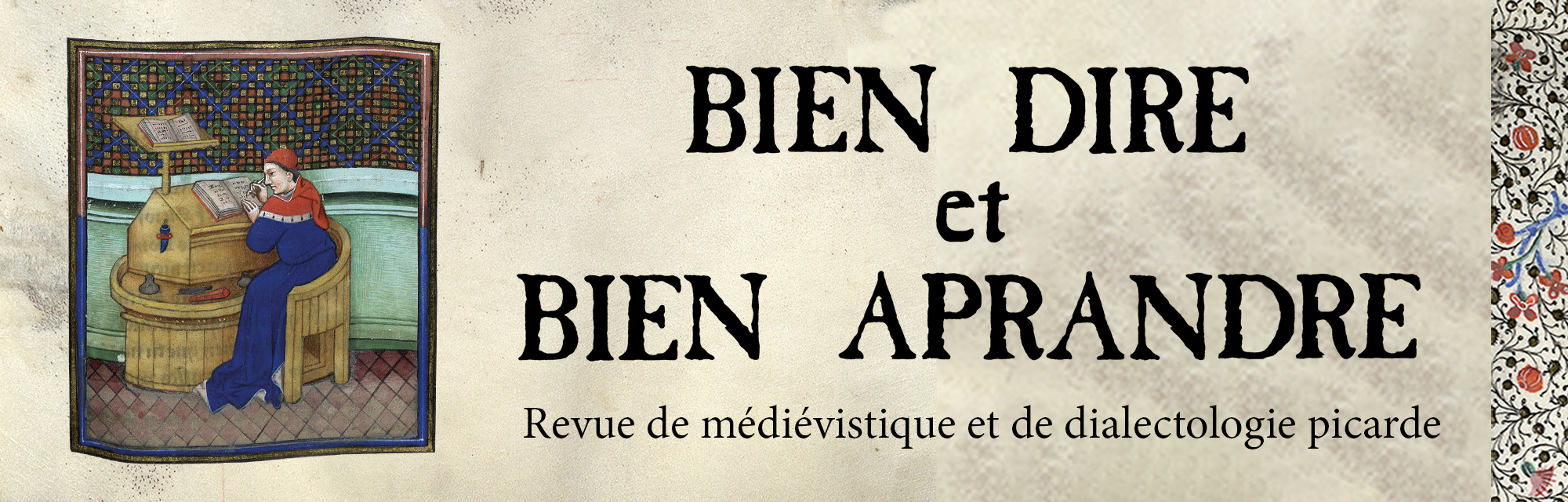Cet article a été écrit dans le cadre de mon post-doctorat dans le programme de recherches ERC Advanced Grant AGRELITA, « The Reception of Ancient…
Brill’s Companion to Episodes of ‘Heroic’ Rape/Abduction in Classical Antiquity and Their Reception, dir. R. Lauriola, Leyde, Brill, 2022.
L. Lahill, Les Enlèvements et le retour d’Hélène dans les textes et les documents figurés, 2 vol., Paris, de Boccard, 1955 ; B. Guthmüller, « Il…
M. Possamaï-Perez, L’« Ovide moralisé ». Essai d’interprétation, Paris, Champion (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge), 2006 ; Ovide moralisé, Livre …
F. Lecocq, « Europe "moralisée". Imitation et allégorisation », dans D’Europe à l’Europe, I. Le mythe d’Europe dans l’art et la culture de l’…
Il s’agit des vers 1-877 : cf. Ovide moralisé, poème du commencement du XIVe siècle, éd. C. De Boer, Amsterdam, Müller, 5 vol., 1915-1936, vol. IV…
L. Barbieri, « Les Héroïdes dans l’Ovide moralisé : Léandre-Héro, Pâris-Hélène, Jason-Médée », dans Les translations d’Ovide au Moyen Âge, dir. A.…
Cet aspect a été bien analysé par C. Croizy-Naquet, « L’Ovide moralisé ou Ovide revisité : de métamorphose en anamorphose », dans Lectures et usages…
Ovide moralisé, XII, v. 11-877, cf. Ovide moralisé, éd. C. De Boer, vol. IV, p. 231-254.
Les deux épisodes se trouvent aux fol. 71r° et 300r° dans le manuscrit de Rouen, aux fol. 27r° et 164v° dans celui de l’Arsenal. Les cycles d’…
C. Lord, « Three Manuscripts of the Ovide moralisé », The Art Bulletin, t. 57, 1975, p. 161-175 ; J. Drobinsky, « La narration iconographique dans…
Il s’agit des enluminures situées au fol. 71r° pour le manuscrit de Rouen et au fol. 27r° pour celui de l’Arsenal.
Les représentations d’Hélène se trouvent au fol. 300r° du manuscrit de Rouen et au fol. 164v° du celui de l’Arsenal.
Sur cet épisode cf. F. Clier-Colombani, Images et imaginaire dans l’Ovide moralisé, Paris, Champion (Essais sur le Moyen Âge), 2017, p. 161-164.
Toutefois, ces images restent minoritaires, cf. R. Blumenfeld-Kosinski, « Illustrations et interprétations », p. 72 : « Tandis que le manuscrit de…
Les deux images se trouvent aux fol. 72r° et 27v° respectivement.
K. S-J. Murray et A. Simone, « The Liminal Feminine : Illustrating Europa in the Ovide moralisé », dans Receptions of Antiquity, Constructions of…
Pour la diffusion de cette culture en Italie du Nord cf. Modernamente antichi: modelli, identità, tradizione nella Lombardia del Tre e Quattrocento…
Il s’agit des manuscrits suivants : Vienne, ÖNB, cod. 2571 ; Saint-Pétersbourg, NLR, ms. fr. F.v.XIV.3 ; Cité du Vatican, BAV, Reg. Lat. 1505 ;…
Les séquences consacrées à Pâris et Hélène se trouvent aux fol. suivants : Vienne, ÖNB, cod. 2571, fol. 29r°-31r° ; Saint-Petersbourg, NLR, ms. fr.…
Aux fol. 49v°-53r°.
L. Barbieri, « De Grèce à Troie et retour : les chemins opposés d’Hélène et Briséida dans le Roman de Troie », dans Philologia ancilla litterature…
Sur la production des Embriachi cf. M. Tomasi, Monumenti d’avorio: i dossali degli Embriachi e i loro committenti, Pise, Edizioni della Scuola…
M. Tomasi, « Miti antichi e riti nuziali: sull’iconografia e la funzione dei cofanetti degli Embriachi », Iconographica, t. 2, 2003, p. 126-145.
Seule l’Istorietta troiana a été éditée : Istorietta troiana con le Eroidi gaddiane glossate: studio, edizione critica e glossario, dir. A. D’…
Tel est le cas par exemple du manuscrit Florence, BML, Pal. 153 ; voir M. Tomasi, « Miti antichi e riti nuziali », p. 129 ; M. Cambi, L’Histoire…
Ibid., p. 134.
Ibid., p. 137.
Cf. J. Miziolek, « The Story of Paris and Helen in Italian Renaissance Domestic Paintings from the Lanckoroński Collection », Światowit, 2003, t. 5…
M. Tomasi, « Baldassarre Ubriachi, le maître, le public », Revue de l’art, t. 134, 2001, p. 51-60 ; J. Durand et M.-P. Laffitte (dir.), Le trésor…
J. Guiffrey, Inventaires de Jean duc de Berry, Paris, Leroux, 1894-1896, 2 vol., no 859, 873, 914.
Ces illustrations se trouvent aux folios suivants : 1r°, 24r°, 51r°, 67r°, 105r°, 126v°, 149r°, 166v°, 189r°, 207v°, 229r°, 251v°, 277v°, 301v°…
À partir de la seconde moitié du xive siècle, cette introduction connaît un grand succès et génère une iconographie spécifique qui est absorbée par…
Le manuscrit est consultable en ligne : https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/12420/canvas/canvas-1332024/view.
J. Drobinsky, « La narration », p. 234-235.
M.-R. Jung, La Légende de Troie en France au Moyen Âge : analyse des versions françaises et bibliographie raisonnée des manuscrits, Bâle, Francke…
Cf. les remarques de J. Drobinsky, « La narration », p. 227-228.
Ces images se trouvent aux fol. 40r° et 203r° respectivement.
Cette ligne sera également poursuivie dans les illustrations du ms. Paris, BnF, ms. fr. 137, élégant codex transmettant une mise en prose de l’…
François Avril a identifié le codex dans les inventaires des bibliothèques des deux princes : F. Avril, « Trois manuscrits napolitains des…
Les séquences d’enluminures dédiées à l’enlèvement d’Hélène se trouvent aux fol. 42v°-47v° dans le manuscrit de Paris, aux fol. 60r°-64r° dans le…
Boccace,« Des cleres et nobles femmes ». Ms. Bibl. Nat. 12420, éd. J. Barouin et J. Haffen, Paris, Les Belles Lettres, 1993.
M. Miglio, « Boccaccio biografo », dans Boccaccio in Europa, dir. G. Tournoy, Louvain, Leuven University Press, 1977, p. 149-163.
B. Buettner, Boccaccio’s De cleres et nobles femmes, Systems of Signification in an Illuminated Manuscript, Seattle et Londres, College Art…
E. Filosa, Tre studi sul De Mulieribus Claris, Milan, LED, 2012, p. 21-23.
Boccace, « Des cleres et nobles femmes », p. 40-41.
Ibid., p. 111-118.
Les images dédiées à Europe et Hélène se situent aux fol. 17v° et 50v° dans le codex fr. 12420, aux fol. 18r° et 51r° dans le ms. fr. 598 ; B. …
J. Guiffrey, Inventaires n° 940 ; P. De Winter, La Bibliothèque de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1364-1404). Étude sur les manuscrits à…
B. Buettner, Boccaccio’s De cleres et nobles femmes, p. 40.
R.S. Loomis et L.H. Loomis, Arthurian Legends in Medieval Art, New York, Modern Language Association of America, 1966.
L’actualisation du monde décrit dans le De cleres et nobles femmes par rapport au monde des lecteurs de la France de 1400 est commune aux deux…