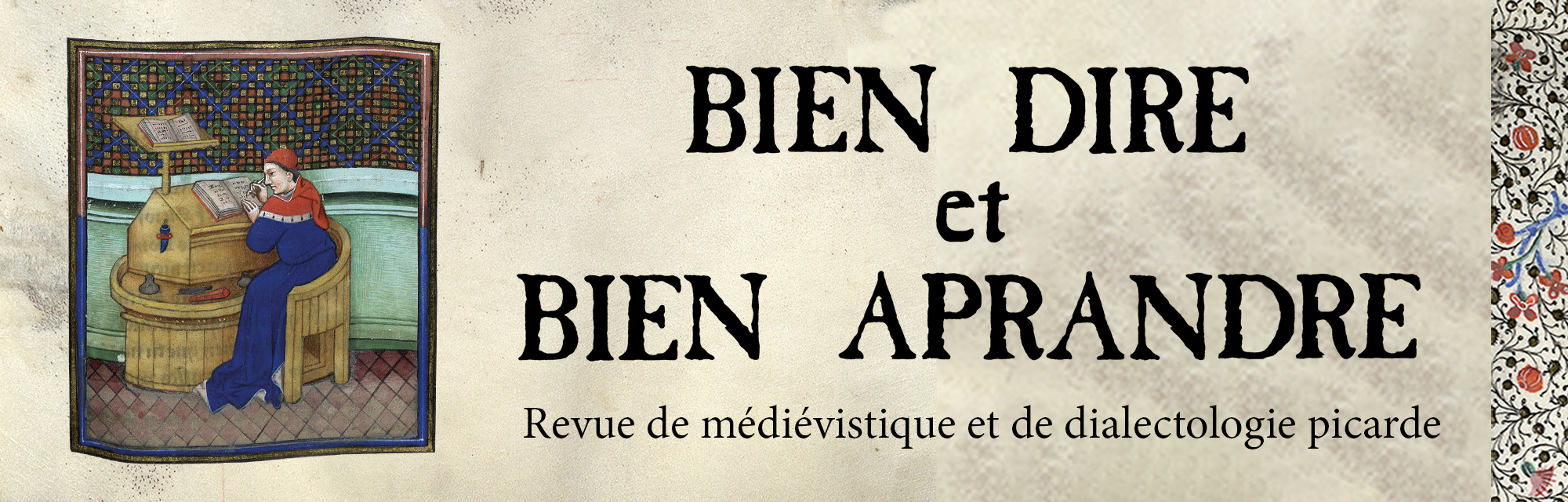Florence de Rome est l’adaptation épique du « conte de la femme chaste convoitée par son beau-frère1 », variante du conte folklorique de la femme persécutée2. Réputée dès sa jeunesse pour sa sagesse et sa clergie, Florence, fille unique d’Othon, l’empereur de Rome, représente une figure de souveraine exemplaire, héritière légitime du pouvoir, auquel elle accède pleinement à la mort de son père. Sa beauté exceptionnelle la rend victime des attaques répétées d’hommes fous de désir pour elle3 et c’est en gagnant un pouvoir de guérison miraculeux que la belle Florence peut rétablir l’ordre au sein du royaume et dans sa propre vie4. Florence de Rome a connu un remaniement en prose à la cour de Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon. À la demande de Jean V de Créquy, grand amateur de littérature chevaleresque, l’histoire de Florence est relatée à la suite du dérimage de Florent et Octavien5 dans une vaste compilation achevée en 1454 et intitulée Le livre des haulx fais et vaillances de l’empereur Othovyen6. La réécriture en prose de Florence de Rome s’effectue probablement à partir d’une source assez proche d’un premier remaniement « très libre7 » de la chanson primitive8, long de 4 562 alexandrins9, et que l’on peut dater « de la première moitié du xive siècle10 ».
En étudiant les points de comparaison et de divergence entre la chanson source et la réécriture, je montrerai que la figuration de l’héroïne éponyme témoigne d’un profond bouleversement dans l’art du portrait au sein du courant littéraire des mises en prose qui fleurit dans le creuset bourguignon au milieu du xve siècle. Les visages des femmes – selon le sens que recouvre le terme en moyen français – c’est-à-dire, leurs physionomies, leurs corps, leurs silhouettes –, pourtant décrits en détail et individualisés dans les textes sources, s’effacent dans les réécritures en prose au profit de clichés descriptifs mettant en exergue une image de la perfection féminine, tant physique, morale qu’intellectuelle, participant de l’idéalisation des héroïnes romanesques à travers des figures de saintes dans le siècle.
***
Il est peu aisé de déterminer où débute l’histoire de Florence dans la prose bourguignonne, puisque les chapitres 157 et 158 d’Othovyen11, qui font office de transition entre les deux matières, celle de Florent et Octavien d’une part, celle de Florence de Rome d’autre part, sont sans appui des deux sources et paraissent avoir été forgés par le remanieur. Quant aux deux chapitres suivants12, ils reprennent la trame narrative des vers 55-9713 de la source, mais les réécrivent fortement. Toutefois, il semble bien que dans l’esprit du remanieur l’histoire de Florence commence à l’issue du chapitre 157 : en effet, une formule de régie semble marquer la fin des aventures des deux frères jumeaux, Florent et Othovyen, et ouvrir une nouvelle page du cycle centré sur la petite-fille de Florent :
Maintenant parlerons de l’empereur Othon, filz de Flourent, et de la belle Polisse sa femme, et de leur fille Flourence, et des grans adventures et fortunnes que a l’empereur advint a cause de sa fille, et aussy les grans et innumerables maulx, paines et travaulx que la belle Flourence ot a souffrir, comme plus a plain orés en ceste hystore, qui de ce fait mencion14.
La dernière partie de la phrase (les grans et innumerables maulx, paines et travaulx que la belle Flourence ot a souffrir), évoquant en sourdine les longs titres des proses bourguignonnes, suggère une nouvelle section narrative de l’hystore qui se poursuit sans interruption dans le récit comme dans la matérialité des manuscrits15. La présentation du dernier maillon de la lignée légendaire de l’empereur de Rome Othovyen Ier permet ainsi de renforcer dans la prose la dimension généalogique du texte, soulignée par le remanieur : [Othon] luy fist mettre a non au jour qu’elle fu baptisye Flourence, pour l’amour de son pere Flourent16. La formule de régie place surtout la naissance de l’héroïne sous le signe d’un destin fatal : la locution prépositive (a cause de) signale d’emblée que la tonalité pathétique de la prose repose pour l’essentiel sur le personnage de Florence. Le remanieur insiste sur ce point. Alors qu’Othon et Polisse se réjouissent de l’arrivée d’un enfant après quatorze années d’un mariage heureux17, la naissance de Florence est placée sous le signe de la malédiction :
Moult de junes et d’abstinences firent pour avoir ceste grace de Nostre Seigneur, mais se ilz euissent sceu le mal et le deul que a la cause de l’enfant qu’ilz orent entre eulx deux, ilz ne s’en fuissent jamais enforcyés de le faire, car tant de maulx leur en advint que oncques le pareil ne fu veus, comme cy apprés porrés oÿr18.
Cette intrusion du narrateur à l’issue du chapitre 158 sert à créer un effet d’attente, mais les malheurs à venir sont très vite confirmés par la rubrique du chapitre suivant : Comment l’empereys acoucha d’une fille, qui puis ot nom Flourence, et de l’empereys quy morut a l’enfanter19. Florence est alors explicitement rapprochée dans la version en prose de son homologue masculin, Tristan :
Mais au naistre que la fille fist quant elle vint sur terre, la grant doleur que l’empereys en ot a s’en delivrer luy fu importable de le souffrir, et pleut a Nostre Seigneur que de la grant doleur qu’elle senty rendesist l’ame a Dieu, dont le deul que l’empereur en fist fu sy merveilleusement grant que bien euist volu que oncques n’euist eu enfant. Et par ainsy, la joye qu’il ot a la naissance de sa fille luy tourna en larmes et en amere tristresce20.
La naissance de l’héritière constitue un funeste présage pour l’empire romain puisqu’en venant au monde, Florence provoque la mort de sa mère et engendre la désolation de son père21. La mise en prose reprend ainsi de sa source les motifs de l’élection d’une héroïne épique22, dont la naissance s’accompagne traditionnellement de signes merveilleux23 :
car au propre jour qu’elle nasquy advint maint signe merveilleux, comme plus d’une heure entyere plouvoir sanc et le soleil soy obscurchir et muchier, dont les gens furent moult esbahys par la cité de Romme24.
La dimension miraculeuse de la naissance de Florence – signe d’élection de l’héroïne – est d’ailleurs soulignée avec insistance dans la mise en prose, tant par le narrateur25 que par les membres du conseil impérial26. Toutefois, le remanieur s’efforce d’offrir une interprétation rationnelle à ce phénomène hors du commun : il invente ainsi la tenue d’un « conseil scientifique » dans la sphère étroite du pouvoir durant lequel d’éminents astrologues sont chargés de consulter les auspices27. Ces experts, qui sont appelés dans la source des clercq sciencheux de scienche fondee28, acquièrent une qualification plus spécifique et deviennent dans la réécriture des estronomyens29 chargés d’interpréter l’avenir :
Sy y avoit pour celuy temps a Romme grant foison clers de toutes sciences, lesquelx en celle nuit, par le commant de l’empereur, avoyent estudyet et advisé pour sçavoir a la naissance de l’enfant quelx fortunes ne quelx biens luy seroient apparans, adfin que, se aulcun mal y avoit, de y pooir resister et obvyer a l’encontre. Et furent .vi. notables estronomyens, lesquelx furent toute la nuit jusques a la nativité de l’enfant regardans le mouvement du ciel, ou ilz congnurent et veyrent tout a plain les cours et mutacions des planettes, par coy ilz congnurent que, selonc l’eure en coy l’enfant avoit esté nee, demonstroit clerement que moult de maulx en advendroient et que l’empire de Romme en aroit tant a souffrir que a peu tenroit qu’elle ne parvenist a destruction totale30.
La conclusion, qui prend la forme d’une déclaration officielle sous la foi du serment31, est sans appel. Et pour marquer davantage encore l’ampleur du désastre annoncé, le prosateur place dans la bouche des astrologues une référence d’autorité aux défaites sanglantes des Romains durant les guerres puniques :
par elle advenront tant de maulx et d’opprescions a l’empire de Romme que oncques pour la grant bataille de Cannes, que on dist le lac de Perouse, n’avint sy grant doleur a Romme ne en toute l’empire, comme il sera a cause de vostre fille32.
Sont ainsi mêlées de manière hyperbolique deux cruelles défaites de l’armée romaine antique – sans que l’on sache si cette confusion est volontaire de la part du prosateur –, la bataille de Cannes dans les Pouilles et celle du lac Trasimène. L’exil forcé de la jeune Florence se voit ainsi justifié afin de faire mentir les augures :
Et pour obvyer et eschyewer de escheoir et venir en ce tresgrant et perilleux dangier, nous tous vous conseillons que incontinent que vostre fille vendra en l’eage de .vii. ans que le mettés en lieu ou elle soit nourrye sans avoir congnoissance de chose de cestuy monde ne que nulz fors sa garde en sage a parler, adfin que tout ce quy est prenostiquiet advenir soit tenu pour menterye33.
Au seuil de l’histoire de Florence de Rome en prose, la principale innovation du remanieur est donc d’insister, avant même de croquer le portrait de l’héritière du trône impérial, sur l’atmosphère miraculeuse qui accompagne la naissance d’un être d’exception, susceptible de faire basculer le destin d’un empire.
À la suite du récit tragique et miraculeux de la naissance de Florence, le chapitre 161 d’Othovyen est consacré intégralement aux enfances de la jeune fille, et plus particulièrement à son éducation, comme l’annonce la rubrique : Comment la belle Flourence crut et amenda tellement qu’elle fu tenue la plus belle et la plus sage en toutes sciences et en bonnes vertus que pour celuy temps fu ou monde34. On retrouve dans la plupart des proses chevaleresques bourguignonnes un chapitre qui relate l’éducation intellectuelle des héros masculins en devenir : parvenus à l’âge de raison, les jeunes garçons « prodiges » grandissent35 – ce qui est presque systématiquement rendu par le doublet synonymique croistre et amender – et ils sont placés sous le patronage d’un maistre chargé de les doctriner, de les conduire, de les introduire ou encore de les apprendre36. La prose de Florence de Rome constitue une singularité dans ce corpus puisqu’elle reprend l’ensemble de ces motifs dans le cadre de l’instruction d’une jeune princesse. Ainsi, Florence est confiée aux soins d’une moult sage et vaillant dame, aournee et raemplye de toutes bonnes vertus, laquelle estoit vesve […] pour le introduire et apprendre comme il appartenoit a une fille d’empereur37. C’est sous sa direction que la jeune princesse parfait son éducation morale et intellectuelle38 :
Tant crut et amenda la fille que en nulles terres ne contrees ne se trouvast sa pareille car en luy avoit sy grant beaulté que Elaine, se pour lors euist vescu, n’estoit a comparer a elle. Et aveuc ce, avoit la vertu tres excellente que on dist humilité, laquelle est moult bien seant a toute noble et vertueuse princesse. Puis avec celle noble vertu sçavoit de clergye otant que clerc le plus letré que on seusist trouver : de tous les .vii. ars sçavoit otant que sçavoir on pooit. La science sçavoit de surgerye et des fuziscyens tant que nulz ne l’en passoit : moult faisoit de belles cures as povres gens, lesquelx elle medecinoit et garissoit pour l’amour de Nostre Seigneur. Puis, quant ce venoit que aulcuns clers mettoient avant quelque question, elle argüoit et redargüoit a l’encontre d’eulx sy vivement que oncques nulz ne l’en sot passer39.
Si le portrait remanié de Florence est fortement tributaire de son modèle40, il intègre toutefois de fines retouches. Les éléments descriptifs sont épars dans la chanson et c’est au prosateur que l’on doit la restructuration du portrait dans un ensemble plus cohérent qui se compose de différents mouvements, clairement identifiables.
Le portrait de la jeune Florence s’ouvre, conformément à la tradition du récit des enfances, sur le doublet croistre et amender, que le remanieur reprend à l’envi dans les premiers chapitres41 afin de rendre compte du caractère exceptionnel de l’adolescente qui, à la manière d’un végétal, grandit, se développe, s’épanouit42 et parvient presque naturellement à une perfection physique, intellectuelle et morale43.
La mention de l’exceptionnelle beauté de Florence est quant à elle reprise de la chanson qui développe cet aspect plus longuement dans son prologue :
[Florence] Qui estoit la plus bielle de che siecle vivant ;
Car je croy c’oncques Dieus n’ala telle estorant,
Se che ne fust sa mere, Marie au corps vaillant.
Or est ainssi que chelle dont je vous voy parlant
Fu tant bielle et jolie et de tel avenant
Que Paris ou Elainne et l’amie Tristant
Ne Judith ne Fezonne, qui de biauté ot tant,
Ne furent de biauté a cestuy affreant44.
Dans la source, Florence s’insère dans un groupe qui s’apparente au motif plus tardif des neuf preuses et qui comporte une héroïne païenne (Hélène), deux figures bibliques (Judith et la Vierge Marie) et deux personnages littéraires (Iseut et Fezonne). Le prosateur ne retient que le caractère hyperbolique de la comparaison et réduit le groupe de ces modèles de notoriété à un seul élément, la belle Hélène, cherchant là sans doute à rappeler que la beauté est source de convoitise, ce que développe ensuite toute l’hystore de Florence.
Comme dans la source en vers, la jeune fille est présentée dans la mise en prose comme un modèle de clergie ; l’instruction semble néanmoins plus complète dans la réécriture car la prose mentionne explicitement les sept arts libéraux là où la chanson signale l’expertise de Florence dans le domaine de la philosophie, de la théologie (ce que la prose n’a pas repris) et – dans le cadre du quadrivium – l’astronomie45. La pratique de la médecine est également reprise de la source, à la différence notable que l’expertise acquise théoriquement par Florence dans le domaine de la chirurgie, de la médecine et de ce que nous appellerions aujourd’hui la pharmacologie46 devient dans la prose une connaissance mise en pratique au service des indigents, conformément à l’idéal de charité chrétienne prôné dans les milieux curiaux. Enfin, comme dans la chanson47, Florence excelle dans la dialectique et la rhétorique et se montre capable de soutenir une thèse ou d’apporter des contradictions dans un débat, ce qui est le fruit sans doute de ses études dans le domaine du trivium48.
Pour achever le portrait de la jeune fille, le remanieur prend soin d’ajouter que Florence fait preuve d’humilité, ce qui correspond probablement mieux à l’idéal courtois mis à l’honneur dans le milieu curial bourguignon. Cet infléchissement contribue à faire du portrait de Florence un Miroir des Dames en miniature, dans lequel toute noble et vertueuse princesse49 trouvera profit à se mirer.
La jeune enfant allie donc, comme dans la chanson, la clergie et la beauté (lumineuse)50, qualités auxquelles la prose ajoute la vertu, troisième constituant qui parfait le tableau d’un être idéal. Le caractère exceptionnel de Florence est issu de cette triple caractérisation (science, beauté et vertu) que le prosateur rappelle à plusieurs reprises, comme dans cet exemple : Or dist nostre hystoire, come par cy devant avez peu oÿr, de la bonté, beauté et bonnes vertus qui estoit en Flourence, la fille de l’empereur Othon51.
Parangon de beauté, de clergie et de vertu, Florence voisine ainsi avec de nombreuses héroïnes bourguignonnes qui partagent le même degré d’excellence et de perfection. On songe ici en particulier à la comtesse de Nassau dans Gilles de Chin :
Oncques de toute la nuit ne fist [Gilles] que plaindre et plourer la noble contesse de Nassou, et ramentevant la beaulté et bonté qui estoit en elle, et les belles vertus dont elle estoit garnye plus que dame dont jamais on euist oÿ parler52.
L’alliance de la beauté et de la vertu rappelle également le portrait de la dame de Fayel dans le Chastellain de Coucy en prose53, et plus encore ceux des deux chastes héroïnes persécutées de Wauquelin – la belle Hélène54 et la jeune Joie de la Manequine en prose –, caractérisés par la polysyndète et l’amplification :
En laquelle Joiie, Nature, par la disposition divine, mist tant de biens que elle passa la mere en biauté, en bonté, en valleur, en sienche et en conditions, car c’estoit la plus belle creature, la mieulx fourmee de tous membres que nulle riens sceuwist ou peuwist deviser ne regharder, souhaidier ne penser. [...] ne a son vivant ne fu damme tenue si sage, si belle, si bonne ne si france comme estoit cette fille Joiie55.
La belle Rommadanaple, qui deviendra l’épouse de Florimont, a également de nombreux traits en partage avec Florence – beauté, intelligence, humilité – auxquels s’ajoutent explicitement les manières de cour :
La belle fille commanchoit fort a croistre et tousjours en beauté, sy fu la pucelle sy bien par Cyprienne nourrye que merveillez estoit de voir son sens, son maintieng et sa contenance, car de touttes choses savoit a parler. Elle fu moult bien enparlee et raemplye de touttes bonnes vertus et estoit tant amee de tous que nulz n’estoit qui ne l’amast et tenist chiere.
La clergie de la belle princesse a ici pour singularité d’être le fruit de la lecture d’ouvrages didactiques sur la guerre, de chroniques et de traités sur l’amour56 :
Moult volemptiers lisoit es livres de l’art de battailles et d’istoires mais plus volemptiers lisoit es livres de l’a[r]t d’Amours que de aultre chose ; tant estoit la pucelle sage, simple et debonnaire, que de la bonté et biauté qui en elle estoit s’espandoit la renommee d’elle par les rengnez estrangez57.
Enfin, le portrait de la fille de Rambaux de Frise représente un exemple plus remarquable encore, dans la mesure où le prénom de la jeune héroïne, Florissant, fait écho à l’éclosion de ses charmes :
Or s’apelloit la fille [de Rambaux de Frise] Florissant et bien estoit nommee, car elle florissoit de beaulté sur toutes aultres. Et avec ce estoit si tressaige, humble, plaisant et gracieuse que merveilles estoit de la veoir et ouÿr, tellement qu’il y avoit plusieurs princes, tant royz, dutz que aultres, qui estoient fort entalentés pour ses bonnes meurs l’avoir en mariage, et entre aultres le roy Brunor de Dampnemarche58.
La description de l’épanouissement physique de la jeune princesse59, qui suscite désir et convoitise, est complétée par l’évocation de son talent musical, preuve qu’elle maîtrise parfaitement elle aussi les disciplines du quadrivium :
Et bien saichés que plaisante chose estoit a l’ouÿr, car elle avoit merveilleusement gente voix pour femme ; aussi estoit elle moult bien instruite en l’art de musique, et en plusieurs autres bonnes sciences60.
Les portraits de Florence, Florissant et de l’amie de Florimont se font ainsi l’écho d’une spectaculaire éclosion intellectuelle au féminin. Mais pour exceptionnelles qu’elles soient, les qualités morales et intellectuelles des jeunes héroïnes bourguignonnes ne viennent toutefois qu’en complément de leur atout principal, à savoir leur beauté hors du commun. Le remanieur de Florence de Rome insiste d’ailleurs constamment sur ce point et ajoute à plusieurs reprises des mentions de son cru61.
Les proses bourguignonnes ont ainsi en commun de présenter les jeunes héroïnes dans des scènes où elles s’offrent au regard de tous, en compagnie d’autres damoiselles et pucelles, nobles princesses ou suivantes62. Ces scènes permettent alors d’isoler la jeune princesse éponyme au sein du groupe, ce qui constitue un artifice commode pour souligner sa beauté incomparable et hyperbolique. C’est ainsi que le remanieur de Florence de Rome intègre au sein de sa réécriture, lors du tournoi initial qui départage les prétendants au mariage, une scène topique des proses bourguignonnes qui représente les dames assistant au jeu chevaleresque du haut des tribunes63 :
L’empereur Othon et Flourence sa belle fille, ensamble toutes les nobles dames de la cité, furent montees sur les eschaffaulx pour regarder ceulx qui mieulx le feroient. Les aournemens ne les riches atours dont la belle Flourence estoit paree ne vous saroye conter ne dire car, quelque riche aournement qu’elle euist, la grant beaulté quy en elle estoit sourmontoit tous les paremens, quy pou y servoient au regart de l’embelir, car oncques Orguilleuse d’amours ne la belle Elaine de Grece, femme au roy Menelaux, ne se pot acomparer a elle ne a sa grant beaulté64.
Fig. 1
Réjouissances de cour : la dame de Fayel participe à une carole dans Le livre des amours du Chastellain de Coucy et de la Dame de Fayel (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Lille, BM, ms. God. 50, fol. 49r°
© Lille, BM
Fig. 2
Dames et damoiselles assistent à un tournoi du haut d’une tribune dans Messire Gilles de Chin natif de Tournesis (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Lille, BM, ms. God. 50, fol. 49r°
© Lille, BM
Dans une description censée rendre compte de la richesse de la parure de Florence ressort la grant beauté de la jeune princesse qui, de manière assez paradoxale, ne doit rien aux artifices mondains. Le portrait oppose ainsi la somptuosité des vêtements (riches atours, riche aournement, paremens) à la simplicité de la beauté – beauté « au naturel » pourrait-on dire – de la jeune femme qui se distingue ainsi des autres dames de son rang. L’excellence et la perfection de Florence est soulignée par la supériorité de la nature sur la culture, ce qui place la jeune fille au point culminant sur l’échelle des beautés littéraires65. Florence surpasse dès lors la belle Hélène de Grèce – ce que le prosateur avait déjà suggéré plus haut lors des enfances de l’héroïne – mais également une autre beauté héroïque : l’Orgueilleuse d’amours. Or, cette référence littéraire, absente de la source, est un renvoi explicite à une œuvre contemporaine de la rédaction d’Othovyen puisque l’Orgueilleuse d’amours est le personnage éponyme d’une mise en prose dont la version longue a été commanditée par Jean V de Créquy, tout comme notre texte66. Dans Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours, la jeune héroïne est d’ailleurs elle aussi classée au premier rang des jeunes femmes, grâce à sa beauté et sa vertu :
mais par le reffus que le pucelle a fait au roy Alimodés il s’est préparé et mis en ordre pour faire grant guerre a la pucelle pour ce que tant on lui avoit loee et prisie pour la tres excellente beauté qui est en elle et aussi les tresgrans vertus dont elle est aornee, laquelle entre les autres pucelles du monde est reputee la suppellative67.
Fig. 3
Blancandin et l’Orgueilleuse d’Amours conversent en privé pour la première fois dans Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours : Vienne, ÖNB, ms. 3438, fol. 35v°
© Vienne, ÖNB
En tissant ce lien intertextuel, l’auteur de la prose de Florence de Rome invite ainsi le lecteur à prendre en considération le portrait de l’héroïne à l’aune d’autres beautés célèbres de la littérature bourguignonne.
Il est particulièrement intéressant de constater que l’on trouve une pratique similaire dans Gérard de Nevers lors de la première apparition de la belle Euryant à la cour du roi Louis le Gros. À cette occasion en effet, l’auteur de Gérard de Nevers cite lui aussi explicitement l’Orgueilleuse d’Amour comme modèle de beauté, avec un renchérissement qui la place au-dessus de Florence de Rome – qui semble donc déjà jouer ici le rôle de figure exemplaire – et même au-dessus des héroïnes antiques comme Hélène, Policène ou Didon :
Quant elle vey le jour estre venu, par ses damoiselles se fist parer et vestir moult richement : de ses abillemens et atours ne vous voel faire lonc conte, mais bien vous oze dire que oncques Elaine, Policena, Dido, ne la belle Flourence de Romme, meismement la belle Orguilleuse d’Amours, de beaulté, d’umilité n’estoyent a comparer pour le temps qu’elles vivoyent a celles de la belle Euryant68.
Ici aussi, comme dans la prose de Florence de Rome, le spectacle de la beauté au naturel – associé étroitement à l’excellence de la vertu – l’emporte sur la somptuosité de la parure vestimentaire, dont la description est rejetée explicitement par le narrateur.
Les scènes de présentation publique semblent donc le moment que privilégient les prosateurs bourguignons pour exprimer, souvent par un jeu de références littéraires avec la matière antique et les récits les plus contemporains, la beauté superlative des jeunes héroïnes69. La première apparition publique de Romadanaple dans la mise en prose bourguignonne de Florimont est à ce titre particulièrement aboutie :
Bien poés savoir que moult furent richement acompaigniés de dames et de pucelles, qui moult belle chose estoit a voir, mais riens n’estoit de leur beaulté au regart de la belle Rommadanapple, car tant sourmontoit la biauté qui en la pucelle estoit au deseure des aultres, que touttes les obscurchissoit ; tant cler resplendissoit sa beauté que touttes les appalissoit. Tant vous oze dire que oncques sy belle creature ne fu vewe en celluy temps70.
La singularité vient ici du fait que le recours traditionnel aux hyperboles (riens n’estoit… au regart, sourmonter, au deseure de, oncques sy belle) se double d’une très belle métaphore de l’ombre et de la lumière, reprise de la source71. Semblable procédé se retrouve également dans la prose de Gilles de Chin, elle aussi commanditée par Jean V de Créquy72. Attirée par la renommée de l’excellent chevalier, la comtesse de Nassau vient au-devant de Gilles de Chin accompagnée de ses dames et pucelles dont elle avoit grant foison afin de le saluer. Cette première rencontre donne ainsi lieu à un petit portrait en habits de la jeune femme, absent de la source versifiée :
Pour la chaleur du jour qui encommenchoit a monter estoit vestue et atournee legierement d’ung drap de soye a or battu, ses cheveulx lui estoient pendans tout en bas jusques dessoubz la chainture ; sur son chief avoit ung chappel d’or tout garny de riche pierrie qui moult bien lui estoit affreant ; elle avoit le viaire coulouré et blancq comme une fleur de liis. Se de sa gente fachon, de sa beaulté et de son gracieux maintieng vous vouloie au long deviser, assez y pourroie mettre. Pour lors elle n’avoit que .xv. ans d’eage, mais sachiés que pour le temps on ne trouvast en nul paÿs dame ne damoiselle qui le passast de beaulté ne qui a elle se deust acomparer73.
Dans cet exemple, la description de la jeune fille et de ses beaux atours est plus développée que dans les textes précédemment cités et elle est teintée d’un subtil érotisme grâce à l’évocation de la carnation du visage, d’une tunique diaphane et de la chevelure relâchée. Néanmoins, sous cette variation se dévoile à nouveau un thème commun à de nombreuses mises en proses contemporaines puisque la mention de la supériorité de la beauté l’emporte sur l’intérêt d’une description plus étoffée que le narrateur se refuse d’assumer pour ne pas lasser son lecteur.
Dans les romans bourguignons, l’artifice littéraire de l’excusatio se substitue ainsi fréquemment à l’obligation de décrire74. L’auteur de l’Histoire des seigneurs de Gavre use ainsi d’un semblable procédé pour décrire la belle Ydorie et refuse de prendre en charge la description sous prétexte de ne pas allonger sa matière :
Sy vous monstrera sa fille Idorye, qui est la plus belle pucelle de Grece. Sire, oncques si belle ne fu ; jamais ne veistes plus humble ne plus courtoise, sy vous oze bien dire que, quant l’arés vewe, dirés que au monde n’est sa pareille. Se sa grant beauté vous voloye raconter trop longement y porroye mettre, car Dieu et Nature y ont tellement ouvré qu’il n’est nulz que riens y seuist reprendre. Sy vous dis que ceulx quy l’ont vewe s’en sont party comme ravy, et leur sambloit que ce fust songes75.
L’auteur du Blancandin en prose supprime lui aussi l’intégralité du beau portrait canonique de l’Orgueilleuse d’amours76 ; il réécrit la formule conclusive d’auto-célébration qui ponctuait la description dans la source pour ne conserver qu’une formule d’abrègement du morceau de bravoure attendu : Se la beauté, son humilité et les biens qui sont en elle vous vouloie au long raconter, trop vous pourroie tenir77.
L’exemple de la prose de Gilles de Chin fait donc figure d’exception notable car la plupart des proses bourguignonnes contemporaines semblent plutôt s’attacher à faire disparaître toute description physique des jeunes héroïnes. Dans la prose de Florence de Rome, par exemple, le second portrait de l’héroïne, qui n’est pas pris en charge par le narrateur, mais par un personnage (le patron d’un dromon romain), rejette la description topique de la beauté féminine, telle qu’elle a été enseignée dans les arts poétiques médiévaux et telle qu’elle a été consacrée en particulier dès les romans d’Antiquité :
Et pour ce, sire, que je voy que desirés sçavoir la verité et que c’est vostre plaisir, je le vous diray, non mye que en moy soit le sens de vous sçavoir raconter ne dire la tres excellente beaulté d’elle : sy sçachiés de verité que ou monde n’est le paintre sy soubtil que tant seuist procurer que sa belle fache seuist paindre, tant est parfaittement belle78.
Le caractère ineffable de la beauté de Florence est traduit par l’analogie établie implicitement entre le travail de l’écrivain et celui du peintre79. Le verbe procurer qui signifie ‘faire des efforts pour arriver à un résultat, se dépenser’ évoque un travail manuel, artisanal, et renvoie donc par un jeu de miroir à la figure de l’écrivain artifex, souvent célébrée dans les prologues des romans médiévaux. Or, c’est précisément cette dimension que récuse le prosateur bourguignon en affirmant son incapacité à traduire la beauté de l’héroïne en recourant aux étapes conventionnelles du portrait. Ainsi, la mise prose ne reprend aucun des attributs physiques du modèle80, à savoir : la description du corps selon un ordre descendant, la prédilection pour le visage (char, yeux, cheviaux, bouche, menton, sourchilz, nefz), le recours à des adjectifs traditionnels (char blanche et coullouree, cheviax ghaunes, yeux vairs, menton fourchelu, sourchilz deliéz), la comparaison avec des animaux nobles (les yeux du faucon, les plumes de paon), l’éloge de la juste mesure (bien entailliet, bielle fachon, par raison) et de l’harmonie générale (droit, bien fait, deliéz), ou encore l’érotisation du corps (mamelettes durettez et poingnans). Seul le caractère hyperbolique du portrait est mis en exergue (sont reprises en particulier les trois occurrences de la plus […] que et la référence aux terres lointaines) : Sire, puisque tant en volés savoir aveuc la beaulté dont elle est paree, Dieux luy a fait ceste grace d’estre la plus doulce, la plus humble, la plus begnigne que pucelle qui aujourd’uy soit en vye81. Les hyperboles ne s’appliquent plus toutefois aux proportions idéales du corps féminin, mais elles déterminent les canons d’une perfection morale qui s’élabore par une addition de vertus. Ce qui est plus frappant encore, c’est que le remanieur reprend ailleurs, par deux fois, ce style formulaire, presque mot pour mot, lorsqu’il décrit son héroïne. On y retrouve alors le topos de l’écrivain artifex, tout aussi incapable que le peintre de rendre compte d’une beauté exceptionnelle, quelles que soient la finesse et la subtilité de son art et quelque effort qu’il puisse produire. Le premier exemple se situe à l’acmé de la tension narrative quand Florence est amenée au bûcher afin d’expier un crime qu’elle n’a pas commis :
Sy estoit tant parfaittement belle de corps et de figure que ou monde on ne trouvast paintre quy tant seuist soubtillier ne attaindre que sa belle face ne sa fachon seusist paindre ne faire82.
Fig. 4
Fiançailles de Florence de Rome et du jeune prince de Hongrie, Esmeré dans le Livre des haulx fais et vaillances de l’empereur Othovyen (Lavis d’aquarelle – Maître de Wavrin) : Chantilly, Bibliothèque et archives du Musée Condé, ms. 652, fol. 182r°, Cliché CNRS-IRHT
© Chantilly, Bibliothèque et archives du Musée Condé
Ici, le verbe soubtillier qui signifie ‘s’appliquer, s’ingénier à’ est très proche de son synonyme procurer relevé dans l’exemple précédent ; quant à attaindre, dont le sens est ‘parvenir à ses fins, réussir’, il marque plus explicitement – dans la tournure négative – la vanité de l’effort artistique. Le second exemple, quant à lui, vient rappeler les qualités exceptionnelles de Florence à l’issue de ses mésaventures, le jour de son mariage :
Quant est pour la beaulté quy estoit en Flourence, il n’est paintre que sa beaulté seusist paindre ne attaindre a le faire a sa samblance ne clerc quy sa grant beaulté vous seusist escripre car elle passoit de beaulté, de bonté, d’umilité celles qui pour lors estoient en vye83.
L’analogie entre le travail du peintre et celui du clerc, c’est-à-dire de l’écrivain, est ici une fois encore explicite. À travers les deux exemples relevés, on note que le remanieur de Florence de Rome n’utilise pas seulement à l’envi un topos d’excusatio afin d’abréger sa matière originale ; il interroge aussi avec subtilité la complexité du rapport à la mimesis dans la représentation des portraits. Le prosateur semble ainsi renoncer à la fidélité à la semblance en raison de la perfection du modèle à dépeindre. C’est à cette fin qu’il utilise la figure rhétorique de la description négative. Cette dernière consiste en effet à affirmer ne pas vouloir décrire afin de mieux permettre au lecteur de faire seul le chemin, selon ses propres codes de figuration84. La description, sous sa forme négative, se prolonge ainsi dans l’imagination du lecteur et suscite alors de multiples représentations85. À l’image des auteurs des proses de Blancandin et de Florence de Rome, plusieurs écrivains bourguignons prennent congé de l’archétype descriptif du portrait féminin en recourant au même style formulaire.
Ainsi, l’auteur du Chastellain de Coucy en prose souligne lui aussi l’incapacité tant du poète que du peintre à descripre ou portraire la dame de Fayel :
Sa beauté ne son bel maintieng ne vous saroye descripre […] la beaulté de son viayre, la faiture de nez et de bouche et la couleur de son vyaire n’est besoing que vous en face long compte, car oncques paintre ne fu tant soubtil que sa beaulté seuist pourtraire86.
À travers cet exemple, on voit bien que ce sont les éléments topiques du portrait, comme la description descendante des attributs du visage ou l’évocation de la carnation, qui sont explicitement ciblés et rejetés.
Semblable démarche se retrouve également dans le Florimont en prose, lors de la première rencontre entre le héros et la belle Rodamanaple :
Sachiés que c’est la plus belle de Grece ; oncques sy belle ne veistes, car bien vous dy que, quant sa grant beaulté arés veue, dirés que au monde n’est sa pareille. Se sa grant beaulté vous voloye raconter, trop vous porroye detrier, car Dieu et Nature y ont tellement ouvré que ou monde n’est paintre qui tant seuist procurer que sa belle face seuist paindre ; tant est doulce, humble et courtoise que tous ceulx qui veu l’ont s’en sont party come ravy et leur a samblé que ce soit songes. Je vous dy, sire, que en ce monde mortel plus belle creature ne fu veue ne trouvee87.
Outre le caractère hyperbolique et ineffable de la beauté, ce qui est mis en avant dans cet extrait, c’est l’excusatio traditionnelle du narrateur refusant d’élaborer pour son portrait une longue description qui pourrait être perçue comme une digression inutile88. On note alors que le prosateur abandonne pleinement le portrait canonique du roman en vers89. Et pour justifier son entreprise, il recourt précisément, comme l’auteur de la prose de Florence de Rome, au verbe procurer, ainsi qu’à l’analogie entre peinture et écriture. Certes, ce rapprochement tire son origine de la source90 ; toutefois, il n’est plus utilisé seulement à des fins hyperboliques, mais bien pour soutenir la figure stylistique de la description négative91.
Dans Gérard de Nevers enfin, l’adaptateur opère une coupe franche dans le portrait d’Euryant, dont la longueur aurait pu paraître artificielle à son lecteur92 :
Aujourd’uy ne se trouveroit paintre, tant fust soubtil, que sa belle face seuist pourtraire au vif, ne il n’est homs que de la fachon d’elle vous seuist au vray deviser. De sa beaulté, de ses riches atours ne vous feray lonc compte, fors que tant estoit bien faitte et fourmee que en elle Dieu et Nature n’avoyent riens oublyé93.
Ces différents exemples montrent que les mises en prose bourguignonnes ont fait considérablement évoluer la technique littéraire du portrait. Au lieu de décrire avec force détails le visage et les différents constituants du corps des héroïnes romanesques, les remanieurs usent d’un style formulaire qui, par l’expression hyperbolique, suffit à suggérer l’excellence de la beauté féminine.
***
Au terme de cette étude, on constate que l’on trouve finalement assez peu de visages de femmes dans les proses bourguignonnes du xve siècle. Nombre d’entre elles renoncent aux brillantes descriptions des héroïnes et les représentent comme des figures exemplaires, bien supérieures aux modèles du passé. Il apparaît clairement que les prosateurs bourguignons prennent congé des conventions littéraires prônées pas leurs prédécesseurs et refusent de se plier à une description par trop stéréotypée. Les héroïnes romanesques du xve siècle sont certes des incarnations d’un idéal de beauté, de vertu et de clergie, mais elles ne sont pas pour autant réductibles à un type. Ainsi, de manière assez paradoxale, l’effort de particularisation et d’individualisation des figures féminines s’exprime massivement dans les portraits par le recours à la description négative. Il ne s’agit probablement pas d’un constat d’échec au sujet de la mimesis, mais bien plutôt d’une nouvelle conception du portrait qui se fait jour dans les mises en prose bourguignonnes. Dans ces remaniements, l’effacement des visages féminins répond probablement à une volonté d’actualiser les textes pour un lectorat qui ne pouvait plus se satisfaire de canons descriptifs passés de mode. C’est désormais au lecteur de prendre en charge la représentation, ce qui fait que le portrait n’est plus figé pour l’éternité et qu’il est reconfiguré à chaque lecture. Ce nouvel idéal esthétique se fait très certainement l’écho d’un modèle social : grâce à ces portraits mis au goût du jour, la littérature bourguignonne tend à ses lectrices un miroir dans lequel elles sont invitées à se mesurer à des figures de saintes dans le siècle, qui allient beauté, intelligence et vertu.